Art-Andy
4000 passages
mon blog vient de passer le cap des QUATRE MILLES passages...
MERCI à tous. à+
la fille aux bottines
Photonumérik érotik sur toile

"la fille aux bottines" (60x60cm)
Commentaires
1. culturel le 31-01-2011 à 13:11:44 (site)
Bonjour.
Merci pour le com.
Les gens ne connaissent plus l'orthographe, la situation est catastrophique. Mais je pense que faire une réforme en simplifiant l'orthographe, n'est pas la bonne solution.
Bonne journée.
le numéro 10
Photonumérik érotik sur toile

"le numéro 10" (60x60cm)
...
(Version non corrigée)
Parution encore non défini. Edition Edilivre.
Xavier Ben J
#La benjamine
L'annonce d'un retour
Né en 1967 à Lorient, Xavier Ben J, suivra ces parents à Rennes, Vannes pour revenir sur les contrées des alentours de son pays natal. Depuis il ne cessera de croire à sa destiné artistique après son passage à l’école des Beaux-arts de Lorient en 1988.
Mais une prise de L.S.D à la sortie de ses études le poussera à se déconnecter de la réalité en 1992 pour vouloir sauver notre monde. C’est une lourde responsabilité qu’il ne supportera pas. Sans passer par l’option d’une chambre d’un asile qu’il craignait, Xavier Ben J se remettra peu à peu de cette expérience que quatre années plus tard.
Ce n’est qu’en 2001, après quelques petits boulots et plusieurs formations pour apprendre, que Xavier Ben J se décida à écrire. Essai autobiographique, "La Benjamine" se veut être au plus près de la réalité. Dénonçant ce monde patriarcal et machiste, suite logique après son parcours de vie, cet ouvrage est un chemin initiatique plein de vérité et de passages lourds en émotion forte. Aussi un soupçon de trame policière et quelques graines d’érotismes marquant parfois ces fantasmes les plus profonds nous poussent à vouloir connaître la vie d’un seul homme, celle de l’auteur. Quel est véritablement son histoire ? Finalement on s’interroge.
C’est son premier ouvrage, résultat des dix dernières années.
Préface de l'auteur
Le vendredi 07 septembre 2001.
C’est vers 23h28 que j’ai tapé sur mon clavier les premières lettres de cet ouvrage.
Encore en partie dyslexique, nous pensions au moment du traumatisme que mes cours d’orthophonie auraient résolue parfaitement la pathologie, ce travail d’écriture a donc été un vrai exercice.
Ce livre est une autobiographie.
Dans mon histoire, j’ai été celui qui croyait pouvoir sauver ce monde.
C’est une écriture profonde jusqu’à conter mon phantasme insoupçonné qui choquera certainement plus d’un puritain et encore plein d’autres.
En supplément des morceaux érotiques romancés viennent pimenter l’ouvrage.
Le sexe fait parti de la vie.
Ne pas le pratiquer est une réduction de l’être à moins qu’il ne soit pallié par une recherche spirituelle évidente.
Durant l’écriture un élément issu de mon sinueux labyrinthe cervical est venu me perturber. Ce dit, retour de refoulement dans le jargon psychiatrique, déclencha en moi un effet d’effondrement.
Ce chamboulement discrédita aussi la thèse que j’avais de ma personne.
Donc j’ai dû reprendre mon livre à sa racine pour lui redonner de la fraîcheur.
Il faut prendre ce livre comme une fable.
Aussi pour garder l’anonymat des gens citées dans ce livre leurs identités ont été volontairement corrigées.
Dans l’espérance que les personnes concernées se retrouveront.
Je vous remercie pour votre sensibilité.
Xavier Ben J
Chapitre 1
J'aime travailler la nuit. Je suis noctambule, festif, j'aime la contre culture, le son des teuffeurs, le rock des seventies et il y en a eu des tonnes de rockeur à cette époque. Pour n'en citer qu'un, je nomme Iggy Pop. J'ai un faible pour lui. J'adore sa façon de bouger, sa façon de se torsader toujours torse nu sur scène. Dans l’astrologie chinoise, c’est une chèvre, comme moi. Je l’ai vu jouer, danser, chanter, sauter en concert dans un festival à Carhaix.
Sinon, je puise aussi mon inspiration et je laisse mon âme divaguer en écoutant du jazz dans un bon fauteuil. Cette musique est à l’origine de toutes celles qui l’ont succédée. J’aime la musique du monde. Les cultures, les sculptures et les richesses spirituelles de la Chine, de l'Inde et de l'Afrique me font spécialement rêver. La grande pyramide de Gizeh m'impressionne. L'inconnu aussi, parfois. J'aime l'art en général mais je me sens imprégné particulièrement par le Minimalisme. L'Arte Povera ou l’art pauvre, c’est un mouvement né en Italie, m'interpelle et les sculptures noires et longilignes, découpées, hachées de Giacometti me déstabilisent. Aussi, j’ai sniffé la Chèvre de Picasso à Paris avec mes petites prunelles vertes. J'aurai aimé la toucher, la caresser, la voler pour mon salon rouge. J’aurai écouté près d’elle et avec elle Souad Massi ou Susheela Raman.
Ainsi j’aurai pu remémorer mon histoire de vie au près d’un bon verre de whisky.
Zo est très fier de sa dernière fille. Ce quatrième bébé a été conçu un mercredi midi. Le 07 juin 1944, juste après le débarquement de Normandie. Son troisième enfant, une fille, est décédé en 1941 d’une grave maladie, la diphtérie. Elle n’avait que sept ans. La pauvre. Ses deux premiers gosses sont des garçons, André, et le plus jeune, Tonio.
Moun est donc née après la Deuxième guerre mondiale. C’est une enfant assidue à l’école et très douée pour l’école. La Retraite est un collège privé de Lorient. C’est un établissement de très belle réputation, guidé par des sœurs de l’Église. Le régime est sévère. Moun y gagne plusieurs récompenses et autres prix collégiens. Elle continue ses études supérieures à l’IUT de Rennes pour obtenir encore avec facilité son diplôme d’État. Sa thèse de fin d’année, La psychologie dans le monde du travail a été validée.
En 1963, elle rencontre Paolo. Il travaille à l’arsenal de Brest. Quatre ans plus tard, en 1967, Moun me met au monde à l’hôpital Blanqui à Lorient. Très vite, ils iront travailler à Rio de Janeiro.
Ils rentreront en France rapidement.
L’hôpital a été réhabilité depuis en centre d’accueil et d’encadrement pour les personnes ayant besoin de suivi médical en psychiatrie.
Louis Auguste Blanqui, lui, était un théoricien socialiste et révolutionnaire français. Mort en 1881, il édita parmi d’autres ouvrages et à la fin de sa vie, le journal Ni Dieu ni maître.
Après un bref passage au Brésil, mes parents iront habiter deux ans entre Rennes et Laval. Moun est encore étudiante. Paolo est vendeur dans une petite boutique en électronique et informatique à Laval. Cette boutique spécialisée a été l’une des toutes premières ouvertes en France. Les machines que Paolo mettait en rayon pour attirer les quelques rares entreprises pionnières ne s’appelaient pas encore ordinateur. Ces appareils étaient appelés calculateurs. Ils étaient faits à l’époque surtout pour la comptabilité.
Le temps passe. J’ai deux ans. Mes parents ont quittés Rennes et Laval pour aménager sur Vannes. Vannes, c’est la préfecture du Morbihan et cela a été aussi dans un autre temps la capitale des Vénètes d’Armorique durant un siècle et demi, Darioritum.
Les Vénètes d’Armorique sont d’origine italienne, venus de la Vénétie, s’établissant ici suite à leur soumission devant les attaques à répétions des légions romaines. Les Vénètes d’Armorique ont été les navigateurs les plus puissants de la Gaule. Redoutables. Leur nouvelle cité fut détruite finalement par César en 56 avant Jésus-Christ.
Maintenant Paolo est conseillé en assurance dans une petite agence à Vannes. Moun est institutrice. C’est son premier travail.
Mes parents ont loué un appartement au premier étage d’un immeuble. C’est un T3. Les deux premières pièces donnant sur la rue ont un balcon chacun. Dans la journée, il y a des passants à pied ou en voiture, mais pas trop. Les voitures sont blanches, grises, noires ou bleues marines. C’est triste. Les voitures jaunes, orange, rouges ou violettes, je n’en vois pas trop.
Dans le salon, je me rappelle de Paolo qui m’apprenait à compter jusqu’à dix sur ses dix doigts.
- 1, 2, 3...
Nous étions assis tous les deux sur le canapé. Il faisait soleil. Les rayons venaient éclaircir le tapis déjà haut en couleur. Le parquet, lui, restait sombre.
Plus tard, j’étais seul avec Moun.
Je me suis niché dans la jardinière en plastique, blanc, rigide et vide, accrochée sur la balustrade du balcon du salon. Le siège noir de mon tracteur, rouge, à pédales m’y avait permis l’accès. Il m’eut fallu beaucoup d’adresse tout de même. Au rez-de-chaussée, il y avait un petit commerce de chaussures et de belles fripes pour bambin. Soudain une piétonne a crié :
- Oh mon Dieu !
Et puis encore :
- Descends de là mon petit.
Une autre passante, plus jeune :
- Où est ta maman ?
Pendant ce temps, maman était occupée à repasser les chemises de papa ou les draps du lit, je ne sais pas.
- Attention. Cria encore la première dame âgée affolée.
Sa voix était esquintée, le ton à peine audible.
Finalement maman a entendu les appels au secours. Elle me rattrapa avant la chute. Elle remercia fortement les deux dames. Bien entendu.
Un autre jour toujours seul avec Moun et toujours sur le balcon, j’ai voulu récupérer un de mes feutres oublié sur le second balcon. C’est le balcon de la chambre de mes parents. Le feutre est orange.
Les deux balcons sont séparés précisément d’une coudée. La coudée, c’est l’unité de mesure de l’Égypte antique valant 52,36 cm soit l’équivalence de Pi divisé par 0,06. C’est étrange.
Les mathématiques des égyptiens étaient essentiellement basées sur le nombre Pi. Mais d’où détenaient-ils ce nombre interminablement long bien connu ? Des grecs ?
Entre deux balustres, deux barres métalliques torsadées de couleur gris bleu argenté, j’ai glissé mon bras droit suivi de près de ma jambe droite. J’ai passé mon torse après. Mon bras gauche était attaché au torse. Je passe ma dernière jambe. Trop grosse, ma tête était restée derrière les deux balustres.
Au final, je me suis retrouvé sur le fin fil de la bordure cimentée du balcon avec mes toutes petites chaussures rouges achetées en bas qui retenaient là mon tout petit corps en très mauvaise posture.
J’avais l’air certainement d’un bon équilibriste. Cependant je ne maîtrisais plus du tout la situation qui devenait très préoccupante.
Mes toutes petites mains accrochées fortement aux deux fines balustres retardaient ma chute. Pour peu, je manquais la strangulation. Un mauvais pas et tout était fini pour moi. Heureusement, une piétonne cria encore :
- Oh mon Dieu !
Le ton était plus lourd et plus dramatique que la première fois.
Moun préparait le dîner dans la cuisine pour le plat de ce soir.
– Au secours. Cria la dame.
– Au secours.
Moun entendit une nouvelle fois les cris dans la rue. Quand elle m’a vu, son visage a blanchi en deux secondes. Son cœur a dû ne plus battre trois secondes certainement. Moi, j’ai entendu son cœur flipper. Son cœur était vert. Ce n’est pas habituel. Moun s’est approchée de moi un peu affolé puis me dégagea de cette prison ouverte avec douceur. Il lui fallu jeter son sachet de sucre vanillé pour gagner un colis de self-control.
- Ouf !
Qui a soufflé « ouf » ? Maman ? Moi ? Nous deux peut-être...
Moun se défendait bien pourtant dans son ministère de maman. Elle ne devrait avoir point besoin de l’intervention des piétons pour me faire à manger. Moun sait me faire des câlins. Des bisous sur le ventre. Des cadeaux parfois. Quoi comme surprises ? Je ne sais plus.
La nuit arrive. Le jour recule.
Maman me couche.
À cette heure là les passants sont devenus trop rare dans la rue pour alerter maman d’un éventuel danger. Les minutes passent. Agité dans mon sommeil, je me suis retourné faisant par là un tête-à-queue. Mes pieds ont pris la place du chef. Ma tête sous les couvertures. J’étouffe sourdement. Je panique.
Moun, assoupie dans le canapé, un livre en main, la télé allumée, Paolo regardant le football une Kronenbourg entre les jambes, distingua distinctement mes frêles petits cris étouffés par l’épaisseur des draps. Elle accourt dans ma chambre. Elle arracha au mieux mes couvertures jetant son intrigue policière sur le sol. C’est un Agatha Christie, « La fête du potiron ».
- Ouf !
Là, le « ouf » c’est moi qui l’ai dit.
Assise sur le rebord du lit, maman me dorlota dans ses bras et attendit soigneusement que je reprenne ma respiration sans saccades.
Sur ce coup, il n’y avait point de passants dans la rue pour prévenir ma matrice.
Quelques mois plus tard, Moun et moi sortions à pied du parking de la supérette du quartier. Nous avons une centaine de pas à faire pour rejoindre l’appartement.
Moun me serre la main. (Vous rappelez-vous de la lourdeur de ce bras en l’air tenu par une grande personne ? Moi oui) Moun est lourdement chargée de trois pochons goinfrés de course.
Profitant d’un relâchement de sa poigne, j’ai arraché avec détermination ma main de sa main pour entreprendre en solitaire la traversée de ce fleuve bitumé, cette route juste bombée pour évacuer l’eau de pluie vers les caniveaux. Les voitures roulent. Après deux ou trois coups de klaxon brefs et rapprochés, deux pare-chocs et un capot évités, j’ai saisi sans mots les paroles des yeux noirs de maman toujours sur l’autre rive. Très grande frayeur pour maman et quelques chauffeurs.
Plusieurs mois se sont écoulés. Nous habitons toujours à l’étage du 28, rue Colonel Maury. Maman me demande d’aller chercher du pain à la boulangerie du coin.
- Andy, tu vas chercher du pain pour ta gentille et belle maman ?
- Oui maman.
Le parcours n’est pas trop fait d’embuche pour l’enfant que je suis encore. Maman me donne les deux ou trois sous. Moun m’ouvre la porte d’entrée. Je descends les vingt-trois marches de l’étage. J’ai cinq ou six pas sur les pavés du porche de l’immeuble. Passé le portillon du bâtiment, je devais bien garder en main les cinq pièces jaunes. Ma petite paume devenait pour moi un véritable coffre-fort tenu secret le temps de l’escapade.
J’avais cinquante trois mètres à faire à droite pour attraper la poignée de la porte de la vitrine de la boulangerie.
Notre boulangère est très commerçante.
Policée et toujours souriante. Cependant, ce que je préférais chez elle c’était son large décolleté bien garni. La gorge toujours ouverte. Été comme hiver.
Dans son drugstore, je fouinais rarement dans tous les bocaux où l’on pouvait chiner ces milles réglisses noirs spiralés odorantes et toutes ces moelleuses et colorées fraises Tagada et ces deux gros célèbres chewing-gums aux longs boudins roses, le nommé Malabar. Le monsieur est costaud.
De toute façon, j’avais rarement beaucoup trop en monnaie pour bien en profiter. Donc.
Et puis, de toute manière, loin de toutes ces sucreries, je préférais, et de loin, ce dessert glacé et fruité très en vogue à cette époque. Il y avait l’orange givrée ou le citron givré. Moi, j’avais en évidence une préférence pour l’orange. J’avais droit à cette glace qu’avec l’accord de mes parents parti en piste le samedi après-midi dans certains grands cafés de Vannes ou au restaurant en suivant ceux-ci à un repas de famille le dimanche midi à Lorient.
Un poil de potiron et le tarot
Chapitre 2
J’ai changé d’école.
Dans la cour de récréation, j’aperçois deux camarades de classe taquinant un poil de potiron. Les deux ont réussi à feinter le rouquin le guidant dans un guet-apens. Le petit bonhomme à tête orange s’est engouffré dans une immense toile d’araignée. Il se débat maintenant comme il peut avec ses membres fébriles pour se défaire de ce tissu entremêlé dans sa chevelure et collé sur la peau de son visage et sur les fils de son pull.
La cloche sonne. Le son est claquant et grinçant. La maîtresse nous appelle au rang. Le timbre de sa voix ne s’accordait jamais avec celui du carillon.
La cloche sonne encore.
Seul au milieu de la cour, je suis accroupi. La maîtresse lève le ton d’un cran pour me crier dessus. Il est temps de me lever. Je me lève.
J’avais envie d’aller aux toilettes depuis le début de la récréation, mais en me levant ma poche cystique n’a pas réussi à retenir sa porte. Ma petite culotte blanche est trempée dorénavant. Mon pantalon, à la mode, en velours marron aussi. Les deux autres garçons méphistophéliques vont pouffer de rires. C’est évident.
L’institutrice va-t-elle m’humilier devant tous les autres ?
Va-t-elle se moquer de moi ?
Je suis en classe maintenant. Mon voisin du pupitre ne flaire rien.
La fin des cours est programmée dans une heure et quarante deux minutes. J’espère absolument ne pas être appelé sur l’estrade pour résoudre un problème de chiffres et de lettres. Au tableau, je serais la risée de toute la classe avec ce pantalon mouillé.
L’heure passe. Il reste une demi-heure et douze minutes de cours avant l’échéance. Nous sortons de la salle de cours. Les mamans et les quelques rares papas viennent chercher leurs rejetons.
La cour se vide.
Je suis seul dans la cour. Moun a du retard. J’attends sagement maman. Finalement elle arrive en voiture et s’arrête devant le portail de la cour de l’école. C’est une Renault, une 4L. Elle est blanche. J’ouvre le portail de l’école. Je ferme le portail derrière moi. J’ouvre la porte de la caisse. Je monte dans le caisson pour m’assoir, côté passager. Je ferme la porte.
Maman me demande :
- Andy, as-tu passé une journée radieuse ?
Mon pantalon a séché mais essayant de cacher ma gêne, je réponds timidement :
- Oui.
Moun redémarre. Plus loin, maman s’arrête chez le marchand de tabacs. Et puis, elle me lance :
- Tu viens.
Je réponds rapidement :
- Non, non.
Le jeune commerçant au crane dégarni et ses clients qui font la queue vont sentir mon odeur d'urine. Je reste assis confortablement dans la Renault. Je flippe.
Moun est parti acheter ses trois paquets rigides de Gitane bleus marines. J’attends.
Je crains les remontrances arrivé dans le nouvel appartement. Moun a du pif. Malgré ses fortes cigarettes brunes consommées, elle a dû sniffer mon odeur d'urine dans sa voiture.
Maman doit attendre certainement que nous soyons arrivés dans l’appart pour me jeter des verbes durs et des mots acerbes. Je crains l’engueulade.
Maman revient du libraire-buraliste avec ses cigarettes en main. Elle monte dans la voiture. Elle se tait. Elle met ses mains sur le volant. Elle démarre. Nous nous arrêtons sur une place du parking du nouvel immeuble. Nous sortons de la voiture blanche.
On prend l’ascenseur.
Dans le miroir de l’ascenseur, je regarde discrètement mon pantalon. L’ascenseur est en marche pour atteindre les sommets. Il s’arrête. Ses deux portes s’ouvrent. Maman et moi sortons de cet escalateur. Maman a sorti la clé de la maison. Nous sommes devant la porte. Je rentre dans l’appartement. Maman est toujours dans le couloir de l’immeuble.
Je longe le couloir du vestibule. J’attends à ce que Moun m’interpelle. Rien.
L’air de rien, sans l’air pressé, je continue mon chemin le long des plinthes de l’entrée. Dans ma chambre, je change mon pantalon et ma petite culotte.
Moun m’appelle pour goûter. Je savoure pleinement mon chocolat au lait demi-écrémé et mon pain beurre demi-sel.
Ni vu ni « senti », j’ai compris ce jour là ce que c’était d’avoir du bol. Et je savais maintenant que la chance existait vraiment.
Paolo et Moun sont depuis l’été dernier propriétaires d’un grand appartement, un T5. Nous habitons dans une tour dans un autre quartier de Vannes, à Kercado.
Il y a un lycée à côté de notre immeuble. C’est le lycée Alain René Lesage. Alain René Lesage a été romancier et aussi auteur dramatique. Il est né en France à Sarzeau en 1668. Alain a été traducteur des dramaturges espagnoles. Il connaîtra le succès avec Crispin, rival de son maître puis avec Le Diable boiteux. Ici, un jeune écolier découvre les pensées des humains et leurs songes, révélateurs de leurs plus grands désirs.
Paolo et Moun ont loué les deux premières chambres de l’appartement à deux plantureuses et eurythmiques étudiantes justement.
L’une était brune aux cheveux courts et presque noirs. L’autre fille plutôt châtain foncé aux cheveux longs. Non, la deuxième fille n’est pas blonde. J’aurai aimé les zieuter se déshabiller dans leur chambre avec un regard d’enfant. Une nuit, j’eusse rêvé même d’être une petite souris pour les mater secrètement. Je m’étais imaginé sous leur plumard visionnant leurs formes sublimes aux lignes bombées. Devant moi, j’avais sous mes petits yeux ronds et noirs leur petite culotte blanche et rouge collée sur leur peau des fesses arrondies. Les deux filles étaient grandes.
J’aimais bien Clara, la fille aux cheveux châtains. Sa culotte était rouge.
Dans ma chambre, la moquette est couleur apoplectique. Ce rouge ardent jure sur les fossés de mon circuit de voiture noir électrique. La moquette aurait pu être de la lave tout juste sorti de ce quelconque orifice volcanique surgi d’un coin de ma chambre fondant bientôt le bitume de mon jouet.
Ça choque un peu.
C’est l’apocalypse.
Sur ce champ enflammé mes Lego de couleurs sanguines qui traînent au sol ne sont pas faciles à discerner. Souvent, j’ai marché dessus le matin en me levant du paddock ou en revenant pieds nus de la salle de bain. Les plantes de mes pieds ou mes talons, les calcanéums, ont certainement subi mille cents fois ces arrêtes et ces angles tranchant qui ont déchirés ma chair et mes os.
À cette époque, le jeudi était le jour de repos pour tous les écoliers. Ce jour là, j’étais donc chez ma nourrice, Madame Kerplouz.
Plusieurs semaines avant cela, Julie, une des filles de Madame Kerplouz, m’aguichait déjà dans la cuisine. Agenouillée, moi assis dans mon siège haut pour bambin, elle me chatouillait le sexe avec ses mains à travers le tissu de mon short, tout en ricanant.
Elle m’énervait.
La garce profitait bien de la situation.
Dans le grand jardin du lotissement, je papote avec un pote de mon nouveau quartier, Benjamin. Je lui ai prêté mes petites voitures, mes Majorette, il y a voila quinze jours. Nous nous étions mis d’accord pour qu’il me les rende après une semaine d’utilisation.
Je lui demande :
- Quand me rends-tu mes jouets ?
Pour me répondre à ma question, il me certifie son géniteur herculéen beaucoup plus fort et pharaonique que mon Paolo. N’ayant pas eu de réponse appropriée, je monte le ton d’un cran, la conversation s’envenime. Sur le balcon, pas loin, maman écoute. De son trône, elle me convie à venir goûter.
Je monte.
Le goûter est déjà installé sur la table de la cuisine. Le bol est marron. Mes tartines de pain beurre demi-sel et confiture aux fruits rouges trempées dans mon chocolat chaud au lait demi-écrémé sont une bombance. Je fais ripaille. Dans l’action, Moun m’interroge :
- Andy, as-tu un problème avec Benjamin ?
- Non.
- En es-tu persuadé ?
- Oui.
L’insistance du silence de maman se fait lourde.
- ...
Une toute petite coccinelle rouge à points noirs, elle est posée sur mon épaule gauche, m’aurait-elle entendu soupirer :
- Je lui ai prêté mes petits jouets à quatre roues, il y a quinze jours, et il ne veut plus me les rendre.
Maman reprend :
- Andy, veux-tu que nous allions les chercher ?
Je réponds clairement :
- Oui.
Barre d’immeuble. Il n’y a pas d’ascenseur dans le hall. Moun et moi gravissons promptement les premières marches dans la cage d’escalier. Après trois étages, j’étais essoufflé avec mes petites jambes. Elles devenaient comme celles des petits vieux en fin de parcours. Tremblantes.
Devant la porte du petit voleur, maman se presse d’utiliser la sonnerie. Une autre mère ouvre la lourde. C’est la maman de Benjamin. Explicitement, Moun balance mon problème. L’autre mère convie sans hésiter son fils à me rapporter sur le champ toutes les Majorette qu’il m’avait emprunté.
Sur ce coup, je sais que, sans l’intervention de maman, jamais mes petits jouets à quatre roues ne seraient revenus s’asseoir sur ma belle moquette écarlate.
En peu de temps, j’avais découvert quelques facettes macabres de l’idiosyncrasie humaine. L’animal était intimidateur, moqueur, voleur et violeur. Ces modèles représentaient-ils donc vraiment le monde des grandes personnes, le den (l’homme moderne en breton) ? Nos prairies étaient-elle donc ce champ de ronces ?
C’était pourtant sur ces terres que j’avais appris à faire du vélo. Déçu et blessé, j’ai cru un instant, déjà, pouvoir réinventer l’espèce humaine tout comme ce projet non rocambolesque de notre médecine génétiques actuelles.
Aujourd’hui, je compare facilement l’espèce humaine à un vieux puits de campagne. La paroi du puits, c’est l’enveloppe corporelle de l’homme. La terre ou les roches l’encerclant sont les croyances établies et les traditions de l’homme.
Le puits est ancré dans ses terres, asphyxié, serré.
L’eau au fond du puits, c’est le savoir et l’intelligence de l’homme. Qu’il y ait une réserve d’eau ou un lit asséché, les croyances et les traditions sont pour l’espèce humaine une barrière à son épanouissement.
Ceci est MA vérité. Tout comme la musique et le miroir sont pour moi mon église.
L’église est un espace pour se recueillir et pour rencontrer les gens de son village ou de son quartier. Qui n’a jamais écouté de la musique quand tout ne va pas et n’est-elle pas un moyen pour communiquer avec les gens d’une autre langue ? Qui ne sait jamais regardé dans une glace pour reprendre confiance quand tout ne va pas ?
Et ne dit-on pas avoir la conscience tranquille quand on peut se regarder dans un miroir ?
La vraie vérité est en chacun de nous.
Téméraire, je me suis engouffré un dimanche après-midi dans le parking souterrain de notre immeuble, une haute tour de vingt deux étages. La galerie du parking est sombre et lugubre. Le plafond gris, le parterre tacheté de noir, tâches d’huiles et de caoutchoucs usés, et les murs tagués ajouté à l’odeur âcre et d’humidité ont terrassé mon petit gabarit.
Au centre de cette allée centrale, j’ai eu un bref moment de solitude englouti par la lourdeur neutralisante du milieu. C’est sûr, cet endroit n’est pas fait pour moi.
Paolo et Moun avaient raison. D’ailleurs, ils m’en avaient interdit l’accès me prévenant d’une lourde punition s’il m’y prenait à l’intérieur.
Il fallait sortir de ce trou maintenant. Dehors, j’étais tout penaud pour avoir enfreint la loi de mes parents. Mais l’enfance brave les interdits, c’est bien connu.
L’apprentissage est une expérience qui forme la particularité de chacun.
Maman m’avait appris plus tôt à ne pas prendre tout pour une vérité.
- Andy, ne crois pas tout ce que l’on te dit avec certitude.
Paolo et Moun ont fait de nouvelles rencontres. Ce couple habite dans une vieille maison à colombage dans le vieux Vannes.
Au premier étage, un seul long couloir traverse l’appartement tout comme la colonne vertébrale maintient la tête et les quatre membres. Celui-ci est parsemé de portes donnant accès à la cuisine, au salon et au séjour, au petit coin et à la salle de bain, aux chambres.
Je me souviens des trois ou quatre paires de pieds entremêlés débordant au bout du lit sous le drap blanc. Ce poster est affiché dans le water-closet faisant office aussi de salle de bain.
Dans la cuisine, la fraicheur du fenouil et des autres légumes frais ont titillé souvent mes fosses nasales. Les parfums d’Orient tels que les paprikas, les curry ou les épices d’autres horizons, je m’en souviens encore.
Marie-Paulette sait cuisiner. Ses préparations culinaires valaient autant celles des grands chefs parisiens d’hier et d’aujourd’hui.
Au rez-de-chaussée, il y a le salon de coiffure. C’est Édouard qui coupe. Édouard, c’est le coiffeur de renom du pays vannetais. C’est aussi le mari de Marie-Paulette. C’est comme ça que maman a rencontré Édouard et sa femme à l’accueil du salon.
Édouard ne coiffe que les dames.
La vitrine du salon à pignon sur une rue piétonne au pied d’une des plus vieilles portes de la ville close. La porte Prison. Au Moyen Âge, elle s’appelait la porte Saint-Patern. Patern, le père de la Bretagne. Le cul de la cathédrale Saint-Pierre n’est pas très loin.
En plus d’être un coiffeur de renom, Édouard est un grand joueur de tarot. C’est un costaud, il se bouffe plusieurs championnats partout en France.
Au fil des nuits, des parties de tarot se sont succédées autour de la table ronde dans le salon au premier étage. Le tarot, c’est un jeu de cartes pour grande personne.
Je dormais sur le tapis au pied de la chaise de maman. Comme ça, je voyais les pieds de maman et ceux des autres. Ceux de la table ronde sont fixes et impénétrables.
Édouard et Marie-Paulette De La Jacques Dubois Fleuri ont un chien, c’est un vieux labrador. Son manteau est fauve.
Sous la table ronde, il dort souvent à côté de moi.
Un jour, il est mort. Je n’avais donc plus de compagnon sous la table ronde. Maman me proposa de dormir dans un lit d’appoint dans la chambre du fils des De La Jacques Dubois Fleuri, au fond du couloir. C’est un long couloir, étroit et grinçant.
Pascal a mon âge.
Je dors toujours sur le tapis. Je trouvais ce tapis carrément moins agressif optiquement que ma moquette sanguine.
Pascal m’a proposé de dormir avec lui dans son lit. J’avais trouvé cela bizarre. C'est un grand lit d’adulte où l’on peut caser huit garnements de notre taille comme des maquereaux ou des sardines confinés dans leur boîte de conserve. J’ai refusé.
Dans un coin de sa chambre, j’ai dormi une seul fois dans le lit d’appoint.
Maman se bronze le dos, les mollets et bien sûr la plante des pieds. On oublie toujours la plante des pieds. Maman et moi sommes sur la plage. Nous sommes à trois pas du Château de Suscinio. Ce château se trouve à vingt sept kilomètres de Vannes tout près de Sarzeau sur la presqu’île de Rhuys.
Le Golfe du Morbihan n’est pas loin.
Moun se retourne. Je la trouve super jolie avec son bikini blanc, rose et orange. Son bikini, il est tout blanc avec des grosses fleurs aux pétales roses fuchsias et aux pistils orangés.
Malgré ses tous petits seins, le corps de maman est un corps à désirer ou à prendre.
Pas loin d’elle, je me permets la reconstitution des grands architectes d’hier, essayant en sable la reconstruction de l’ancienne résidence secondaire des Ducs de Bretagne.
D’un coup d’œil averti, je vérifie la couleur cuivré de l’épiderme maternelle. Moun pourrait s’endormir au soleil et je n’aimerais pas qu’elle se cuise les cuisses et les fesses.
Lâchant mes pelles, mon sceau et mon beau château de sable, je m’assieds sur le talus au sommet de la plage près d’un vieil épineux. À l’image des vieux cheveux gris des vieillards centenaires, le tronc de l’arbre est comme métallisé et grisonnant. L’arbre a de belles racines au pied de son tronc majestueux.
De loin, je couronne mon beau palais fait de sable. Ma forteresse est bien montée.
D’ici, il est doux et agréable de mater toutes ces formes des fessiers et des seins si bien arrondis de ces femelles exquises, toutes désirables.
Au loin, il y a le flux et le reflux de l’océan bleu, blanc et vert.
Le soleil brille au zénith.
Quand, bien absorbé par cette carte postale, deux gaillards en costard et cravate à peine plus âgés que moi, deux ou trois ans tout au plus, me poussent sur l’épaule.
Ils m’affirment sans preuve ce lieu comme un bout de terre leur appartenant :
- Ce lieu est à nous, tires-toi de là, sinon on te fait une tête au carré.
Je sais que je n’ai aucune chance devant ces deux vilains garçons. C’est une évidence. Ils sont deux. Du coup, j’ai rejoins maman et ma belle forteresse la queue entre les jambes. Mon maillot de bain camouflait mon ridicule.
Je n’étais pas courageux devant l’agressivité. Aujourd’hui encore.
Selon moi, l’agressivité n’a jamais été un moyen de communication à proprement parlé. D’ailleurs, je ne me suis pour ainsi dire jamais battu depuis. Et puis devant les cons, il vaut mieux se taire. Ils ne nous apportent rien, sinon que de la fierté pour soi-même d’être moins con qu’eux.
Dans un début d’après-midi d’automne, nous sommes partis à la campagne à la cueillette de champignon dans les champs. Avec Pascal et Pascale, la sœur de Pascal à peine plus âgé que lui, nous courions dans les champs.
Quelle joie de courir à tout va dans les prés.
Pendant ce temps, Marie-Paulette et Moun, elles, se cassaient le dos à chercher les champignons cachés en dessous les feuilles mortes couleurs ocres jaunes et ocres rouges. Soudain, les deux mamans nous appellent fortement. Pas beaucoup de champignons. On monte dans la voiture. On change de coin.
On redescend du carrosse. Plus loin, au bord d’un talus, Pascal, Pascale et moi escaladons et tournions autour de jeunes feuillus. Marie-Paulette et Moun, elles, ont repris la cueillette sous les chênes d’un autre talus du champ pour dénicher espérons-le les fameux cèpes de Bordeaux.
Le cèpe est un basidiomycète du genre bolet. Marie-Paulette et Moun débusqueront-elles aussi les quelques girolles jaunes orangés si estimées ?
Soudain les deux mamans nous font des signes alarmants avec leurs bras. Les deux ont l’air affolé. Les vaches, loin dans le champ, ne sont finalement pas des vaches.
Non.
Ce ne sont pas des vaches.
Nous avions pénétrés à notre insu le territoire d’un troupeau de taureaux. La situation devenait alors des plus incertaines. Notre position, moi, Pascal et Pascale, devenait du coup très dangereuse. Nous avions deux cents deux mètres à faire pour sortir de ce pétrin avant que les bestiaux cornus nous rattrapent. Les bêtes étaient déjà élancées. Elles avaient commencé leurs courses bien avant nous. Pour nous, trois bambinos hauts comme trois pommes, le sprint était des plus délicats sur ce terrain qui ne ressemblait pas franchement à celui d’un circuit olympique les plus plats.
Les bêtes nous rattrapent.
Un instant pendant la course, j’ai pensé à ma chair pris au piège sous une tonne de viande rouge et martelée de coup de sabot me piétinant. Je me retourne. Je me retourne à gauche pour mater Pascal. Il est sain mais pas encore sauf. Sa sœur est devant moi.
Les taureaux sont tout près maintenant.
J’aspire vivement à sauver mon âme et mon corps. Il ne faut pas tomber. D’un œil, je lorgne derrière moi. Un taureau me fixe. J’ai vu ses petits yeux. Noirs. J’ai senti son souffle sur mon épaule et l’odeur fauve de l’animal.
Il cavale.
Entre son museau et moi trois mètres nous séparent. La machine à concasser est toute proche. J’imagine le pire maintenant. Pourtant, dans le chahut de ces milles sabots, la chance est encore au rendez-vous. La bête a changé subitement de chemin bifurquant enfin sur les cris et les hurlements de nos deux mamans affolées qui ont dû voir perdre leurs trois rejetons.
Encore une seconde et l’animal me broyait.
Il était si proche de moi.
Cependant d’autres taureaux cavalent derrière nous. Le périple n’est pas terminé. Pascal me scotche derrière mais est-il toujours en vie ? Moi, j’ai encore vingt et un mètres à faire. La course est bientôt finie. Pascale est sortie du pré. Enfin, les deux nourricières nous rassurent. Leurs bras nous enveloppent.
Derrière le talus, je regarde une dernière fois ces bêtes qui ont failli nous mettre en bouillie.
Nous changeons de prés.
Pascal est fan de la plantureuse et divine Marilyn Monroe.
Moi, je préfère Mireille Darc. Il faut la contempler dans sa tenue immaculée au large décolleté dorsal dans La Grande Sauterelle avec Alain Delon. Sa robe blanche et collante affirmant délicatement les courbes de son corps met son corps tout entier en valeur, des deux ongles vernis de ses gros orteils aux deux coins de ses lèvres pulpeuses laissant deviner ce sourire tout juste coquin.
La scène est au milieu du film avec Hardy Krüger.
Avec elle, j’aurais aimé faire des cabrioles, caresser ses belles guiboles et gambader avec elle dans les prés voire au mieux dans les dunes perdues au milieu du Sahara algérien.
La naissance de Léonardo
Chapitre 3
J’ai une cousine qui est décédée d’un cancer des os. Elle avait dix sept ans. C’est jeune.
J’ai un seul souvenir d’elle.
J’étais en voiture avec Moun et Paolo, nous arrivions chez ses parents à Crozon dans le Finistère. Pamela descend la rue toute guillerette défilant le trottoir avec une copine.
Maman n’est plus institutrice. Moun est conseillère professionnelle maintenant à l’Agence nationale pour l’emploi.
Jacky est une copine à elle. Elle est parisienne. Jacky vie et travaille à Panam. C’est au cours d’un meeting syndicaliste à Bourges que Jacky et Moun se sont rencontrées.
Jacky est une femme avertie.
Son mari s’appelle Jacquot. Jacquot et Jacky ont un surnom, ce sont les Jakous. Les Jakous ont un fils. Un seul.
Un seul.
Les Jakous ont une maison secondaire à la Baule. La Baule est la station balnéaire des parisiens dans les années soixante-dix.
Les Jakous, les De La Jacques Dubois Fleuri et mes parents sont trois couples épicuriens et festifs.
Le Jameson pour guider l’apéro et les Saint-Émilion pour accompagner les bonnes bouffes ont bon train et bon métro sur des fonds musicaux de disco, de rock-and-roll, de reggae et de jazz.
J’adore Nina Simone, Janis Joplin et Bob Marley.
Maman s’est investie dans le syndicalisme.
Elle est de gauche.
Paolo, lui, ne patauge pas dans la grande sauce syndicaliste.
Les Jakous, les De La Jacques Dubois Fleuri, mes parents et moi séjournèrent plusieurs fois pour les grandes vacances d’été sur l’île d’Houat dans l’archipel des îles du Ponant aux larges des côtes de la pointe de la presqu’île de Quiberon à quelques miles des belles plages belliloises.
Nous faisions tous du camping sauvage sur l’unique longue plage de l’île d’Houat. En breton, Houat, c’est un canard.
Sur l’île, les véhicules sont interdits. Du quai du port unique de l’île d’Houat nous allons sur la plage à pied à travers la lande en gardant le sentier sous nos pieds. Je me souviens de cette étoile de mer couleur brique recueillie sur le quai de départ et oubliée sur le banc du bateau.
Je l’ai contemplé durant toute la traversée.
En culotte courte, le sentier était pour moi difficile à parcourir. Les pics des ronces me déchiraient trop souvent mes genoux ronds et la peau de mes deux petits mollets.
Sur la zone de notre campement favori à l’extrémité de la seule grande plage de l’île d’Houat nous montions directement sur le sable les trois grandes tentes à compartiments. Deux chambres et un salon. Le lieu est sauvage.
Il y a trois tentes. Ce sont les nôtres.
Au loin, séjournent nos seuls microscopiques petits voisins de vacances.
Une tente.
Une seule.
En face de notre bivouac, un gros rocher émerge de l’océan à deux cents trois mètres du rivage. Derrière nous, la lande.
Le décor est fait.
Si j’avais à nommer un petit coin de paradis, c’est ici.
Les grains de sable glissaient et se faufilaient entre mes orteils. Sous mes pieds le sable était mon terrain de jeu. La mer à quarante deux mètres ou à cent trois mètres en fonction des marées nous offrait son invitation pour un bain rafraîchissant.
Cependant, pour les tous petits comme moi, il était formellement interdit de se baigner le matin tant qu’un adulte n’était pas debout.
La patience était de mise.
Derrière notre campement se dressait un très haut talus fabriqué de terre et de sable pailleté de mille deux cents trous. C’était les fenêtres ouvertes des profondes galeries des souris des champs.
Un matin, pour zapper mes baignades interdites, j’ai voulu enfumer les galeries des rongeurs. J’étais l’aventurier Robinson Crusoé sur mon île déserte pour guetter la proie du jour.
Des allumettes volées dans une grosse boîte d’allumettes prise dans un recoin de la cuisinette, du papier journal et des brindilles trouvées là et là ont suffit à m’équiper pour accomplir mon attaque.
Le vent se lève.
Le talus est en flamme. Mais les souris n’ont toujours pas décampé. Affolé, je réveille mes parents pour éteindre l’incendie.
L’ensemble des adultes fourmillent maintenant entre le talus et l’océan. Les bassines, les bouteilles en plastiques et les grandes casseroles sont remplies à raz bord.
Le feu est étouffé. J’ai reçu une belle engueulade.
Belle engueulade.
Sur les grandes ondes France Inter annonçait la météo :
- Sur la Bretagne de belles journées ensoleillées seront accompagnées d’un zeste de zéphyr...
J’imaginais déjà les articles exagérés en première page de la presse écrite et en grand titre pour l’information du jour des journaux télévisés :
- Un jeune garçon a mis le feu volontairement dans les landes sur île d’Houat pour démasquer les renards.
Seulement les galeries des souris des champs n’existaient pas. Ces mille deux cents trous n’étaient que des nids d’hannetons.
Le lendemain matin, ne souhaitant pas à nouveau un autre incendie, je suis allé me baigner seul dans l’océan.
C’était royal.
Les adultes n’étaient pas levés. Quand Zoé, fille d’un libraire qui a pignon sur rue dans l’enceinte de la vieille ville de Vannes et copine aux Jakous, aux De La Jacques Dubois Fleuri et mes parents se pointe vers moi.
Zoé est en vacances avec nous.
Elle a dix sept ans.
Son ossature est solide et sa poitrine est lourde et copieuse.
En descendant la plage pour me rejoindre, elle sautillait, gambadait comme une gazelle avec ses longs cheveux bruns dans le vent.
Zoé a les seins nus.
Dans sa course les seins de Zoé partaient dans tous les sens.
Elle a tout d’alléchant.
Pour moi, cela a été une série d’images vu en accéléré comme sur des cassettes VHS en mode lecture rapide.
À ce moment là, au lieu de me baigner dans les vagues, j’aurai aimé courir vers elle pour soulager et soutenir ce grand balancement chaotique de ses deux gros ballons. Mais j’étais dans l’océan bleu, vert et blanc.
Blanc avec l’écume.
Mes petites prunelles vertes se sont fixées sur ces deux gros nichons.
Elle s’approche de moi.
Elle est grande.
Maintenant, je suis partagé entre l’envie de lui poser délicatement une main sur le creux de ses hanches ou de me frotter contre elle pour bien sentir ses grosses mamelles sur mon poitrail.
Mais pour ne pas avoir attendu un adulte debout pour me baigner je crains les remontrances.
Et Zoé me dit :
- Bonjour Andy !
Je lui réponds :
- Bonjour Zoé.
J’ai senti un de ses tétins effleurer ma peau douce.
Peut-être ai-je rougi ?
Elle s’éloignait de moi maintenant pour se taper quelques brasses. Elle ne me dit point mot sévère ni point mot non plus à mes parents pour ce bain en solo interdit.
J’avais trouvé Zoé vachement cool.
L’été se termine. Sur la route, Paolo a trouvé un chien égaré. Gris-gris.
L’automne et l’hiver passent.
Maman est enceinte. Moun accouche à l’hôpital de Vannes.
Léonardo vient de naître.
Précisément soixante et un mille cinq cent soixante six heures nous séparent.
Le lendemain de l’accouchement nous étions en famille dans la chambre de l’hôpital. Paolo me donne les clés de la voiture. Il me demande de sortir le cabot. Le chien est dans la voiture.
J’ai sorti le chien. Pas longtemps. J’ai remis Gris-gris dans la voiture. En revenant Paolo et moi constations les dégâts. La bestiole avait déchiqueté tous les fauteuils en cuir de la voiture.
C’est une coupée sportive jaune moutarde. Une petite BMW.
Paolo n’était pas content du désastre. Il pouvait l’être.
Paolo m’a engueulé vivement comme un chien ne croyant pas que j’avais sorti Gris-gris.
Paolo pouvait avoir raison de me corriger mais j’avais pourtant sorti le chien. Certes pas très longtemps.
Cinq jours plus tard, maman sortait de l’hôpital.
Léonardo est né dix jours après mon anniversaire, onze jours après le décès de Georges Pompidou, Président de la République française.
Je suis avec Paolo dans la voiture sur le chemin du scrutin justement. Le feu est rouge. Dans un carrefour, je me souviens de Paolo lorgnant la dégaine d’un passant aux cheveux longs.
Le jeune homme avait l’allure d’un trainé un peu efféminé, la tête noire et frisée. De la fenêtre de sa voiture, Paolo jugeait-il le faignant drogué, le joint au bec, ou jugeait-il l’homosexualité soupçonné du garçon ?
Le bulletin de Paolo déposé dans l’urne, nous sommes retournés à la maison. Un arrêt dans une boulangerie-pâtisserie. Il ne faudrait pas oublier le corps du Christ en ce jour dominical. Paolo n’est pourtant pas croyant.
Moun ne pratique pas sa religion non plus mais maman croit en quelque chose.
Sur le chemin du retour, j’imaginais Paolo avoir voté le politicien, candidat à l’élection, aussi homophobe que lui.
Supprimerait-il aussi ces gens porteurs de pantalons à pattes d’éléphant rayures bleues, jaunes et marron aux chemises blanches à fleurs roses, orange et violettes ?
Le dimanche 19 mai 1974, Valérie Giscard d’Estaing est élu Président de la République.
Deux mois passent.
Moun est sortie s’acheter des cigarettes. Deux paquets de Gitane. Elle me laisse à la maison avec Léonardo dans les bras en bonne assise dans le creux du canapé. J’ai mon frère sur les genoux.
À son retour, Léonardo et moi pleurions à plein sanglots. Mon frère s’était mis à pleurer et ne sachant quoi faire pour le soigner, j’ai pleuré aussi de toutes mes larmes.
En colère contre elle pour m’avoir laissé tout seul avec Léonardo, je suis parti bouder dans ma chambre.
Durant la nuit, un crustacé s’est glissé sous mes couvertures. Il longe la bordure de mon lit. Aux aguets ce monstre aquatique se dresse maintenant dans un coin du fond de mon pieu.
Je flippe.
Mes orteils sont en danger.
J’ai crié :
- Au secours...
Une partie de mes draps ont été mouillés avec le homard trempé. Je ne veux pas être coupable de ce dommage.
Le crustacé armé de ses deux grosses pinces aux pointes menaçantes et noires a sa carapace ocre, orangée et presque rouge. Des reflets brillant aux nuances bleues et noires.
Moun accourut me sauvant à temps de ce combattant imaginaire.
C’était un mauvais rêve. Il était bientôt l’heure de se lever. Je déjeune. Un chocolat chaud. Un pain beurre demi-sel. Un jus d’orange. Un fruit. Un fromage suisse.
Salle de bain.
Parka gris.
« Shoes » bien serrées.
Sac d’école sur le dos.
Maman me lança dehors avec énergie. Une grosse bise sur chaque pommette. J’ai huit minutes à faire à pied pour rejoindre mon école.
Commentaires
1. sandie le 11-04-2011 à 12:41:32 (site)
Non mais c'est quoi cette histoire t'écris des nouvelles maintenant ????
j'ai lu le chapitre 3 malgré la première phrase peut engageante, c'est drôle, plein de fraîcheur, de candeur, un style d'écriture que j'aime, je vais devoir me soumettre à une séance de rattrapage c malin !!
2. xmissbzh le 11-04-2011 à 13:05:30 (site)
désolé sandie... merci pour tes compliments. Pas facile de se mettre à nu. Tu devrais lire la préface, le premier et deuxième chapitre. La suite dans les prochains jours... Je t'embrass. à+
3. sandie le 12-04-2011 à 15:08:33 (site)
c'est marrant celà éveille en moi des saveurs et des souvenirs enfantins que j'imaginais avoir perdu...Merci je continuerai à te lire.
bises
4. xmissbzh le 12-04-2011 à 16:53:05 (site)
bonjour sandie,
comment vas-tu? As-tu lu la préface, le premier et deuxième chapitre?
Heureux que mon écriture te plaise et qu'elle te rapelle des souvenirs juvéniles.
Je viens de mettre en ligne le quatrième chapitre. Je te souhaite donc un bon voyage dans mon histoire de vie.
à bientôt. biz
5. sandie le 13-04-2011 à 15:57:01 (site)
Vas bien !
oh que oui g tout lu le 4 aussi !! soudain me sont revenu à moi aussi les week end mise en bouteille,les étiquettes collées avec un mélange de farine et d'eau, Grand père arrosant copieusement sa soupe, les week end de ripaille autour d'un pauvre cochon dépecé et le p'tit voisin d'en face qui en pinçait pour moi...parti lui aussi trop vite, trop tot !
6. xmissbzh le 14-04-2011 à 12:51:50 (site)
eh bien que de point commun... je pensais être privilégié avec ces bains de sang énivrant, c malin. je lance donc le cinquième chapitre ce jour (absent hier) après ce commentaire obligé (priorité au fan club)... lol
je t'embrass. à+
7. xmissbzh le 25-04-2011 à 19:16:24 (site)
alors mademoiselle sandie, as-tu continué les autres chapitres?...
dit-moi, maintenant que tu me connais un peu, peux-tu me dire quel est ton paragraphe ou la phrase préféré de ce que tu as lu de mon autobiographie?
en réponse, je te citerai mon passage préféré.
je t'embrasse.
... à+
8. sandie le 26-04-2011 à 12:46:24 (site)
Mon bon Monsieur Andy...tu publies plus vite que je ne lis lol !
9. xmissbzh le 27-04-2011 à 14:11:45 (site)
ah bon dommage... je te pensais lectrice assidue. Aussi, je pensais publier le 8ème chapitre ce jour. Devrais-je attendre? Non.
Le devoir m'appelle.
à bientôt. bye. à+
10. sandie le 27-04-2011 à 15:45:11 (site)
J'ai rattrapé mon retard pas plus tard qu'hier soir...moi aussi j'ai un devoir qui m'appelle il a 5 ans et fait des guirlandes de poissons lol
....hop hop hop allez chapitre 8-9-12... je repasse vite
a+
11. sandie le 27-04-2011 à 22:17:45 (site)
C'est difficile ce que tu me demandes là...c'est comme prendre un seul chocolat dans la boite de l'ambassadeur ... dans ce chapitre ci, le homard m'a fait rire mais au faite était-ce vraiment un homard ???...Dans le 5 Moun un fusil à la main, le silence, l'inquiètude qui ont suivi m'ont beaucoup touché...Ces deux nuits torrides avec Olga m'ont fait pensé a un été 57 d'Alain Fleischer...et puis le passage du pipi culotte je me suis revue à 6 ans en culotte dans une salle de classe au côté d'un garçon en slip lui aussi, attendant qu'on me revêtisse d'un affreux pantalon jaune moutarde, sec certe, mais jaune moutarde quand même trop la honte lol...tu vois beaucoup trop à dire alors je mange tout les chocolats autour d'un bon whisky !!
12. xmissbzh le 28-04-2011 à 12:26:33 (site)
bonjour sandie,
pour ce qui est du chocolat, il y a les pyrénées aussi. Miam, miam... tout est bon à prendre, c'est comme du cochon.
Pour le homard, c'était peut-être une langouste, dans tout les cas c'était bien plus gros qu'une langoustine, ça c'est sûr. Merde, le lit est encore trempé...
Olga, pour la copine de ma mère, elle méritait le détour sur sa place rouge. et le crustacé n'était point là pour tremper les draps. tout va bien.
Quelle affreux pantalon jaune moutarde... bouh !!
Le neuf est à paraître bientôt, je le retravaille avant de le publier... dure tâch !!
Ainsi tu pourras continuer à te régaler de pyrénées ou d'ambassadeur devant un bon jameson... glaçon avec ?!
Sinon, en ce qui me concerne, j'aime le passage avec les deux étudiantes et le paragraphe qui suit avec la moquette sanguine et le volcan. que de rouge...
La soupe de poisson de Moun n'est pas mal non plus...
à+
édité le 28-04-2011 à 12:28:42
13. sandie le 03-05-2011 à 18:49:30 (site)
la soupe de Moun c'est vrai !! elle venait à la suite...
Oui avec glaçon mais plutôt un JD alors !
14. xmissbzh le 04-05-2011 à 14:49:17 (site)
le JD, je te l'offre quand tu veux...
combien de glaçon?
pur, coca, breizh-cola?
à+
(j'ai du édité, j'avais oublié le H en final de breiz... bouh!)
édité le 04-05-2011 à 14:58:25
15. sandie le 04-05-2011 à 16:46:15 (site)
La perfection n'est pas de ce monde...Alors édit !!
J'aime les deux avec ou sans cola, je ne savais pas que comme la corse vous aviez votre coca, j'irai me coucher moins idiote mais avec grand soif...en chronopost le JD STP !!
A+
16. xmissbzh le 04-05-2011 à 22:49:24 (site)
ben moi non plus je mourrais moins bête... le cola corse, connaissais point.
pour info, le slogan de la marque c'est :
"le cola du phare ouest".
pour celui qui a de la jugeote, je trouve le jeu de mot très bien vu (deuxième jeu de mot)... je me surprends parfois, ça va les chevilles reste en place.
pour le JD, ça aurai été plus sympa à deux sur une terrasse d'un café corse ou d'une plage bretonne...
je t'embrasse. à+
La soupe de poisson
Chapitre 4
Mes parents ont vendu notre appartement de Vannes, je n’ai plus mes huit minutes à faire pour aller à l’école en guibolles. Nous avons déménagé pendant les grandes vacances. Tous les quatre habitons maintenant Larmor-Plage.
Larmor-Plage c’est la station balnéaire de Lorient.
C’est.
Sur l’autre trottoir de la rue où nous avons aménagé, rue du Petit phare, il y a le Camping du Petit phare. De l’autre côté du terrain aménagé pour les campeurs, il y a effectivement un petit phare.
Il est tout blanc et le chapeau rouge vif. Je le vois de la fenêtre de ma chambre. J’ai su en arrivant que ce camping aurait été un sublime terrain de jeu pour moi en dehors de la période estivale.
C’est sûr, j’aurai l’occasion de rencontrer les week-ends les autres gamins du quartier.
Paolo a changé de travail. Il est maintenant agent immobilier dans une petite agence.
Son patron roule en porche rouge.
J’étais assez fier de mon père de le voir responsable de son agence.
La boîte mère se trouve à Brest.
C’est encore l’été et les rayons du soleil frappent le canapé ocre rouge du salon. Je suis assis à côté de Zoé, la fille du libraire vannetais.
La fille est en week-end chez mes parents. En lorgnant son décolleté, à côté de moi, les images saccadées de Zoé avec sa poitrine nue déambulant sur la plage de l’île d’Houat refaisaient surface. Je me rappelais avoir senti un de ses durs mamelons sur moi. Ses pléthoriques nibars m’interpellent toujours et toujours. La vue appétissante sur cette faille profonde et presque secrète de son décolleté m’engloutisse désespérément dans un langoureux désir.
Lui caresser les seins.
Je suis toujours habillé à côté d’elle dans le canapé du salon.
Ne rien faire accélère subitement mon rythme cardiaque. Le tempo et les tempi des battements de mon cœur deviennent vite chaotiques.
Je suis trop gourmand.
Zoé transpire. C’est l’été.
Discrètement, ma petite main se faufile. Ma petite main est passée entre ces deux gros ballons. C’est chaud comme deux croissants encore chauds.
J’aurai aimé poser mes doigts sur le mamelon d’un sein. Le monticule d’un mont pour atteindre mon objectif. J’aurai pu m’attarder sur les détails de l'aréole puis du tétin pour mieux le titiller.
Mais Zoé, plus rapide, est intervenue. Sa main a rattrapé et stoppé radicalement mon élan.
- Tu es un coquin ! Qu’elle me lance.
Elle me retira la main.
J’étais vexé.
J’aurais aimé être un grand à ce moment là pour avoir le droit de continuer à toucher sa peau et ses formes. J’étais malheureux. Une conquête entière de ce corps féminin que j’avais imaginé plausible dans ma course m’échappait.
Aussi je savais que ma raison de vivre était maintenant de grandir au plus vite pour découvrir ce temple.
J’imaginais le con magique.
Aussi, attiré par le genre féminin, je voyais mon contraire comme un corps à ausculter.
À croire mon comportement, nous pourrions imaginer que j’étais guéri de mes attouchements. Pourtant j’ai pleuré devant le portail de ma nouvelle école, Notre Dame de la clarté, le jour de la rentrée des classes.
Le chemin du douanier sépare la plage de ma nouvelle école.
Je craignais effectivement de manière inconsciente que l’on me touche une nouvelle fois.
Une maîtresse de l'école, c’est une copine à mon père, me rassura rapidement dans ses bras.
Maman devait me laisser pour ne pas être à la bourre à son travail.
Curieusement, j’avais sympathisé rapidement avec deux de mes camarades de classe, Éric et Agnès. En première année du primaire, les week-ends, Agnès et moi allions régulièrement chez Éric.
Au premier jour d’école, j’avais remarqué Agnès parmi toutes les autres bouilles féminines de la classe.
J’étais tombé amoureux véritablement.
Le week-end, nous passions une partie de notre samedi après-midi dans la chambre d’Éric. Parfois on jouait dehors sur la plage devant chez Éric.
Du bureau privé du père de Éric, au premier étage, nous avions une vue approchée sur la citadelle de Port-Louis, de l’autre côté de la rade avec la longue-vue. Nous pouvions aussi regarder de près les voiliers qui sortaient de la rade ou qui rentraient au port.
La chambre d’Éric est au rez-de-chaussée. La pièce est étirée. La porte-fenêtre s’ouvre sur le jardin.
Nous jouions parfois tous les trois au papa et à la maman.
À ce jeu, Éric jouait toujours le rôle du père. Pour prétexter ses heures de labeur, il jouait seul dans le jardin ou dans sa chambre.
La règle de la hiérarchie familiale n’encourageait-t-il pas le mari à apporter le beurre pour vivre, boire et manger ?
C’est toujours moi qui jouais le rôle du bambino. Je singeais donc l’enfant sans trop de peine aux pieds des chevilles d’Agnès dans une studette destinée aux convives des vieux de Éric. C’est une annexe aménagée derrière la maison principale.
Ce lieu nous rend bien service. Nous l’avions aménagé comme notre foyer pour le jeu.
Comme dans un cocon, durant les grandes vacances, après une année de pusillanimité, enrobée quand même de délicatesse et de galanterie timide, je m’étais enfin décidé à déclarer mon amour.
Seul tous les deux, je trouvais la situation facile pour séduire Agnès. Mais elle refusa mes avances. Pour toujours.
C’est elle qui me la dit.
Ne faillant pas à ma fierté, j’ai essayé à ne pas dévoiler mon chagrin.
Doucement, j’ai glissé dans une décrépitude mentale. J’avais perdu l’envie d’apprendre. C’est pourquoi mes notes qui suivirent en deuxième année du primaire furent catastrophiques.
J’étais déjà comme un grand garçon. J’avais imaginé Agnès comme ma femme pour la vie. Un large chiotte turc n’aurait pas suffit pour évacuer toute ma détresse et tout mon désespoir.
Les notes de ma première année avaient pourtant été radieuses. En deuxième année mes notes ont dégringolé de manière prodigieuse.
Aussi, Moun et Paolo m’ont interrogé sur ce gouffre vertigineux :
- Que se passe-t-il à l’école cette année, Andy ?
Impénétrable, j’ai répondu :
- Je ne sais pas. Pourquoi ?
Mes parents, tout les deux :
- Hum...
Moun et Paolo se sont interrogés quelques heures voire plusieurs semaines.
Sans tous les éléments, ils conclurent, finalement, que j’étais devenu jaloux de l’affection de Moun porté sur Léonardo, mon petit frère.
Paolo approuva mais il en n’était pas forcément convaincu. Les conclusions affirmées par Moun étaient de l'astigmatisme.
C’est à ce moment là que j’ai décidé de me couper du monde.
Paolo s’était offert un bateau en bois de sept mètres dix sept de long précisément avec son gros moteur hors-bord de cinq cents chevaux. Je ne compte pas les fusées de détresse obligatoire, les gilets et la bouée de sauvetage en forme de fer à cheval et la corne de brume.
En option, Paolo s’était acheté trois casiers pour remonter des crabes et des araignées, des homards et des langoustes, deux filets de cinquante mètres et six lignes de traîne comprenant dix hameçons chacun.
Le dimanche matin, quand la météo ne permettait pas une sortie en mer avec Laure-Eva, c’est le nom que nous avions attribué à notre barque, Paolo se mettait à table, accoudé à son journal, pour se goinfrer dans le séjour des bonnes et des mauvaises nouvelles de l’Ouest-France.
La table est costaud.
Lorsque midi sonnait dans le séjour, Paolo se tournait devant l’écran de la télévision pour s’empiffrer des bonnes blagues du Petit rapporteur.
L’émission reconnue pour son humour caustique était présentée par Jacques Martin animée par les grands compères de l’époque en passant par Pierre Desproges.
Bienvenue au club et bienvenue à Montcuq.
Montcuq, c’est une petite commune du Lot dans les Midi-Pyrénées. Si vous devez vous y rendre, accompagnez vous de Pierre Desproges. Ce comique se transformera en excellent guide touristique.
Si Paolo regardait avec ferveur Le petit rapporteur, il avait comme émission fétiche L'École des fans.
D’ailleurs, je trouvais cela assez frustrant de voir mon père s’émoustiller avec autant d’enthousiasme devant ces autres gones invités à cette école.
Ils étaient tous autant timides que moi.
J’aurai préféré que Paolo s’occupe de moi et de Léonardo.
Quand certains étaient désinvoltes devant la caméra, j’essayais de me rendre intéressant devant Paolo.
Le hors-bord de cinq cents chevaux fragilisait à haut régime les tympans lors des traversées expéditives pour approcher au plus vite les côtes de l’île de Groix au large de Lorient.
Nous avons ancré une fois le bateau au milieu d’une crique à cinquante deux mètres d’une plage minuscule et déserte. De la terre ferme la plage est difficilement accessible.
Au bord du rivage, la mer était aussi pure et limpide que l’eau de roche.
On pouvait voir distinctement la couleur du sable ocre jaune, des galets blancs et gris, des algues vertes ou marron se faufilant au gré du courant, des petits poissons argentés ou colorés et des crabes rouges, les dormeurs, filant de cache en cache dans les crevasses des gros cailloux et des rochers.
Au retour de Groix, nous mettions le moteur à bas régime pour pêcher à la traîne plein de maquereaux. Il faut tomber sur le banc.
Les maquereaux n’ont pas de vessie de flottaison comme la plus part des autres espèces de poissons. Ils sont donc obligés de se déplacer sans cesse pour ne pas plonger dans les profondeurs.
Cela leurs permettent de garder la ligne.
Et comme tout effort mérite repos et récompense, c’est sur un tapis de sable au fond des abîmes qu’ils hivernent en troupe pour récupérer de leurs inlassables parcours de l’année restante.
Avec leurs chemises grises, bleues, vertes, argentées et rayées d’un noir profond, s’ils n’ont pas encore de sobriquet, je les surnommerais « les zèbres des abysses ».
Leur chair au goût particulier, il est vrai un peu puissant et poivré, en fait un poisson pas souvent apprécié. Pourtant, c’est un poisson délicieux cuit à la poêle au beurre demi-sel et à l’huile d’olive. Sur le vif de la cuisson y mettre le trois quart d’une cuillère à soupe de moutarde de Dijon.
Dans l’assiette, ajoutez un mélange de cinq baies, un peu de fleur de sel de Guérande et un filet de jus de citron vert.
Accompagnez le maquereau suivant votre appétit de deux, trois ou quatre petites pommes de terre nouvelles cuites à l’eau surmontées d’une noix de beurre.
C’est un régal.
En dessert, je vous propose un pamplemousse rose imbibé de miel d’acajou ou de sucre roux gratiné au four. Un délice.
Pour les amateurs de vin rouge, un Domaine L’Aiguelière Coteaux-du-Languedoc Montpeyroux Côte Rousse 2005 pour ce poisson et ce dessert sera parfait.
À cette époque, Moun nous concoctait une authentique ambroisie grâce aux poissons péchés dans les filets de Paolo.
C’est une soupe de poisson au goût très proche d’une bouillabaisse de Provence. Maman utilisait les vieilles et les dormeurs chopés dans les filets et les casiers de Paolo.
En Bretagne, la vieille et le dormeur sont les noms du labre et du tourteau.
Moun gavait le mixeur, une marque allemande. Les vieilles et les dormeurs étaient déjà hachés et broyés grossièrement par les soins de maman. Au cours de la cuisson, le sublime des saveurs, certainement parfumé de safran et d’huile d’olive, fleurait dans toute la maison.
Lorsque le met était servi dans l’assiette creuse ou dans un bol chacun de nous pouvait épicer cette gourmandise de rouille, ailloli aux piments rouges, ou le garnir de croûtons grillés, sautés au beurre, en les bouchonnant à l’ail. Parsemez une poignée de parmesan râpé sur l’ensemble. Incorporez une cuillère à soupe de vin rouge. Pour les adultes, c’est la cerise sur le gâteau. Effet garanti.
C’est ce que l’on appelle mettre du raisin dans son potage.
Tu te régales et tu te tais.
Il y a un monde de silence. C’était tout simplement inexplicablement bon. Ce cocktail de fruit iodé se glissait dans la gorge comme un dessert idéal.
Que dire de plus. Je félicite Paolo pour sa bravoure. Sans les deux filets et ces trois casiers ce truc magique n’aurait jamais vu l’existence dans nos gamelles. Je remercie évidemment ma divine mère pour sa petite sauce dans la cuisine et je salut notre mer chargée de ses fruits si délicieux.
Moun, Paolo, les De La Jacques Dubois Fleuri et les Jakous de Paris sont toujours aussi complices.
Cependant les soirées de parties de tarot sont moins souvent organisées.
Toujours l’alcool aussi festif, nos six acolytes se sont trouvé une nouvelle passion. Cadre dans une agence immobilière et participant à la Foire Exposition de Lorient, Paolo a négocié un marché à bon prix avec un exposant, un viticulteur venu d’Aquitaine.
Tous les étés, nos six complices se font livrer une quantité astronomique de vin bordelais en cubitainers de vingt-cinq litres. Chaque livraison compte six cents à neuf cents litres de bordeaux.
La drôlerie de ce nouveau plaisir, c’est de transvaser le contenant des cubitainers dans les bouteilles encore creuses. Certains de l’équipe ont la tâche fastidieuse de vider les cubitainers.
Les bouteilles se remplissent mais pas qu’elles.
Quelques verres traînent ici et là.
Mon rôle est de placer les bouchons de liège dans une fente de la très lourde boucheuse en fonte. La boucheuse à trois pieds. L’outil a été attrapé chez mon grand-père, Zo.
Zo a été ferrailleur et chiffonnier à une époque de sa vie, après la Deuxième guerre mondiale.
Quand le bouchon est placé dans la fente, maman active de tous ses bras le long manche de l’engin. Le bouchon est ainsi étranglé par les fers de l’engin et se loge sans avis dans la gorge de son nouveau réceptacle. Les bouchons ont été préalablement ramollis dans un seau d’eau la nuit entière.
Après quoi, maman ou moi enlevions avec délicatesse la bouteille assise sur son socle à bascule de la boucheuse. Le retour du socle pouvait casser la bouteille.
La bouteille est prête à être étiquetée.
Quand une cinquantaine de bouteilles avaient leurs bouchons pris dans le goulot nous les étiquetions justement. Il faut les étiqueter.
Les étiquettes sont déjà préencollées. Baignées dans une bassine depuis deux heures pour dessécher leur colle les vignettes sont enfin mûres pour être placardées sur leurs nouvelles pyxides bourrées de sang christique.
Il nous fallait deux jours d’un bon week-end pour transférer tout ce liquide des cubitainers au sein de toutes ces bouteilles.
Le week-end était joyeux.
Après cela, les adultes se chargeaient de remplir le coffre des voitures.
Deux ans plus tard.
Maintenant je connais tous les coins de rue de Larmor-Plage. C’est une cité huppée. Certains commerçants de Lorient ont d’ailleurs construit ou acheté leur nid dans les rues de cette cité.
Le père d’Éric, par exemple, est directeur régional d’une enseigne aux prix très compétitifs. C’est un supermarché.
C’est l’hiver. Durant les vacances de février j’ai été invité à suivre Éric avec ses parents à La Plagne pour l’accompagner. C’est en Savoie dans les Alpes.
La Plagne est une station de sports d’hiver créée en 1961.
La Plagne, c’est une araignée dorée couvert d’un manteau de fourrure.
Tout en haut sur les côtés de la piste verte la neige est poudreuse. Et sur l'initiative d’Éric exigeant nous avons tenté du hors piste.
Une fois.
Après neuf coudées, courte distance, j’avais malencontreusement égaré mon ski gauche. Mes mains sont glacées dans la neige à chercher le ski perdu. Après treize minutes de fouille, nous avons repris la piste.
Fin de matinée.
Maintenant avec les parents, le frère et la sœur nous passons à table. En entrée, une salade verte. Le manche à balai dans le cul, la sœur d’Éric me lance :
- Peux-tu ne pas couper ta salade pour la manger. Tu dois plier la feuille en quatre et la piquer. Tu goberas ensuite la laitue en faisant garde qu’elle ne se déplie pas. Il ne s’agit pas d’arroser de vinaigrette les murs ni tes proches voisins de table, d’ailleurs.
Ironiquement, j’ai pensé :
- Ma belle, surveille ton fessier sinon je vais te les caresser sévèrement avec mes couverts.
Il y a eu un silence dans la salle.
Huit mois ont passé. C’est l’automne.
La Sologne est une région de plaine. Pays parsemé d’étangs, de landes et de belles forêts. La région est prisée pour sa pêche et la chasse à foison.
D’ailleurs la chasse était la passion du père d’Éric et nous y sommes allés, un week-end, en Sologne. Le Range Rover était jaune moutarde tirant sur un jaune caca d’oie.
La route a été longue.
Sur place, le père d’Éric et ses compagnons de chasse allaient à pied dans la nature. Il faut les imaginer habillés en vert kaki, façon militaire, les bottes marron, leurs fusils ouverts et chargés sur l’épaule. Les munitions plaquées sur le ventre, sur le côté et sur le bas du dos.
Croyez-moi, ils n’ont pas l’air franchement de jeunes carabins avec leurs tenues vertes et leurs carabines.
En fin d’après midi, les hommes nous abondaient de leurs milles perdrix grises encore chaudes mais sans vie.
Ce gibier, dit aussi perdrix commune, a une viande forte et poivrée appréciée des connaisseurs.
Il n’y avait point de bartavelle.
Les mères cuisinaient les oiseaux, déplumés avec soin, dans une sauce au poivre et les accompagnaient dans les assiettes de patates sautées ou de pommes de terre cuites à l’eau. Dans la journée, les mères papotaient ou crayonnaient les mots croisés sur le journal du week-end.
Pendant ce temps, Éric et moi devions rester toute la journée aux pénates. On s’ennuyait, Éric et moi, au milieu de tout cela.
Nous étions strictement interdit de jouer tout les deux dehors sur la parcelle du terrain et des alentours pour ne pas être percés malencontreusement par les plombs échappés des fusils des époux ou des autres.
Paolo me conduit en voiture à l’école. Il est inquiet. La tempête a frappé durant toute la nuit. Et Paolo craignait ce que nous allions découvrir ensemble. En milles morceaux, le bateau de Paolo était déchiré sur la plage. La coque ouverte comme une femme césarisée, ici, sur la plage, le moteur noyé dans une flaque d’eau et plus loin le chiotte bel et bien sorti et arraché du ventre de sa mère.
Le carré du bateau était équipé d’un petit chiotte blanc. Carrément pas courant pour une pirogue de ce gabarit.
Le carré a été déchiqueté. Une véritable mise à mort.
Pour la première fois, j’ai vu Paolo dénudé de son armure. Les yeux humides. J’aurai presque dû mettre en boîte, pour garder en souvenir, une de ces larmes embryonnaires dévoilant sa tristesse.
Par contre, son visage, lui, ne cachait pas sa stupeur. Blanc.
Moi, à ce moment, j’ai compris qu’il n’y aurait plus aucunes virées en mer avec le Laure-Eva.
Plus tard dans la journée, en récréation, j’ai pensé inévitablement à toutes ces heures passé sur l’eau quand nous allions, Paolo et moi, poser et remonter les trois casiers et les deux filets.
Je savais que les parties de pêche à la traîne en famille pour pêcher les maquereaux il n’en y aurait plus non plus et Moun ne nous ferait plus jamais ce potage qui exaltait tant la famille et tous les autres amis.
Sur cette plage de Toulhars, en fonction de la météorologie, les élèves se dépensaient scrupuleusement en fonction de l’énergie et de l’exigence de la maîtresse pour exercer les heures d’éducation sportive.
Sur cette plage au soleil.
Après le bateau en bois, un chien à poils courts.
C’est une femelle.
Son manteau est fauve.
Le poil est court.
Le boxer est un chien réputé pour sa force musculaire et son caractère docile avec les enfants.
Un matin, je me suis caché derrière la réserve de vin au fond du garage de la maison. À cet endroit précis, le sol est en terre battue, au fond du garage. Par terre, les insectes grouillent. Une quantité de fourmis, des araignées, trois, quatre, des pinces-oreilles, une famille de quatre membres.
Je m’étais caché derrière la réserve de vin pour sécher les cours de dix heures du matin échappant ainsi à un contrôle de mathématiques.
Je suis au collège depuis un an.
Mon père doit sortir le chien maintenant.
Lili.
Malheureusement, la chienne s’est pointée directement sur la cachette. Ma présence n’avait pas échappé aux fosses nasales de Lili.
Paolo s’approchait aussi pour attraper le chien qui lui désobéissait. Tandis que j’essayais de rebrousser en silence l’élan de la chienne, je feintais mon père au mieux de mes possibilités.
À cet instant, je me suis rappelé que j’avais des toutes petites couilles. Lili retrousse finalement son corps fait de muscles solides. Son museau noir et carré a suivi les appels draconiens du paternel. J’ai bien failli me faire débusquer. Papa était à deux pas de ma cache.
Finalement la chienne est montée à l’arrière de la caisse du vieux Paolo.
C’est l’été.
Nous déménageons de Larmor-Plage pour habiter Ploemeur.
Moun et Paolo ont fait construire une maison contemporaine sur le dernier terrain d’une zone constructible à St-Bieuzy.
St-Bieuzy est un lieu-dit entre la côte et Ploemeur.
Ploemeur caresse les murs de certains immeubles de Lorient. Sur la côte, il y a Lomener. C’est une bourgade de mille six cent cinquante cinq habitants. Elle fait parti de la circonscription de Ploemeur.
St-Bieuzy n’est pas une station balnéaire du tout. Du coup les happy-few ne s'y collent pas du tout ni même ne s’y attardent.
Pour la rentrée des classes je passe en cinquième et je n’aurai plus de car à prendre pour me rendre à l’école.
J’affronterai dorénavant le vent, la pluie en vélo.
Le divorce des parents
Je suis assis sur une chaise à côté de maman face à mon professeur de mathématiques pour suivre la réunion parents-élèves au collège Notre Dame de la Terre. Monsieur le professeur avait été aussi celui de maman. C’est un sage. Un des rares de ce monde. C’est un drame pour notre génération. Complice, le professeur balance à ma mère :
- Moun, pour Andy, un plus un ne font pas forcément deux...
Aujourd’hui, j’aurai répondu à Monsieur le professeur :
- Monsieur, un et un font inéluctablement deux mais cela n’est pas forcément systématique. Observez les mathématiques quantiques...
Notre Dame de la Terre est un collège régenté par une poignée de frères plus ou moins judéo-chrétiens vêtus sobrement de noir.
Il y avait le directeur et les autres. Les surveillants.
En récréation, les filles et les garçons étaient compartimentés. La cour au pied du château servait pour les grands pénis plutôt ingrats et sauvages. La petite cour pour le sexe faible.
À chaque interclasse nous devions nous ranger en silence et dans l’ordre tels les quatre frères de la célèbre bande dessinée. Dans un ordre croissant.
Étions-nous daltoniens ?
Si bien que les garçons profitaient des salles de cours et des couloirs pour flirter les filles. Pour moi, seul le parfum des filles me suffisait dans le courant d’air des corridors.
L’absolutisme était de rigueur.
Au réfectoire aussi.
Un frère assis sur sa chaise haut perché sur l’estrade mangeait devant sa petite table accompagné d’un verre de vin. C’est le sang du christ et le carafon n’est pas loin.
En début de semaine, le frère faisait la quête à qui avait oublié sa serviette. Un sou, c’est un sou.
Quand l’un de nous élevait la voix trop forte, l’élève avait droit au manche à balai. La moitié d’un manche était glissé le long de la peau du dos et des fringues longeant ainsi la rugueuse colonne vertébrale. Le bas du manche était maintenu dans le pantalon. Du coup comme redressement sévère, du zénith au nadir, du cou jusqu’aux vertèbres lombaires, le dos se tenait droit. Mais le manche pouvait être aussi positionné horizontalement au milieu du dos en dehors des vêtements tenu et verrouillé par les deux saignées. La posture devenait alors contraignante pour couper sa viande et pour attraper ces petits pois avec ses quatre dents de la fourchette.
Chaque table avait sa fillette d’eau que l’on abreuvait à volonté au robinet dans un coin de la salle.
En sortie de cantine au gré des envies du curé, nous nous exécutions à une série de dix « Je vous salut Marie » exigé par les boutons de notre chapelet et un « Notre Père qui est aux cieux » dans la toute petite chapelle de l'école située en dessous du réfectoire.
Nous n’avions qu’un étage à descendre.
Des escaliers.
Le professeur de français qui était aussi le seul de musique nous avait imposé tous les concerts de classique au Palais des congrès de la ville de Lorient en influençant efficacement les parents, le directeur et la grappe de curtons.
La vigne n’est pas loin.
Ainsi pour expliquer une absence, il fallait une excuse solidement fiable pour ne pas être gourmandé par le professeur.
Dicté par un frère surveillant, nous pouvions se taper le vendredi soir deux heures de colle en surplus.
En cours, du classique.
Je me suis mangé du Bach et du Beethoven, du Mozart et du Vivaldi durant quatre ans.
Les restrictions étaient sévères en général. Interdit de s’asseoir en récréation, de fumer ou de faire la bise.
Si un des ecclésiastiques de l’école découvrait un élève à réviser ses cours en récréation il lui imposait comme châtiment un tour de cour à cloche pied ou le balayage du parvis de l’entrée du château.
J’ai perdu mon arrière-grand-mère, Morgane. C’est une mère de douze enfants. Morgane s’habillait de noir et portait la coiffe bretonne en broderie blanche.
Elle fumait la pipe.
Le jour de son enterrement, j’ai compris d’un seul coup la fragilité de la vie et la gravité, aussi, de certaines personnes hypocrites.
Les gens sont moches.
Morgane venait de souffler ses quatre vingt seize bougies. Belle âge.
Son mari, mort lui depuis bien longtemps, avait été propriétaire d’une carrière à Cavarno dans le Morbihan entre Gourin et Le Faouët.
Carrière de granit.
Je suis fier de mon arrière-grand-père que je n’ai pas connu mais qui a été tailleur de pierre.
Tous les étés Morgane invitait sa descendance. Nous étions nombreux. Une grande famille. Il y avait les cousins et pleins de cousines. Mais les filles restaient bien trop souvent entre elles.
Parfois, à cause de cela, je me retrouvais seul dans le potager de Morgane. Là, je regardais les filles de loin et j’observais leurs espiègleries. Les peu de cousins étaient soit trop vieux ou bien trop jeunes pour jouer avec moi.
Morgane habitait dans une cabane américaine typique de la région avec ses façades en bois badigeonnées de goudron entre Lorient et Larmor-Plage, à Kermélo.
L’été, par grande chaleur, nous sentions l’odeur empyreumatique bien caractéristique du coaltar et les lézards se cuisaient le ventre sur les parpaings brulants soutenant la baraque noire.
Toute l’année, le bruit ruisselant des voitures se dégageait au loin de la voie rapide.
Moun est avec un carabine à plomb dans le couloir de l’étage invitant quatre fois mon père à ouvrir la porte de la chambre d’ami.
Paolo est resté silencieux.
J’ai entendu deux coups de fusil.
Dans le désespoir on peut-être capable de tout.
Il y a eu un silence après.
Là, j’aurai aimé gifler maman.
Le silence a duré. Je n’ai pas dormi de la nuit jusqu’au potron-minet me posant trois questions scotché dans mon paddock.
Paolo est-il décédé ?
Maman est-elle affalée sur la moquette suintant de rouge ?
Le sang coule-t-il dans la cage d’escalier ?
D’après le verdict du tribunal de grande instance, je savais que Léonardo et moi serions accueillis dans une famille d’accueil ou expédié doucettement chez notre grand-mère.
Ce genre de drame est souvent divulgué à la télévision.
Mais il n’en était rien.
Moun et Paolo sont sains et saufs.
J’ai pensé :
- Ouf ! Le drame ne sera pas diffusé à la télévision et il n’y aura pas de messe à la chapelle de l’école pour le soutien de ma famille abasourdis.
J’ai passé la journée en cours, la tête en confiture.
Parce que maman était désespérée d’être vêtue d'un jaune cocu elle s’était habillée finalement d’un amant.
C’est un pilote de ligne qui adore sa 2 CV.
Raoul passe du temps au bistrot associatif de l’aéro-club de Ploemeur.
J’ai supporté de nombreux apéros.
Maman traînait un peu.
Raoul avait son perroquet ou sa tomate. Le perroquet, c’est un jaune coupé au vert mentholé. La tomate, c’est du 51 avec un fond de sirop de grenadine.
Léonardo et moi avons eu notre baptême de l’air et pour cette occasion notre pilote s’était passé heureusement des deux sirops.
Léonardo et moi étions tous les dimanches chez notre pilote de ligne.
Insupportable.
Pour cela je rêvais de percer les quatre roues de sa 2 CV couleur vert pomme Granny-smith.
Cette pomme a été conçue en 1868 près de Sydney en Australie. C’est un hybride, fruit d’une erreur occasionnée par une vieille dame autochtone.
Je suis assis sur le siège passager avec Paolo au volant de sa voiture. Il me lance :
- Andy, conseille ta mère d’arrêter ses écarts sinon je devrais m’en aller. Loin.
J’ai regardé un instant mon père. Bizarrement, il s’écrasait sur son siège de machiste bien élevé.
J’ai regardé devant moi.
Là, j’ai ressenti une telle légèreté que j’ai cru léviter. Seule la ceinture de sécurité retenait mon corps. La route défile devant moi.
J’ai attendu que mon père retire ses mots.
Rien.
L’habitacle du véhicule transpirait le silence.
La voiture, c’est une Golf noire.
Ainsi les choses se sont passés et plus rien n’était comme avant. Je venais de voler les hautes sardines paternelles.
Des mois ont passé.
Mes parents ont divorcé.
Olga et le Piano blanc
Devant un numéro de la rue Montaigne de Lanester, je suis avec maman et Léonardo.
C’est l’été.
La rue est sans issue. J’observe. Dans la rue, un adolescent et son père. Les maisons clonées sont cubiques avec les toits plats.
Je descends de la voiture.
C’est une Mini de chez Austin. La voiture est rouge grenat.
Le jardin est vert. Moun est en première ligne les clés dans la main.
Elle entre. Léonardo est derrière ses talons.
Je passe le seuil.
Moun nous fait la visite au rez-de-chaussée. Il y a le garage, la cuisine et les chiottes. Le salon et le séjour, une terrasse sur le jardin.
Léonardo et moi sommes montés à l’étage très vite pour choisir nos chambres.
Lanester, c’est la troisième ville du Morbihan après Vannes et Lorient. La ville touche Lorient séparée par le Scorff.
Pour les tamis, le Scorff est une rivière aurifère.
Mais pour celui qui voudrait s’aventurer au chanceux orpailleur qu’il n’espère pas fortune. La richesse sera intérieure.
Pour gagner l’oseille mieux vaut travailler ou jouer au loto pour les faignants. Dans la trame du tamis il est rare de sortir sa paillette d’or. Pas de pépite non plus dans tous ces simples grains de sables fins, gris et dorés.
Ici, on y pèche surtout du poisson. Du saumon et de la truite remontent la source pour le frai.
C’est la rentrée des classes. C’est mon second collège, Notre Dame du Pont. Je redouble ma troisième année.
Des élèves sont assis dans la cour. Les plus avertis des élèves fument leurs clopes.
Je ne fume pas.
Les garçons et les filles se font la bise.
La prison n’existe plus.
Maman est venue me prendre en fin de journée avec la Mini rouge grenat. Elle me demande :
- Alors ?
J’ai répondu de suite :
- C’est trop cool. On peut s’asseoir dans la cour.
- Et puis c’est tout ?
- Une fille m’a fait la bise.
- Ouah ! C’est cool.
Après le divorce des parents, notre père était censé venir nous chercher, moi et Léonardo, tous les quinze jours pour passer les week-ends avec lui et sa blonde.
J'ai attendu.
Le premier week-end.
Le deuxième.
Trois mois sont passés sans nouvelles de Paolo.
Des grenades explosaient dans mes tripes comme dans le cœur d’un bunker. Je souffrais en silence. Mon père avait-il prédit ce que j’avais entendu de sa bouche :
- ... sinon je devrais m’en aller. Loin.
J’ai eu peur de le croiser dans une rue feintant de ne pas me reconnaître.
Paolo aurait-il été capable de nous ignorer ?
Lors des vacances de noël, je n’attendais plus revoir mon père mais j’espérais désespérément un coup de téléphone.
J’ai attendu jusqu’au premier de l’an.
Ce jour particulier, j’ai porté attention au téléphone la journée entière. C’était mon dernier jour.
Depuis cet hiver là, le jour de noël est devenu pour moi un jour comme tous les autres et surtout pour tous les autres.
Dans certaines familles, je trouve que les enfants sont trop largement gâtés à noël et trop souvent généralement de choses inutiles. C’est l’effet du pouvoir occidental fondé sur le mode de la surconsommation. Le système a son influence sur ce monde.
Pour ce noël, je n’avais pas été gâté.
J’ai profité de mes nouvelles rencontres scolaires pour survivre.
En août, je m’étais fait l’idée de façon assez détaché de ne plus jamais revoir Monsieur Paolo quand il réapparut soudainement en téléphonant pour nous prévenir qu’il passait nous chercher dans une heure.
Espérait-il un de mes doux sourires ?
Paolo ne nous a consacré que vingt deux minutes sur le bord de la route près d’un passage à niveau à deux cents cinquante un mètres de la rue Montaigne. Vingt deux minutes. Léonardo et moi n’avions pas vu notre père depuis un an.
Durant son entretien, le paternel accusait notre mère fautive de leur séparation. Et bien sûr il nous a reproché de ne pas l’avoir coudoyé.
Pour moi, c’était le comble.
Monsieur Paolo était parti faire sa seconde vie à Laval dans les bras d’une blonde. Elle travaille dans le milieu pharmaceutique au sein d’une entreprise multinationale.
Monsieur Paolo m’avait prévenu :
- ... sinon je devrais m’en aller. Loin.
Elle est belle la France.
La blonde était une de ses deux longues demoiselles extraconjugales qu’il se farçait avant de solliciter le divorce.
Mais l'histoire de mes parents ne nous regarde pas.
C'est la leur.
Elle est belle la France.
Je suis en pension au lycée Paul Cornu à Lisieux. C’est à moitié chemin entre Cherbourg et Paname. En Normandie. La ville de Caen n’est pas loin. Deauville non plus.
J’y suis pour trois ans préparant un CAP de dessinateur d’exécution en publicité.
L’internat du lycée professionnel fermait la porte tous les week-ends.
Douze heures de train, aller-retour, chaque week-end.
Pas le choix.
Comme cela j’ai connu tous les coins et les recoins des beaux Corail de l’ouest et des petites vilaines michelines régionales.
Maman a une nouvelle amie. Une collègue du boulot. À l’apéro du soir, les deux sont souvent chez l’une ou chez l’autre pour piaffer et refaire notre monde qui est à nous.
Finalement.
Charnelle pourrait-être son adjectif. Olga est blonde d’origine slave. Les yeux bleus.
Elle connaît bien la place Rouge de Moscou et le Kremlin avec ses multiples dômes multicolores mimant de jolies glaces crémeuses.
Olga est une femme.
Elle le sait et moi aussi.
Mais j’étais loin de passer une nuit avec elle. Je n’ai que seize ans. De plus je n’y connaissais rien des nanas. Et puis c’est la copine de maman.
Donc.
Pourtant quand j’empruntais l’escalier du salon de chez Moun pour monter à l’étage je balançais sans relâche mon regard sur le décolleté d’Olga assise avec maman. Olga confortablement prise dans le canapé avait remarqué mon manège.
Entre les deux fêtes de fin d’année j’ai suivi Raoul, notre pilote de ligne, Moun et Olga au Piano blanc. C’est une discothèque à Plouhinec de l’autre côté de la rade de Lorient.
Pour s’y rendre en voiture on doit sauter le Scorff et le Blavet, une autre rivière.
Les deux ponts sont utiles.
Nous sommes restés cinquante six minutes dans la boîte de nuit.
Une heure.
Le temps de boire deux verres.
Au retour du club de nuit notre pilote de ligne m’a déposé chez Olga. Moun s’était endormie devant. Nous avons pris l’ascenseur pour monter chez elle.
Olga et moi avons pris un verre d’eau dans la cuisine et nous nous sommes réfugiés sous les draps de son lit pour se blottir.
Il m’a fallu de la dextérité dans le doigté pour dégrafer son sous-tif.
Je décroche finalement l’agrafe de son soutien-gorge.
Jamais je n’avais encore pris le sein nu d’une fille dans mes mains. Je la caresse, elle me caresse. Olga m’initia aux ébats amoureux me permettant sa prise à plusieurs reprises. Avec rigueur et douceur je l’ai secouée toute la nuit avec tact et brutalité maîtrisée.
J’ai transpiré.
Elle aussi.
Dans l’action Olga a posé un instant le bout de son majeur sur le rebord de mon anus. Cela m’a fait quelque chose.
Au petit matin nous avons pris le petit-déjeuner dans la cuisine.
Café pour tous les deux.
Un jus d’orange et deux Cracotte.
Beurre demi-sel.
Confiture à la framboise.
Olga est allé sous la douche puis nous nous sommes quittés au premier carrefour pas très loin de son appart.
Elle partait rejoindre sa chaise et son bureau.
Trois mois plus tard.
Olga était déjà sous les draps une seconde fois. Assis à côté de ma douce je croque à pleines dents une pomme Granny-smith.
Peureux.
Que pouvait m’apporter l’expérience et la générosité d’Olga ? Je ne suis qu’un jeune encas pour elle.
Après une agape bien arrosé, Olga m’avoua qu’elle avait été figurante dans un film jouant une hôtesse d’accueil dans une administration et que cela lui avait permis de rencontrer Monsieur le grand Patrick Dewaere.
Comédien.
En fin de tournage, elle séduisit Monsieur Dewaere l’invitant avec audace à passer la soirée avec elle. Après avoir bu trois verres dans un bistrot de quartier, elle réussi à terminer la nuit avec lui.
Dans sa loge.
Une caravane.
Olga a couché la nuit avec Monsieur.
Olga n’est pas mythomane.
La classe.
Puéril, mon côté animal m’emporta un instant dans une fierté insoupçonnée.
Olga s’était tapé Monsieur Patrick Dewaere, un de ces grands du Café théâtre de Montparnasse et brillant comédien dans les Valseuses.
J’ai donc été dépucelé par une des conquêtes de Monsieur Patrick Dewaere. La classe.
En révélant mes deux nuits torrides à quelques proches, aucun ne me crurent sur le coup.
l'Ecole des Beaux-arts
Chapitre 7
C’est l’été.
Maman a acheté une maison en résidence à Quéven dans un nouveau lotissement en construction.
Dix mois plus tard.
J’entends mes camarades de classe du lycée Paul Cornu parler des bienfaits du cannabis. Mais comme tout autre produit illicite ou autorisé, c’est un produit à consommer avec modération.
Bien entendu.
Par ailleurs, ceux-ci insistaient sur la toxicité non négligeable du produit en cas de surconsommation.
Un mois passe.
Je suis avec trois potes pour m’enfiler quelques bières caché dans un débarras du dortoir. Connaissant mes alcooliques de l’instant je m’attendais à ce quelqu’un roule un pétard.
Je les avais suivis un peu pour cela d’ailleurs.
Le manque d’affection paternelle m’avait incité à fumer.
Après avoir mangé au réfectoire de l’école, j’ai rejoint la salle d’étude des filles. Elles devaient maquiller les garçons pour la soirée.
Une troupe d’élèves, musiciens en herbe, avait eu l’autorisation du proviseur d’organiser au sein de l’établissement un concert privé pour fêter la fin de l’année scolaire.
Je m’assieds sur une des tables de la salle d’étude pour me faire maquiller.
Mes pieds et mollets sont dans le vide.
Le concert commence.
Les filles et les garçons sont sortis comme un troupeau de gnous traversant le fleuve. Moi je me suis allongé sur la table à moitié maquillé pensant pensé pensif un simple instant. Pas tendu du tout, je suis resté étendu sur la table éveillé pendant près de deux heures.
Quand je suis arrivé dans la salle de télévision organisée à l’occasion en grande salle de concert la pièce se vidait, et tous les internes rejoignaient leurs chambres.
Je n’ai rien vu du concert.
C’était mon premier joint.
Fin juillet.
Je suis à un anniversaire sur Larmor-Plage, cité balnéaire, avec un proche de Quéven, Moustapha.
Moustapha a les cheveux blanc gris, et court.
Moustapha est marocain.
En milieu de soirée nous décidions de sortir en discothèque.
Le Symbole est un vieux moulin au bord d’un étang qui a été réhabilité en dancing à un kilomètre de mon ancien collège, l’école Notre Dame de la Terre.
Il n’y avait pas assez de place dans les carrioles pour transporter tout le monde. Une copine, Moustapha et moi partons en stop.
La copine aura plus de chance seule pour se faire prendre.
Nous préférons la laisser en avant poste.
Moustapha et moi avons marché un kilomètre quand nous nous imaginions déjà continuer le reste du chemin à pied.
Quand une Ami 6 vert olive, une vieille Citroën, se pointa vers nous deux à pas d’escargot.
Le conducteur de l’engin était grand et élancé. Mal rasé, un poil barbu, une queue de cheval.
La trentaine.
Le pilote de l’engin, immatriculé Morbihan, tient une canette de bière à la main. Les deux vitres des portières avant sont grandes ouvertes.
Moustapha s’installe devant.
Moi, je suis monté derrière assis au milieu.
Le belge redémarre sa caisse.
Son accent la trahit malgré son 56 au cul.
Moustapha remonte le pare-soleil devant lui qui se rabattait trop souvent.
On roule toujours. Le belge lui demande :
- Il te dérange le pare-soleil ?
Moustapha un peu inquiet :
- Ben...
Pour reprendre très vite :
- Ben oui ! Un peu...
Le mec a stoppé subitement sa caisse sur onze mètres.
Peut-être treize.
Les pneus ont couinés sur le bitume encore chaud de la journée.
Le mec arracha le rectangle de plastique le jetant par la fenêtre.
Nous repartons à pas d’escargot.
Plus loin un quidam est à pied sur la chaussée dans le sens contraire de notre route.
Moustapha et moi :
- C’est un pote à nous !
Le mec a stoppé son Ami 6 sur onze mètres encore faisant grincer une fois de plus ses quatre caoutchoucs sur le revêtement anthracite.
Notre pote avec sa moto :
- J’ai perdu une pièce du moteur.
Le belge :
- On peut mettre ta moto dans le coffre.
Notre pote :
- Non. L’essence va couler à l’intérieur.
Le belge insiste :
- On va mettre ta moto sur le toit de la voiture, j’ai une corde solide dans mon coffre.
J’interviens :
- Non. Je ne connais pas tes lois du pays, mais en Bretagne, c’est pas possible de charger ton toit sans une galerie adaptée.
Le belge m’a regardé ahuri.
Le pote a repris sa route la moto dans les bras.
Quand à moi et Moustapha, nous avons continué avec le mec décidément attaqué du cerveau.
Qu’avait-il pris en plus de sa bière ?
Un trip ?
Des cachetons ?
Des champignons hallucinogènes bretons ?
Sans même avoir mon permis de conduire, j’ai pensé :
- Je devrais peut-être prendre le volant, une fois.
Nous sommes devant le parking de la discothèque. Le belge s’arrête et nous lance :
- Je vais me taper le panneau de signalisation indiquant le parking !
L’étranger enclenche une marche arrière. Il prend impeccablement le virage serré en forme de coude.
Devant le panneau de signalisation, j’ai pensé :
- Il va pas nous faire ça ?
Cherchant désespérément le regard de Moustapha pour sauter ensemble de l’engin avant les gros dégâts, je mate le panneau encore neuf.
Le mec décidé a lancé sa ferraille sur la tige métallique.
Le pied du panneau a plié.
Dans le parking, je m’attends au pire.
J’ai pensé :
- Il va nous percuter deux ou trois caisses, c’est sûr...
Subitement, j’ai craint notre chauffard capable de taquiner certains véhicules les poussant véritablement dans l’étang.
Mais le mec nous a déposés sagement, innocent même, devant l’entrée du Symbole.
Le belge reprenait-il sa raison ?
Moustapha et moi avons regardé le trentenaire sortir du parking.
Nous nous sommes regardé.
Il me semble que notre pensée était identique.
Le belge est sorti du parking sans incident.
Moi et Moustapha :
- On revient de loin.
Nous sommes fin août.
J’ai obtenu mon permis de conduire.
Je ne me suis pas séant dessus.
C’est l’hiver.
Je prends mon train pour Lorient.
Au Mans, je descends pour ma correspondance quand la voix du haut-parleur m’annonce un changement de quai pour cause de travaux.
Au quai cité, peu de voyageurs.
Après huit minutes, je suis allé chercher des news à l’accueil.
Il n’y avait pas de changement.
J’ai deux heures maintenant à attendre le prochain train en destination de Quimper. La gare de Lorient est sur le chemin.
Réfugié dans une cabine téléphonique vitrée, je téléphone à Moun pour lui prévenir mon retard.
Elle me dit :
- Je laisse la voiture sur le parking de la gare, les clés à l’intérieur de la jante avant côté conducteur.
J’ai dû boire un verre dans un bistrot en face de la gare pour ne pas prendre racine dans le hall.
- Une pression s’il vous plait...
Le barman me sert.
Moi :
- Merci.
Les carreaux de la vitrine du bar sont embués. J’ai passé ma main sur la fenêtre pour regarder les passants dans la rue en me disant certainement que ces gens n’étaient pas très loin de chez eux.
J’ai bu ma bière.
J’ai payé le garçon.
J’ai rejoint le quai.
Le train est là. Moteur éteint. Je monte dans un wagon vérifiant encore la destination dans le couloir de la voiture.
Paris-Auray.
La locomotive et son arrière-train s’arrêtait juste avant Lorient.
J’étais fou.
Un Paris-Auray.
De souvenir de voyageur, je n’avais jamais vu cela. Il était trop tard pour retéléphoner à Moun. Le téléphone portable n’existait pas. Je me suis choisi un compartiment et j’ai attendu Auray.
En face de la gare d’Auray, une boulangerie.
Le boulanger est dehors. Il fume sa clope.
Je lui demande la direction de Lorient.
J’ai marché une heure sans voir un panneau de signalisation quand je suis arrivé finalement à vingt et un mètres de la boulangerie. Devant moi un panneau m’indiquait Lorient dans le sens opposé à celui que m’avait indiqué le con de boulanger. Son pain et ses croissants devaient être certainement très bon, mais sa chair de ses mollets j’aurais aimé la croquer de toutes mes forces comme un chien enragé errant.
J’arrive à un carrefour.
Une nationale.
Il fait nuit.
Froid.
Je m’installe pour faire du stop. Je n’ai pas envie de déranger maman encore une fois.
Lorient est à trente cinq kilomètres d’Auray.
J’ai attendu vingt trois minutes.
Une seule voiture.
Il y a une cabine téléphonique dans un angle du carrefour. Je m’y rends. La température ambiante est en dessous de la barre du zéro.
Moins six degrés Celsius.
Je téléphone.
Mal réveillée, maman me lance :
- Continue à faire du stop, Andy.
J’ai raccroché en furie.
J’ai attendu neuf minutes avant qu’un trente trois tonnes se pointe sans s’arrêter. J’ai dû attraper en vole mes papiers Canson envolés, mes formats raisins, mes calques et mes dessins avec mes pieds et mes mains.
Là, j’ai failli craquer.
Je resserre mon carton à dessin.
Je suis fatigué.
Je retéléphone à Moun.
- Maman...
Elle me coupe :
- Andy, où es-tu ?
- À Auray...
Elle reprend :
- Je viens te chercher.
En attendant son secours, je suis resté dans la cabine pour me protéger du vent sec et froid évitant ainsi les anfractuosités cutanées désagréables.
Dix huit minutes.
J’ai vu deux voitures passer. Une rouge et l’autre était jaune.
Le postier peut-être et les pompiers.
Je vois Moun arriver au loin.
Le feu est vert.
Elle trace. Elle ne s’arrête pas.
Je sors de la cabine téléphonique.
Maman ne me voit pas.
J’étais fou.
Trois fois.
J’ai attendu cinq minutes pour voir Moun revenir.
Je monte dans la voiture.
Soulagé enfin d’avoir trouvé mon moyen de locomotion, j’ai augmenté le chauffage même s’il faisait déjà meilleur dans l’habitacle.
À Quéven, le jour se levait.
Moun s’est arrêtée à une boulangerie.
Une baguette encore chaude et bien croustillante.
Cinq mois.
Je viens d’achever mes trois années d’étude. Mon CAP en poche. En octobre, je rentre à l’École des Beaux-arts de Lorient. Je n’aurai plus ces longues heures de Corail et de rail le week-end.
Mille deux cent soixante trois heures de train.
Entre l’École des Beaux-arts de Lorient et de chez Moun il y aura trente trois minutes de bus deux fois par jour.
Les cours de sculpture, de perspective approfondie, de dessin de nu, de peinture sont nouveaux et passionnant pour moi.
Mon professeur de peinture était Monsieur Georges Le Bayon.
Il y avait des cours d’histoire de l’Art avec Madame Gaillard.
Madame est parisienne.
Je crois que beaucoup de garçon l’appréciait.
En fin d’année, nous devions défendre farouchement notre projet artistique devant les professeurs pour valider nos Unités de Valeur acquis au cours de l’année scolaire.
Fin juillet, j’étais en vacances au Portugal avec Paolo.
Quinze jours.
Au nord de l’Espagne sec et aride, j’ai découvert au loin ce qu’était un troglodyte. Il y en avait plein près de Burgos sur le flan d’une falaise des Monts Cantabriques.
Au nord de Porto, la région est humide et verdoyante comparé au plateau de la Meseta espagnole.
Les maisons et les églises sont recouvertes de faïences blanches et bleues. Spécialité du pays. Nous sommes en villégiature dans une villa typique de la région justement avec ses faïences locales tout plein sur la façade.
Nous nichons à Viana do Castelo près de Porto.
La porte d’entrée est au premier étage.
Un classique portugais.
Une verrière se trouve à l’étage. Elle donne une vue plongeante sur le jardin, derrière, et une vue panoramique splendide sur la vallée. Tout est vert. Une seule villa se détache de ce paysage à trois cents mètres. Le toit est fabriqué de tuiles orange. La construction, façades et pignons, est habillée d’un crépi jaune orangé appliqué à la taloche. C’est une très belle exécution des artisans locaux.
N’oublions pas que les portugais sont de bons ouvriers du bâtiment.
Le benjamin de Paolo, mon demi-frangin de deux ans nommé Wilfried, a avalé un herbicide corrodant son système gastrique. Le désherbant n’est pas commercialisé en France. Mon paternel et sa blonde durent charroyer d’urgence le demi-frangin à l’hôpital de Porto.
Un lavage d’estomac était nécessaire.
Wilfried a été hospitalisé deux jours.
Paulette, la blonde de Paolo, dormait la nuit au chevet de son fils.
Le lendemain de l’accident, Paolo, Léonardo et moi avons mangé une viande rouge, un steak saignant accompagné de patates sautées.
Un peu de sel, du poivre.
De la moutarde de Dijon importée de France.
Du pain. Du beurre.
Une petite pastèque à nous trois pour le dessert.
Paolo s’est pris un café en supplément.
Nous allons rejoindre Paulette et Wilfried. Mais parce que les enfants et les adolescents n’étaient pas autorisés à rentrer au sein de l’hospice au dire de Paolo, celui-ci nous lance :
- Je reviens dans vingt trois minutes. Restez dans la voiture.
Paolo préférait certainement rester seul avec sa blonde. Une complication irréversible n’était pas exclue vu le poison ingurgité par Wilfried.
Finalement notre père nous a laissé poiroter deux heures dans sa ferraille violette.
Devant l’établissement, des taxis jaunes aux toits noirs attendaient là silencieusement en mode stationnaire restant scotchés sur le bord des trottoirs. Les voitures, noires et jaunes, suaient sous la canicule devant les murs et le porche de l’hôtel-Dieu.
Léonardo et moi étions en sueur. La voiture était inondée. Nos pieds trempés. Les quatre vitres des quatre portières sont ouvertes au maximum mais il n’y avait pas de vent.
Pas de vent, pas de courant d’air.
Deux heures passent.
Toujours pas de Paolo.
Léonardo et moi devenions impatients, inquiets et silencieux.
Wilfried avait-il déjà rendu son âme ?
Paolo revient.
Léonardo et moi avions échappé à une insolation.
Le lendemain Paolo est retourné seul à l’hôpital chercher Wilfried et Paulette revenu épuisée par cette lourde épreuve.
Elle avait dû perdre trois kilos.
Au retour du Portugal Paolo m’a déposé chez un ami en Charente-Maritime. Clément est un ancien de Quéven qui a suivi ses parents.
Son père est militaire.
Clément me suit pour monter sur Lorient. Avant de quitter le lieu, nous avons ingurgité comme deux louveteaux affamés un copieux petit-déjeuner.
Banane
Pain beurre.
Jus d’orange.
Yaourt aux fruits.
Une Granny-smith.
Des céréales.
Du lait demi-écrémé.
Café.
Sa mater nous dépose sur la départementale en sortie de Rochefort.
La D137.
Sortie de ville.
Dix heures du matin.
Samedi 1er août 1987.
Dans nos bagages, il y avait fringues et affaires de toilettes. Ma tente canadienne et pas un sou dans la bourse. Une bouteille d’eau minérale. D’après un trajet parcouru deux ans plus tôt entre Lorient et Caen, j’imaginais la Bretagne pour la soirée. J’avais rassuré Clément de part mon expérience.
Après trois quart d’heure sur place nous avançons à pied pour rejoindre l’autoroute.
Les véhicules sont trop chargés pour s’arrêter. Clément et moi dûmes trotter et border le bas-côté. Deux heures sous le soleil. 32 degrés Celsius. L’odeur du bitume mélangé aux gaz des voitures devenait âcre et pénétrant. Le bruit des bolides bruyant. Les lignes blanches discontinu interminables.
Enfin La Rochelle qui a été le plus grand port français d’importation de bois exotique.
Huit heures de stop.
Nous n’avions plus de force pour lever le pouce s’en fatiguer la saignée. Tenir haut le coude devenait difficile.
Notre bouteille d’eau est vide.
Nous avons posé notre bivouac deux heures plus tard à La Roche-sur-Yon autour d’un buis bien taillé derrière un rond-point à l’extérieur de la ville.
Il est 22 heures.
Sur le pignon du bâtiment qui se trouve à côté, un entrepôt, un gigantesque ventilateur de plus de trois mètres de diamètre se déclenchait avec vacarme tout les quarts d’heure. Il tournait bruyamment dix minutes.
Un cri dans la nuit.
Pas dormi.
Le terrain est bosselé.
Au petit jour, Clément et moi avons été pris en stop en deux minutes par une quadragénaire. La chance nous revenait.
La dame aurait certainement aimé nous avoir tous les deux dans son pieu ou dans sa chambre d’hôtel. La dame nous a fait des avances. Mais Clément et moi n’avons pas répondu.
- Vous êtes mignons tous les deux...
J’étais sur le canapé arrière.
J’aurai été assis sur le siège avant, côté passager, je lui aurai mis la main gauche sur sa cuisse. Peut-être. Elle n’était pas vilaine. Je lui aurais pris son séant dans sa voiture caché derrière un buisson en fleur.
Clément aurait pris son petit minou.
Entre La Roche-sur-Yon et Nantes, nous aurions pu trouver un coin désert et tranquille.
La dame nous a déposés à Nantes.
Dommage, j’aurai bien profité de son home, de son pieu et de son corps.
Aussi, nous aurions pu manger chez elle un casse-croûte jambon, beurre, cornichon.
Un thé chez Madame.
Clément et moi avons traversé la ville. Nous évitons les trottoirs ensoleillés. Nous ne sommes plus loin de la déshydratation.
Nous avons attrapé la rocade nord.
Dans une propriété à proximité, les volets sont fermés. Dans le jardin, des abricotiers, des pêchers et des pommiers. Ce ne sont pas des Granny-smith. J’ai volé des fruits pour sauver notre vie et pour guérir notre santé. Les mille fruits ont vite reposés notre poche gastrique en demande.
Une carriole s’arrête pour nous.
Enfin.
Le trentenaire va sur Lorient.
Il y a deux enfants avec lui.
Les siens probablement.
Clément et moi sommes arrivés sur Quéven à 17 heures, le bout du nez et les pommettes brûlées.
Le sucre des fruits avait attaqué nos lèvres au soleil.
Crevasses et gerçures.
Clément est resté chez Moun le temps de la durée du Festival Interceltique de Lorient avant de repartir en Charente-Maritime. Dix jours.
Clément a préféré redescendre en train.
Nous nous ne sommes jamais revu.
Clément voulait être cinéaste.
Fin août.
Je suis parti rejoindre à Sarzeau le frangin de Gérard et toute son équipe. Gérard, c’est un ancien camarade de classe du collège Notre Dame du Pont de Lanester.
Anniversaire.
Vendredi soir.
La soirée se passe sur un terrain boisé sur la presqu’île de Rhuys pas très loin du Château de Suscinio. Nous avons bu. D’autres ont fumé. En milieu de soirée nous partons en boîte.
Moi, je n’étais pas damoiseau, j’ai passé toute la soirée dans un chiotte, la tête dans la cuvette, à genoux.
Le parterre était déjà trempé de pisse et de flotte.
Pas fier.
En rentrant de la boîte de nuit, le frangin de Gérard, Marco, a pincé une autre voiture dans un long virage.
Marco roule en 2 CV.
Elle est verte.
Elle aussi.
La 2 CV n’a pas résisté devant l’autre véhicule plus lourde et qui roulait certainement trop vite. Gérard et moi sommes arrivés six longues minutes après.
Gérard conduisait.
Les urgences ne se sont pointés qu’une heure après.
Une heure trop tard.
Dans les couloirs de l’hôpital de Vannes, je suis tombé dans les pommes après avoir vu la copine de Marco en sang. Son visage couvert de blessures.
Gérard et moi sommes rentrés en fin de matinée sur Lorient.
Le lundi matin, Marco a été transféré en urgence en hélicoptère sur Nantes pour une complication. Marco est mort dans la journée d’une hémorragie interne. Son sang coulait dans ses tripes depuis deux jours.
Pour se rouler une cigarette, un joint peut-être, Marco aurai laissé le volant à sa copine.
Sa copine aurait légèrement débordé sur la ligne blanche.
La ligne blanche est rouge maintenant.
Dans cette affaire, j’ai été certainement considéré comme un poison pour certain.
L’équipe de Marco accueillait rarement d’autres personnes et j’y étais invité pour la première fois. Il y avait des cousins et des amis. Nous sommes dans le pays de Gérard et de sa famille.
Évidemment, je n’y étais pour rien, mais pour certains d’entr'eux, j’ai été l’élément perturbateur de la soirée. Celui qui avait porté la poisse.
Du moins, c’est l’idée que je m’en étais fait.
J’ai gardé cette sensation de culpabilité plusieurs mois.
Huit mois.
Neuf mois peut-être.
Marco venait d’avoir ses vingt et un balais.
Juillet et août 2011.
Mon premier voyage sous trip
Je me tape une cigarette face à la mer. Une blonde. La mer est belle. Verte. Sur mon chemin, une jolie demoiselle, brune.
Je lui souris.
Elle boit un diabolo orgeat sur la terrasse d’un café. Petite table ronde. Elle est seule.
Soudain une averse s’est mise à fracasser le sol avec ses milles gouttes déferlant sur nos têtes. Tout le monde se couvre et s’abrite.
La fille se lève. L’eau ruisselle et glisse sur les courbes de ses seins bien voyant maintenant. Son chemisier blanc est devenu transparent trempé par la pluie.
De belles formes.
Son soutien-gorge est fait de frises en dentelle blanche.
J’adore.
Je devine, de loin, entre les deux enveloppes que l’armature est garnie d’une petite fleur rose et noire.
Je suis déjà amoureux.
Return no limit.
J’ai retrouvé quelques jours plus tard la jolie brune dans un bistrot, à l’Aphrodite-bar, dans lequel je vais le midi pour casser la croûte. La brune est encore autour d’une table ronde.
Amandine a de grands yeux gris.
Ses cheveux sont longs et presque noirs.
C’est une fille qui a du charme avec son long nez à la Cléopâtre.
Quand elle marche, elle donne l’impression de marcher sur le bout de ses orteils comme pour ne pas déranger nos terriens vivant de l’autre côté de la planète verte et bleue.
Amandine parle quatre langues avec perfection alors qu’elle n’a pas encore dix sept ans.
Le français, le mandarin, le cantonais et l’anglais.
Son plus proche ami est sénégalais.
Amandine et le sénégalais se connaisse depuis trois ans.
Elle aurait pu apprendre facilement le peul ou le wolof.
C’est l’occasion pour la flirter.
En fin de soirée, à Pont-Scorff, chez le sénégalais, je l’ai embrassé sous la véranda de la cuisine.
Le samedi 26 mars 1988.
Quelque temps après notre rupture, j’ai appris avec le sénégalais qu’Amandine avait été violée à l’âge de treize ans par un amoureux pas recommandable du tout, du coup.
Le sénégalais et son frère, Henri le bouddha hippopotamesque, sont devenu orphelins. Leur mère est décédée d’une maladie quand ils étaient tous les deux bambins.
Leur père s’est tué il y a peu dans un accident de voiture dans un virage sur la route près du zoo de Pont-Scorff.
Le sénégalais et Henri le bouddha hippopotamesque vivent dans la demeure de leurs parents.
Il soigne leur grand-mère qui les accompagne.
La grand-mère est habillée de noir et porte la coiffe blanche.
Elle est sourde.
Pourtant, on peut entendre le hurlement des loups du zoo de Pont-Scorff de Pont-Scorff à Quéven.
J’ai flippé la première fois.
J’ai vingt et un ans.
J’ai reçu mon Certificat d’Initiation Plastique de l’École des Beaux-arts m’ouvrant les portes pour la troisième année.
J’achète du marron toutes les deux ou trois semaines pour fumer le week-end avec mes potes et les copines. Ma première cigarette, je l’ai fumé sur le parking de l’ancienne gare routière de Lorient.
Aujourd’hui, le parking n’existe plus.
Le Cinéville de Lorient a pris place.
Fin juillet, j’ai mes trois jours à faire, ce n’est plus du cinéma.
Amandine a obtenu son Bac D avec félicitation.
Je suis dans le parc Jules Ferry avec Amandine, le sénégalais, Henri le bouddha hippopotamesque et Sergio, un autre pote, assis sur l’herbe.
C'est le Festival Interceltique de Lorient.
Un londonien, vêtu de noir digne d’un curé bien sapé, nous accoste avec son accent british. Il nous branche deux fois :
- Trip ?
- Trip ?
Le « trip » c’est le nom d’une drogue hallucinogène et puissante.
En anglais, « trip » c’est « voyage ».
À l’époque, un petit buvard de cinq millimètres de côté imprégné d’une goutte de cette substance valait cinquante francs.
Le « trip », connu de son vrai nom L.S.D, raccourci en allemand d’acide lysergique diéthylamide, est une substance de différents alcaloïdes présents dans l’ergot de seigle.
Les hallucinations commencent une heure après l’ingurgitation.
Le L.S.D est un bout de carton à ne pas mettre dans toutes les bouches. Certaines personnes restent bloquées plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, parfois des années.
Et il y a aussi l’effet de non-retour, les gens restent bloqués à vie.
Ce soir là, chacun a gobé son « trip » chiné dans le sachet transparent du british-man.
Moi, ne connaissant pas le produit, j’ai préféré ne pas « triper ».
Le sénégalais a joué du djembé toute la nuit. Au petit matin ses doigts avaient triplé de volume.
Le djembé, c’est un tambour, c’est le tam-tam de l’Afrique noire.
Dans l’après-midi, j’ai acheté deux « trips » à un autre dealer.
Un pour moi, un pour Anne-Sophie, une copine de l’École des Beaux-arts.
Anne-Sophie a deux petites billes. Couleur Terre de Cassel. Presque noire. Anne-Sophie a les cheveux longs et brun et son popotin, un poil trop large, lui va très bien.
Le trafiquant me dit :
- Mets tes acides dans un frigidaire si tu ne les prends pas de suite.
C’est ce que j’ai fait. Anne-Sophie avait renoncée à prendre sa drogue. J’ai suivi le conseil du dealer quittant lâchement Anne-Sophie dans le jardin public.
Je prends le bus.
Moun est absente pour son travail. J’ai donc mis mes deux achats dans son réfrigérateur.
J’ai passé l’après-midi chez maman.
La soirée aussi.
Le lendemain, je prends mon petit-déjeuner devant la télévision.
Le café est noir.
Le bol est orange.
J’ai trempé mes biscottes beurrées dans mon café.
Mon jus d’orange est froid.
Quand j’eus terminé ma collation, j’ai repensé à mes deux buvards pensant avoir été leurré avec ces deux petits carrés. Effectivement, l’avant-veille, j’avais scrupuleusement observé les acides dans le creux de la paume du sénégalais. C’était des toutes petites billes noires pas plus grosses qu’une tête d’aiguille. Elles étaient enveloppées d’un bout de plastique transparent type cellophane. Dans le jargon du milieu des affaires policières et des drogués se sont les micropointes.
C’est une autre forme du L.S.D moins courante sur le marché.
Plus rare et plus costaud, la micropointe est un bon cru d’un excellent millésime comparé au buvard qui serait plutôt un grand vin de table d'un château réputé.
Finalement, j’ai choisi un des cartons avec suspicion.
Puis j’ai attendu en me réinstallant devant l’écran de télévision.
Je ne zappais pas la nouvelle émission postiche animée par Laurent Bauer, Fréquenstar diffusée sur la sixième chaîne.
La nuit dernière, j’avais regardé Taratata présenté par Naguy.
Il n’y avait que cinq chaînes à l’époque.
Tf1, Antenne2, Fr3, Canal+ et M6.
Devant l’écran, j’attends tout de même mes premières hallucinations. Et parce que j’avais compris que les hallucinations d’un acide se révélaient progressivement après l’avoir avalé j’ai gobé le second trois-quarts d’heure après mon premier. Ne voyant rien venir avait confirmé ma thèse de la supercherie. Je m’étais fait entourlouper et j’ai pensé qu’il fallait mieux avaler ce que j’avais dépensé.
Illico presto, je me suis donc jeté sur mon dernier carton.
Au moment où j’avais mon deuxième buvard entre l’index et le pouce devant mes lèvres, juste avant de l’envoyer au fond du gosier, j’ai entendu mon ange gardien me dire :
- C'est une sottise, Andy !
Je n’ai pas l’esprit destructeur ni suicidaire. Jamais je n’aurais pris deux trips après avoir vu le sénégalais jouer du tam-tam toute la nuit avec une seule dose. Le sénégalais avait joué de dix neuf heures à six heures du mat.
Alors, je pensais avoir avalé de simples buvards imprimés d’une simple étoile jaune et c’est tout.
À nouveau devant le petit écran, j’étais chagriné d’avoir été trompé.
J’avais perdu cent francs pour ces deux modestes buvards.
Mon pied gauche est posé sur le rebord de la table basse du salon. Un gros tube noir métallique. La table basse est en acier. Les pieds cubiques reposent sur un tapis hirsute rouge fuchsine aux cheveux longs et drus.
Le plateau de la table est un verre épais et teinté.
Vert émeraude.
Puis j’ai commencé à ricaner sans rien soupçonner.
Soudain mon pied posé sur la table a décalé vivement celle-ci la reculant d’une coudée peut-être.
À ce moment là, précisément, j’ai saisi l’importance des deux buvards en réalisant avec panique que j’avais avalé de véritable L.S.D.
Deux « trips ».
Du coup, la coudée avait une toute autre dimension, aussi.
Je savais absolument qu’il fallait maintenant sortir.
J’ai donc débarrassé la table basse.
Mon bol orange.
Le verre.
La petite cuillère.
Je suis monté à l’étage.
Salle de bain.
Je me lave les dents.
Je me mate. Toujours beau gosse.
Alors que j’avais déjà fait dix pas, la lourde porte de la salle de bain se rabattait puissamment pour claquer sur son châssis.
Le claquement avait été phénoménal.
Je suis resté coi en encaissant avec stupéfaction l’efficacité du produit avalé. J’ai même pris peur encore une fraction de seconde.
Il me fallait retrouver au plus vite Amandine et mes potes pour évacuer mes deux acides ailleurs qu’ici.
Sur mon chemin, entre chez elle et chez Moun, j’ai senti plusieurs gouttes tomber sur ma peau du visage. Le ciel est bleu ciel. Pas de nuage sur le dessus de ma tête ni même à l’horizon. Ni blanc, ni gris, ni noir.
Pas de pluie donc.
Le sénégalais, Henri le bouddha hippopotamesque et Sergio étaient resté dormir chez Amandine. Quand je suis arrivé chez elle, les quatre étaient à table dans la cuisine. Les quatre avaient déjà leurs deux soirées consécutives d’acide dans la tête.
Il n’y avait pas assez de chaise. Je m’assieds parterre. Le sénégalais me demande, inquiet, mais toujours avec le sourire :
- Comment vas-tu ?
Je lui réponds :
- J’ai gobé mes deux trips.
Le sénégalais :
- Ou pela !!
Amandine m’a regardé en fronçant les sourcils.
J’avais des frissons et puis j’avais chaud.
Je suis allé dans le séjour pour me dévêtir.
Et puis je me rhabille.
J’ai attendu qu’ils finissent leur petit-déjeuner pour décamper et rejoindre le parc Jules Ferry.
Le grand frère d’Amandine était là.
Nous avons pris sa voiture. Il conduit. Je suis assis derrière le siège passager. J’ai ma joue droite contre la vitre.
Tous les véhicules et tous les passants me semblaient désuets et inutiles. Cela avait pour moi aucun sens.
Parmi toutes ces choses, j’ai vu un bus. Il m’a paru disproportionné et tellement si énorme. Les monstres à l’intérieur m’ont paru comme des fourmis. Si petits et si noirs. Et tous à leur place dans le bus comme un fantassin dans son rang près à partir en campagne.
Certains avaient leur joue contre la vitre. Comme moi. Cela m’a soulagé car je n’étais pas seul à attendre quelque chose.
Avant de retrouver Jules Ferry, nous sommes allé en ville chez quelqu'un dont le sénégalais avait besoin pour parler affaire. Nous étions à cinq pas du jardin public. J’aurai aimé m’y rendre mais je n’osais pas y aller tout seul.
Nous avons tous suivi le sénégalais.
Le garçon chez qui nous nous étions rendus avait son pouf sans garniture. Je me suis assis directement sur les trois barres en rotin. Je suis resté quarante deux minutes chez cette personne sans son coussin sous mes fesses. Je devenais impatient de sortir.
Quand mon groupe repartait, je me suis levé d’un trait. Sur mes jambes, je me suis retourné aussitôt surpris de ne sentir aucune gène ni douleur au fessier.
C’était le miracle de l’acide.
Dans le parc certains d’entre nous se sont dépêchés pour trouver à nouveau d’autres petits carrés magiques.
Enfin à genoux sur l’herbe avec Amandine, le sénégalais et Sergio, un joint tourne. Je tire une taffe.
J’ai eu la sensation de prendre une bouffée de rien.
Un vide astronomique. J’ai passé la tige à mon voisin.
Puis, très vite, j’ai eu besoin de me retourner. Encore. Derrière moi, un jeune couple trentenaire pousse un landau dans une allée du jardin verdoyant. Quand une fleur à l’allure cyclopéenne apparut subitement en transparence sur les deux bustes des parents. Les pistils sont couleurs pourpres, les pétales rouges safran.
C’était un bogue.
C’est sûr, l’image n’était pas réelle.
Il s’est mis à pleuvoir.
À l’abri de la pluie sous les arcades longeant le garden, je suis à côté de routards et de quelques festivaliers. Et d’autres gens.
Des touristes.
Je me suis senti seul à cet instant.
Il est minuit. Déjà.
Je me suis réfugié sous les tribunes du stade de foot avec Amandine et le sénégalais. Avec nous, il y a Dédé la grenouille. C’est un festivalier de la Charente-Maritime.
Il pleuvait certainement encore.
Vers trois heures et demie, mes deux « trips » s’évaporaient peu à peu toujours en dent de scie. C’est la fin d’un voyage sous acide.
Vers six heures trente, le sénégalais et moi sommes rentrés en bus. Amandine, elle, a rejoint le camping réservé aux festivaliers pour se reposer sous la tente de la grenouille.
Le L.S.D, c’était la drogue des hippies.
Les seventies sont passées mais la drogue circule toujours.
Je rentre à l’armée pour effectuer mon service militaire.
Octobre.
Deux mois à Chartres pour mes classes.
Je suis dispensé de tir à cause d’une greffe du tympan à l’oreille droite et c'est tant mieux. Je n’aurai pas aimé poser la crosse sur mon épaule. L'idée simple de savoir que tu peux tuer une personne avec une arme à feu m'effraie. C'est une arme trop facile. Il n'y a plus le charme du combat à l'arme blanche. Au moins avec le sabre ou le couteau, le duel était équitable.
Aussi, j’étais dispensé de marche et d’exercices physiques à cause de mes rotules. Mes genoux sont débiles. À vrai dire, j’étais comme un prisonnier de guerre encellulé dans un centre de vacances.
J’ai fait la suite de mon service à Paris dans le XVème arrondissement.
J’étais aviateur. Dans l’armée de l’air, c’est le grade du subalterne.
J’ai acheté mon premier paquet de tabac. Je roulais d’habitude mes joints avec le tabac des copains qui fumaient tous.
Sinon, chez Moun, je lui volais une cigarette.
La seule rigueur demandée aux aviateurs était d'être présent à leur poste.
Agent de bureau, je gribouillais dans un secrétariat d’une caserne de Paris, rue Antoine Jérôme Balard. Caserne BA 117. Pour seule occupation, je devais remplir mes deux cent cinquante enveloppes par jour.
Une heure et demie de labeur.
Monsieur Antoine Jérôme Balard, chimiste français né à Montpellier, mort à Paris en 1876, est surtout connu pour la découverte du brome qu’il isola des sels dissous dans l’eau de mer.
Sur la base 117, il y a une barre imposante et une haute tour parmi tous les autres bâtiments. Il y a le réfectoire et le dortoir des appelés dans l’un. Dans l’autre, il y a le self-service, les bureaux et les appartements de certains hauts fonctionnaires.
Accès interdit aux appelés sans l’accompagnement d’un haut gradé engagé.
Forcément, j’étais contre le service militaire. Cependant, Moun avait moyen de me pistonner sur la base aéronavale de Lann Bihoué à Lorient.
J’aurai été plongé dans la lumière rouge au sein du service du laboratoire de photographie et j'aurai été au pieu chez ma mère tous les soirs.
Dans ces conditions ça ne m’aurai pas déplu même d’être engagé.
C’est devant le colonel aiguilleur, pendant mes trois jours, que je me suis planté.
Après les examens et les tests physiques et intellectuels réussis le colonel me demanda :
- Fiston, dans quelle armée veux-tu exercer tes compétences ?
- Dans l’armée de l’air, Monsieur le colonel.
Le colonel reprend :
- Hum ! Dans quelle armée veux-tu exercer ?
Je lui rétorque une deuxième fois :
- Dans l’armée de l’air, Monsieur.
Le colonel insiste :
- Dans quelle armée veux-tu exercer, je te demande ?
Je lui réponds désarmé :
- Dans l’armée de l’air, Monsieur le colonel, sur la base militaire de Lann Bihoué à Lorient.
Mais une base aéronavale n’est pas une caserne de l’armée de l’air. C’est bien pour cela que le colonel insistait.
Je me suis fait réformer le jeudi 23 février 1989 après quatre mois et demi de loyaux services. Pour cela, j’ai arrêté mon alimentation trois semaines. Les seuls croissants au beurre du mercredi matin que nous avions droit au petit déjeuner ont été mon repas.
Le reste de la journée, je marchais au pas et à l’eau et avec pleins de petits cafés sucrés.
J'étais à onze coudées du portillon. Juste devant ma sortie définitive de la base aérienne 117, je ne sentais plus mes jambes, mes pieds et le parterre. L’instant m’a paru irréel. J’étais dans les bras d’Éole.
Insondable.
La dernière scène du film Midnight Express m’est apparue soudainement.
Le dealer fuit la prison en uniforme du directeur.
Cette image est incroyable.
Sur le trottoir, j’ai souri.
J’ai pris le couloir du métro le plus proche.
Station Balard.
Il n'est plus permis de rêver
Chapitre 9
Emmanuel est d’origine martiniquaise.
C’est pourquoi nous partons là-bas.
Emmanuel n’a jamais mis les pieds sur sa Madinina. L’Ile aux fleurs en créole. Emmanuel avait un sobriquet connu de tous les routards, son nom était Vendredi. Si j’avais incarné l’autre personnage posthume du roman de Daniel De Foe lui et moi aurions pu faire la paire.
J’aurai été Robinson Crusoé.
Début novembre, je prenais seul le transatlantique.
C’est un couple d’ami qui m’a reçu à l’aéroport.
Le mari est douanier.
Douane volante.
Sur l’île, j’avais deux points d’attaches. Ce couple d’amis et un autre couple d’amis de Paolo posé sur les hauteurs de Fort-de-France.
Sur un piton.
Les pitons, il y en a sur mille lieux éparpillé sur l’île.
L’Ile aux fleurs devait être mon point d’envol. Je voulais sautiller toutes les îles antillaises du nord, les îles vierges américaines pour rejoindre la Floride. De Miami, j’aurai vagabondé jusqu’au Mississipi pour croiser Tom Sauer tranquille sur la rive, une canne à la main.
Je voulais connaître la Louisiane pour piétiner avec douceur sur la terre des plus grands jazzmen.
Je me serais arrêté à La Nouvelle-Orléans pour flâner dans les rues du Vieux Carré.
Après quoi, je descendais sur le Mexique pour saluer les temples des Mayas et ceux du Guatemala. J’aurai traversé le grand canal de Panama. Quelques milles à parcourir en stop, à pieds ou sur le dos d’un âne pour atteindre la capitale du Venezuela.
Orteils et talons à Caracas, je me serais posé assis sur un banc public sur la Place Simon Bolivar.
D’ici, quelques îles à survoler en bateau-stop pour rejoindre l’Ile aux fleurs.
Grenade.
Saint-Vincent-et-les-Grenadines avec sa capital Kingstown.
Barbade.
Sainte-Lucie.
Le rêve.
Mais il n’en était rien.
Des oiseaux passent.
Clopiner en solitaire ce parcours ne m’enchantait guère. J’aurai manqué d’assurance et d’expérience pour traverser toutes ces frontières.
Sur l’île, personne ne voulait me suivre.
Pourtant j’ai gambadé l’île de Macouba à Sainte-Anne. De La Trinité de la presqu’île de la Caravelle à Saint-Pierre.
J’aurai pu escalader la montagne Pelée.
Le volcan était trop haut.
Qu’une personne survécut à l’éruption de 1902 qui ensevelie la ville de cendres volcaniques et de lave brûlante. Le seul rescapé de Saint-Pierre était en prison protégé par sa cellule.
La mémoire ne nous dit pas de quoi il était condamné.
Les papiers ont brûlés.
Avait-il volé des légumes ou des fruits sur le marché ?
En ce jour de mai, il y eu vingt huit milles victimes.
Entre deux palmiers sur la plage des Salines à Sainte-Anne.
Deux cocotiers.
Hamac ficelé entre les deux troncs.
Une bâche légère et la moustiquaire tendues sur un fil pour me protéger des pluies torrentielles et des insectes.
C’est dans un commerce d’une venelle près du centre de Fort-de-France que j’ai acheté mon hamac spacieux prévu pour deux.
Le neuvième jour.
La plage est décorée d’une frise verte et marron de cocotiers. C’est LA grande plage de la Madinina usée en journée par les touristiques.
L’eau est bleue, verte, blanche et turquoise.
La carte postale est posée.
La nuit tombée, la plage est déserte.
Je suis seul.
Les ti-punchs de l’apéro ont attiré les martiniquais sur le zinc et prévenu les touristes sur les terrasses.
Il est 18 heures.
La nuit s’installe.
Casse-croûte. Jambon pain beurre.
Un jus de fruit.
Orange et fruit de la passion.
Un yaourt blanc au sucre de canne.
Face à la mer, je suis assis sur les grains de sable. Un joint de marijuana dans la bouche. De la locale.
Je me baigne.
Trois brasses pour me rafraîchir. Moment privilégié.
J’ai fait dix pas sur la plage.
Au large, il y a le Rocher du Diamant.
Je me suis couché dans mon confortable et long panier en lin.
Pas de musique.
Ni mélodies. Ni sons.
Dans l’après-midi, j’ai été braqué dans un square par une bande de sept marrons antillais. Ils m’ont volé mon walkman.
À cause d’eux, j’ai été raciste.
Vingt-deux longues minutes.
Je suis loti blotti dans mon doux et spacieux hamac quand trois touristes métropolitains arrivent pour planter devant moi leur tente.
Sur la plage. L’un d’eux a crié avec joie :
- C’est trop cool la Martinique !
Sur les nerfs, j’ai pensé, un peu énervé :
- Ferme ta gueule, écoute le silence.
Les deux autres ricanaient. Craignaient-ils l’inconnu que j’étais ? Les trois cons ont cassés le charme de cette séance de solitude.
Nous avons passé la nuit côte à côte sans se dire mot.
Au petit matin, j’ai décampé assez tôt pour éviter la venue en masse des autres vacanciers.
La plage des Salines de Sainte-Anne c’est la plage martiniquaise à ne pas contourner.
Sur la presqu’île de la Caravelle, je suis allé retrouver Enzo le magicien. C’est un artisan black qui travaille les calebasses et les gros tubes de bambou pour en faire des abat-jours, des plats ou des sacs.
Il coupe avec sa scie à métaux.
Il sculpte aux ciseaux à bois.
Il grave au fer rouge.
Parfois, il y ajoute des bandelettes de toile de jute pour arrondir les bords coupés.
Enzo le magicien habite dans un cabanon.
Le toit est fabriqué en panneaux de tôles ondulées fixées précairement.
Il y a quatre pièces.
Sa chambre.
Une chambre d’ami dans laquelle j’ai dormi, une fois.
Une cuisinette avec l’unique accès sur son jardin.
Un seul arbre y pousse.
Son atelier est ouvert sur la courette devant la route côtière de Tartane séparant sa délicate propriété de la plage.
Pour faire ses besoins, il faut trouver un petit coin dans son jardin parmi les hautes herbes.
Il n’y avait pas grand monde à passer chez le pauvre Enzo le magicien. Mais José, un marin pêcheur, passait régulièrement.
Enzo et moi sommes rencontrés le troisième jour de mon arrivé. J’étais sur la route quand il m’a balancé un large sourire assis dans son atelier.
Lui et les autres autochtones de sa couleur que j’ai croisé durant mon voyage me disaient tous :
- Il faut lire la Bible.
Et encore :
- Soit un bon catholique pratiquant.
L’impression me donnait d’être retourné au Moyen-âge.
J4
J'ai passé le premier de l'an avec Enzo le magicien.
C’est ce soir là que j’ai décidé de rentrer en métropole.
Quinze jours plus tard j’étais dans mon charter de retour.
Je me suis rendu chez un bibliothécaire spécialisé pour acheter la Bible. Bien que judéo-chrétien, de part mon éducation, je ne connaissais pas grand chose finalement de ce gros livre sans parler de la création du monde en six jours et des dix péchés capitaux.
J’ai pris le Coran.
J’avais besoin d’un autre support pour comparer.
La comparaison est efficace pour apprendre.
Je me suis baigné dignement dans d’autres textes sacrés de Lao-Tseu et de Confucius.
Un conseil de ce dernier :
- Sachez vivre à votre époque.
Cet apophtegme venu de si loin nous pousse aujourd’hui à la réflexion.
J’ai étudié lourdement le bouddhisme avec le prince Siddhârta Gautama.
Ici et maintenant.
Ici avec ton corps. Maintenant avec ta conscience.
Et à travers un livre de poche trouvé dans une boutique dans l’immense hall de la gare Montparnasse, j’y ai découvert l’histoire de Mani. Celui-ci est moins connu que tous les autres. Pourtant c’est un homme spirituel tout autant respectable. Il est la source du manichéisme.
Homme spirituel, il était aussi peintre et calligraphe. D’après les textes, il aurait été conseillé politique de Chahpour 1er, roi sassanide de Perse.
Enfin, j’ai feuilleté chez le sénégalais quelques pages merveilleusement illustrées de la Bhagavad-gîtâ. C’est un livre pilier de l’hindouisme.
Jésus de Nazareth ou Mahomet, soit le fils de Dieu ou le dernier grand prophète, tous ces beaux mortels de Krishna à Gautama, tous ces philosophes ou poètes de Socrate à Platon, tous ont voulu ici sur Terre développer et améliorer leur sens de la spiritualité.
Ils étaient tous humaniste.
Nul n’a eu l’intention de guider l’humanité dans le désordre.
Pourtant certains d’entre nous se font toujours lapider, aujourd’hui encore. D’autres se flinguent ou se narguent pour un morceau de terre ou parfois pour le baiser volé d’une femelle.
La bêtise et l’ignorance nous pousse à l’incompréhensible.
En suivant à la lettre la philosophie de ces grands guides.
Où se trouve la faille ?
Nous sommes prisonniers de notre condition d’existence qui nous donne le pouvoir d’être avides de galons ou de biens.
Les uns préfèrent les pierres montées, les autres les terres agricoles ou de chasse. D’autres encore investissent dans le domaine artistique pour la gloire. N’oublions pas les fringues souvent importables aux prix immensurables des défilés de mode.
Et puis il y a les « qui sera la plus belle ce soir ? »
Un Picasso, le « Dora Maar au chat » a été vendu le 3 mai 2006 chez Sotheby's à New-York pour 101,8 millions de dollars.
Le « Dora Maar au chat » a été réalisée en 1941.
Dora Maar y figure en robe bleue à petits points verts chamarrée de perles orange et noires. Le corsage est vert et strié. Assise sur son fauteuil, Dora Maar est coiffée d'un chapeau dont elle raffolait.
La muse est placée de trois quarts, les mains tordues sur les accotoirs aux ongles bleus.
Derrière elle, sur le dossier du siège, figure un chat.
Pablo a réalisé de nombreux portrait de sa compagne mais celui-ci reste certainement l'un des plus beaux.
Bientôt, la bêtise sera au rendez-vous devant un choix.
Il faudra déplacer le Dapsang par la pensée ou plonger la tête dans un lac.
Le mur n’existe pas.
Fini les petits croquis sur la table et les longues formules. La racine carrée n’est qu’un chiffre parmi d’autres. La source est vitale. Il est temps de jeter les feuilles, les carnets et les gribouillis pour passer à l’action.
Il n’est plus permis de rêver.
J’ai retrouvé la grenouille. Dédé la grenouille a finalement posé ses saloirs en Bretagne.
Amandine et la grenouille ne sont plus ensemble et monsieur a loué une chambre meublée chez ma grand-mère.
Marie-Antoinette.
La chambre de Dédé la grenouille se situe au dernier étage.
Sous les combles.
Marie-Antoinette vie dans sa maison qu’elle et Zo ont fait construire peu après leur retour de New-York juste avant la Deuxième guerre mondiale.
Le toit est en tuiles orange.
Sept mois après mon retour des Antilles, je concluais un contrat à durée déterminée.
Un An.
Je me suis acheté une 2 CV. Je suis dessinateur et sérigraphe dans le domaine publicitaire et signalétique.
Le week-end, parfois, je montais sur Brest.
Amandine est étudiante dans le commerce international.
En période du festival de Lorient, je suis parti avec Amandine en stop dans la banlieue parisienne.
Nous étions partis rejoindre un couple d’amis, Moustapha et Manon pour continuer la route ensemble en voiture à Amsterdam.
La voiture est orange.
C’est un pot de yaourt.
Une Fiat.
Manon est à de longs et beaux cheveux blonds.
Un petit nez.
Moustapha conduit.
Autoroute. Dans la banlieue de Rotterdam, une grosse BMW anthracite nous suit de près. La voiture nous double pour nous coller sur le côté. Le passager de devant nous présente par la fenêtre un kilo de shit. Flingue à la main.
Moustapha était près à sortir son couteau.
Mais qu’aurait-il fait fasse au gros calibre ?
La situation devenait ridicule et embarrassante.
Nous sommes dans un coffee-shop à Amsterdam.
Je bois un café.
L’ambiance est feutrée, petites lumières, bougies allumées. Poster de bouddha. Sculpture de Bouddha. Des encens.
Amandine et Moustapha sortent de l’établissement.
Subitement.
Sur la table, la bougie s’est éteinte.
Je reste dans le coffee-shop avec Manon.
On ne sait rien dit. Juste un sourire.
Amandine et Moustapha reviennent fumer un joint. L’ambiance était tendue. Nous sommes sortis du coffee-shop.
J’espérais reconsolider des liens affectifs avec Amandine. Pour moi, les circonstances du voyage paraissaient prouver la réciprocité. Sinon étions-nous montés aux Pays-Bas juste pour fumer des joints ? Peut-être.
Plus loin, dans une ruelle, nous avons maté discrètement les prostituées en tenues sexys très légères protégées du froid et des intempéries derrière leurs vitrines.
Ce ne sont plus de beaux mannequins en plastique bien couvert de sapes et des accessoires à la dernière mode.
Depuis le retour de l’Ile aux fleurs, je décortiquais l’Ancien Testament et les évangiles essayant de décrypter les messages codés de la Bible. En cela, j’étais rentré peu à peu dans une spirale diabolique. M’appropriant certaines métaphores et d’adages, j’étais pris dans un délire égocentrique sans savoir comment sortir de ma tourmente, ce qui suivi d’un doublement de personnalité.
Il y avait un autre déclaré en moi.
Mon bras droit était ce revenant venu de Nazareth.
J’étais le retour du Christ.
Dans l’Apocalypse de Jean, la fin d’un monde est décrite en forme de parabole. Ce livre, le dernier du Nouveau testament, doit prévenir un homme (l’heureux élu ?) et présente finalement l’image du monde quand l’homme en sera à manger sa queue.
L’Apocalypse, mot latin d’origine grecque, signifie « révélation ».
C’est une fable de nature alarmante, mais rien ne sert de s’affoler.
La fin de toute chose est signe de rédemption.
Ce livre m’était destiné. Véritablement retour du Christ, je devais donc réveiller notre monde pour guérir notre planète devenu fiévreuse.
Réveiller notre monde.
Réveiller notre monde pour sortir d’un système qui ne fonctionne plus.
La planète sur mes épaules, j’ai senti son poids.
Elle pesait bougrement lourde avec toutes ses montagnes, ses fleuves et ses prairies vertes, certes.
L’irresponsabilité, l’ignorance et la sottise humaine avaient son poids.
Ces trois plaies me font peur.
Certains d’entre nous mettent la planète à chaud ou en eau pour des contrats de milliards de dollars.
Pas de scrupule.
Où allons-nous après ?
Sur Mars parait-il.
Les grands professeurs de ce monde nous balancent des messages politiques ou publicitaires souvent trompeurs pour s’empiffrer encore plus de beurres.
Je fais une prière :
- Que tous nos rejetons piétinent sagement et avec rigueur l’irresponsabilité, l’ignorance et la sottise de nos pères.
Il est vraiment temps de grandir.
Fini l’adolescence.
Où va le monde ?
Pour sortir de l’impasse, j’avais trouvé une solution avec Amandine persuadé qu’elle était là pour me guérir. Pour autant ma mission n’était pas simple. Il me fallait la reconquérir sans dévoiler ma mystérieuse identité pour réveiller notre monde et guérir notre planète fiévreuse.
Mon silence était le prix de mon salut.
Amandine et moi dormions ensemble sous ma tente.
Chacun dans son sac de couchage.
La situation facilitait la tâche.
Je suis timide.
Mais non.
Au retour d’Amsterdam, à quelques kilomètres de la frontière française, j’ai demandé à Moustapha de s’arrêter prétextant un arrêt pipi.
Je me sentais mal.
Ma mission s’effondrait.
Dehors, à quelques mètres du véhicule, j’ai pissé tout de même pour ne pas faillir à ce que je venais d’annoncer. Mais après quoi, je n’ai plus voulu remonter dans la voiture m’asseyant sur un tronc abattu sur le côté de la route.
Amandine est venue vers moi.
Elle me lance :
- Qu’es-ce-que tu fous Andy ?
- ...
Et peureusement :
- Je t’aime Amandine.
Elle :
- ...
Sur mon tronc, j’ai eu les deux poings serrés ne pouvant plus les ouvrir tellement mon mental me l’affirmait. Pris de panique, j’ai chuchoté à Amandine :
- Regarde, je n’arrive plus à ouvrir mes poings.
- Mais non.
Elle prit brutalement mes deux poignes pour les ouvrir.
Cela m’a fait un choc de voir mes doigts libérés parce que je les avais cru vraiment serré de manière définitive.
Alors les gestes d’Amandine devenaient le signe de la délivrance confirmant qu’elle était ma destiné pour former ce couple divin salvateur.
Je lui ai donc déclaré encore :
- Je t’aime.
Nous nous sommes arrêtés à Lille. On a bu un café chez un couple d’amis et nous sommes allés se promener sur le terrain de football du quartier pour se dégourdir les jambes.
Il n’y avait pas de joueurs sur la surface de jeu.
Le ciel est gris.
C’est devant un but que je me suis glissé devant Amandine pour lui cracher la première fois mon titre de roi divin.
Je n’avais plus le choix. Et j’espérais que cela soit l’ultime message déclencheur. Nous n’étions pas sur les planches d’un théâtre mais la scène devenait dramatique. Face à elle je lui annonce :
- Je suis le retour du Christ.
Qu’a-t-elle pensé ?
Que j’avais déraillé.
Elle n’avait pas tort.
Sans hésitation, Amandine a riposté :
- Arrête de fumer les joints Andy, s’il te plaît.
Dans la voiture orange de Moustapha mon ange gardien me dit :
- Retourne-toi.
Nous étions sur l’autoroute en quittant Lille et il y avait le long de la chaussée de hauts monticules profondément noirs. Déchets de charbon. Affiché comme slogan publicitaire, certainement une déclaration d’amour, il y avait sur l’un d’eux marqué en cailloux blancs :
- Je t’aime.
Déclaration d’un galant pour sa future, moi, j’avais pris ce slogan comme preuve marquante de la traçabilité du Grand Créateur. Ce dernier ne m’avait donc pas abandonné malgré l’échec de la mission et, soulagé, cela m’avait redonné du courage pour relancer ma demande en mariage. La sonorité de ma voix transpirait la détresse de façon à ce qu’elle me réponde.
Ne pouvant rien pour l’enfant de Nazareth, Amandine a levé les yeux et ses épaules.
Qu’aurait-elle pu faire d’autre ?
Moustapha et Manon nous ont déposés devant la gare Montparnasse.
Les deux amoureux ont prolongé leurs vacances en Corrèze.
J’ai pensé qu’Amandine avait du mérite pour me garder parce que j’aurai pu perdre mon contrôle et devenir violent dans les gestes ou agressif dans les mots.
C’est Amandine qui a pris les tickets de train. J’étais incapable d’acheter seul mon ticket.
L’avait-elle compris ?
Nous avons attendu sur le quai sans se dire mot.
Elle a fumé une cigarette.
La chamelle est la femelle du chameau et du dromadaire.
Dans le wagon, nous nous étions assis face à face dans le compartiment.
Côté fenêtre.
Dans le couloir, j’ai ouvert un vasistas pour faire glisser l’air sur la peau de mon visage.
Le ciel est gris.
Mes longs cheveux ondulent avec la vitesse du train.
Amandine avait-elle un œil sur moi ?
J’aurai pu vouloir sauter du train.
J’ai reçu une goutte au milieu du front sur la zone précise du troisième œil et j’ai entendu mon ange gardien me dire :
- Tu es béni, Andy.
Ma mission n’avait donc toujours pas atteint sa fin.
Cette voix était le message confirmant mon scénario invraisemblable.
Devant chez elle, à Quéven, j’ai tenté un dernier baiser pour ne pas se quitter fâcheusement. Je ne voulais pas la laisser sans conclure.
Le lendemain, j’ai craché mon morceau à maman avec un ton plus menaçant et satirique :
- Je suis le retour du Christ, maman, et tu n’en parles à personne.
À quoi ma mère a-t-elle pensé ?
Moun est restée désemparée, sans voix, la gorge sèche.
Elle et moi déchargions le coffre de sa caisse.
L’idée ahurissante d’être la réincarnation de Jésus de Nazareth s’était ancrée quelque part dans les méandres cérébraux de ma petite cervelle.
Je voulais donc atteindre LA Grande Vérité.
Pour cela, il me fallait donner la mort pour baigner dans les bras de l’Absolu.
Je suis allé triompher sur le rebord d’une falaise entre Pont-Scorff et Quéven. Le destin de l’humanité était sous mes pieds.
Il me fallait réveiller notre monde pour guérir notre planète.
Le Scorff est en contrebas de l’escarpement. Mes deux pieds joints sur le bord du gros caillou. Je n’avais qu’à faire un pas pour donner mon corps et ma vie au Grand Créateur.
La mort s’en suivait.
J’aurais échoué comme un moudjahidin se fait exploser les boyaux pour suivre à la lettre les commandements d’un Dieu.
Grossière erreur.
Le gros caillou m’a supporté seize minutes.
Je suis rentré pensant ne pas avoir accompli mon devoir rédempteur.
Simple besogne pour le Grand Créateur.
J’ai levé la tête pour m’excuser au près de lui.
C’était la fin de Tout.
Pour moi le Grand Monde allait s’écrouler dans les trois jours. J’ai ausculté alors avec minutie toutes les actualités.
Pas de Grande Guerre ni de grosse météorite.
Après quatre jours, voyant la vie continuer autour de moi, j’ai donc repensé à mon rocher pour réussir mon acte pythique.
Le gros caillou m’a supporté encore.
C’est au retour de ce rendez-vous que la Terre s’est posée lourdement sur mes épaules.
J’avais en tête l’incontournable proverbe « Jamais deux sans trois » qui m’était évidemment destiné.
Pour la troisième fois, je suis sur mon caillou.
Mon devoir n’était pas inachevé.
Sur mon rocher, j’ai pensé à Moun et à Léonardo.
Grâce à eux, j’ai évité le pire.
C’est après ce troisième volet de ce triptyque dramatique et désuet que j’ai accepté définitivement la fin de la Mission Sacrée.
Après ma mort, j’avais choisi les entrailles d’Amandine.
Pour passer ce cap, que l’on peut facilement porter en dérision, j’ai suivi le conseil évident d’Amandine qu'elle m’avait donné. Effectivement, depuis un an, je salissais mes poumons en fumant dix huit pétards par jour.
J’ai arrêté de pratiquer le cannabisme.
Du jour au lendemain.
Aussi, malgré mon abstinence, si ma crise messianique persistait à me ronger je pouvais par ma seule volonté ou par force me faire interner dans un hôpital psychiatrique.
Il y avait l’hôpital Jean-Martin Charcot près de Lorient.
Médecin français né à Paris en 1825, Monsieur Charcot a été professeur à la Salpêtrière.
Sigmund Freud fût un de ses élèves fétiches.
En 1910, le fils de Monsieur Charcot, savant et explorateur français, publia Le « Pourquoi-Pas ? » dans l’Antarctique.
En octobre, je descendais chez un viticulteur bordelais avec le sénégalais, son frère Henri le bouddha hippopotamesque, Sergio et encore Amandine.
Le nom du domaine était Château Maison-Dieu.
J’avais accepté à ne plus être ce Grand Sauveur du Monde mais pour compenser ma défaite je voulais qu’Amandine me fasse un enfant. Il aurait été celui que je n’avais pas réussi à être, le messie tant attendu.
Le complexe de Jérusalem avait atteint l’absurdité.
J’étais le forgeron façonnant sa progéniture pour en faire sa sculpture divine.
Mes genoux n’ont pas supportés le poids des raisins noirs. Je suis resté trois jours près des cépages.
Avant de partir, j’ai essayé de reconquérir Amandine pour la routine :
- Tu me fais un chérubin ?
Et puis encore :
- Il sera ce Grand Prophète annoncé par le bouddhisme.
Amandine :
- ...
Elle m’a regardé les yeux ronds.
Dédé la grenouille habite dans une nouvelle demeure à Pont-Aven qu’il loue depuis un an et demi avec sa nouvelle copine, Rachel.
Pont-Aven est bien connue pour son école de peinture.
Paul Gauguin y séjourna en 1886 autour d’Émile Bernard et de Paul Sérusier. C’est en 1888 que Paul reviendra dans le pays, au Pouldu, louant une chambre dans la pension Gloannec. Le peintre y sera à nouveau entre 1889 et 1894 chez Alain le philosophe.
En 1887, Paul Gauguin a mis les pieds en Martinique.
Rachel a vécu avec ses parents au milieu d’une métairie dans une cour d’un château, La Devinière, près de Chinon où naquit Rabelais.
Sa mère était femme de chambre.
Son père jardinier, gardien et bricoleur.
Le grand-père de Rachel a été historien émérite de la culture africaine noire du XVIème et du XVIIème siècle.
Rachel, elle croit au vrai Jésus de Nazareth et elle n’accepte pas du tout son Dédé lorsqu’il est soul, ivre mort.
Dédé est orphelin.
C’est un enfant de la Ddass.
Aussi il n’a pas eu de bol avec sa famille d’accueil. Son père adoptif, franchouillard, lui a fait manger ses excréments après avoir déféqué dans son lit.
Le pauvre.
Aujourd’hui Dédé aime se descendre deux ou trois bières en bricolant. Aussi il glottine sans glouglou excessif en appréciant allègrement son verre de vin pour manger. Un cubitainer de cinq litres en dix jours.
Rachel est l’archétype de la vraie bretonne. Belle, avenante sans le caractère d’une cochonne. Madame descend de la petite bourgeoisie.
J’aurai été clochard sur mes cartons dans les rues de Paname ou sur le pont d’Avignon voire sur les trottoirs du bois de Boulogne si Dédé la grenouille et Rachel ne m’avaient pas hébergé au retour de l’Aquitaine. J’aurai vite oublié ma raison de vivre terminant tout les quinze jours dans une chambre d’asile bourré au cacheton blanc ou rose.
Clochard ou clocharde ?
Dédé la grenouille et Rachel se sont rencontrés sur un banc public il y a dix sept mois sur la promenade de Nice. Il y a la plage.
Rachel a pris la grenouille pour son prince charmant.
Un bébé a pris très vite.
Nous étions nombreux à la maternité. Le sénégalais tapait sur son djembé dans le jardin de l’hôpital. Un autre se promenait dans les couloirs en chantant des mantras, un encens à la main.
Tout allait bien.
Sur fond de classique, la troisième Nocturnes de Chopin, j’ai vu Rachel plongée dans une baignoire. Bain bouillonnant pour la relaxer avant d’accoucher. J’étais le parrain désigné par la grenouille. Pour cela, avec l’autorisation du service, j’ai eu le droit exceptionnel d’assister à l’accouchement.
L’image fixée que j’ai retenu est celle du bébé n’ayant sorti que la tête. Avec celle de la mère, j’ai cru voir un instant un monstre à deux têtes.
C’était une bande annonce pour la sortie d’un film chimérique.
Le bébé était tout fripé.
La grenouille a coupé le cordon. Une infirmière a pesé le monstre.
Tout va bien.
J’ai rejoint dans le jardin fleuri le percussionniste, le conteur de mantras et tous les autres.
Je suis en formation près de Chantilly. C’est à Gouvieux dans la banlieue parisienne.
Le centre de formation se trouve sur la ceinture de l’espace forestier de Chantilly.
Sur le domaine du vieux château, le château de Monvillargenne, des bâtiments contemporains à toits plats ont été ajoutés à l’entrée du parc. Le contraste est évident entre les deux styles d’architecture. Cependant les constructions à toits plats ne gâchent pas la beauté de l’ancienne demeure appartenant autrefois à la famille Rothschild. Ces derniers sont à peine perceptible tellement ils sont camouflés dans cette luxuriante végétation.
Ils nous servent de salle de cours.
Un autre de restauration.
Ma chambre se trouvait à Chantilly, derrière l’hippodrome, au dessus du bar Le Cuban café. Il y avait un car mobilisé pour les stagiaires qui rejoignait le centre de formation mais moi j’étais bien trop mal encore pour me fondre dans la foule. J’avais besoin de me cloisonner et j’étais bien trop timide encore pour être seul au milieu de tous ces gens criards de Monvillargenne.
J’allais donc à pied le matin.
Et en stop après la fin des cours.
Six kilomètres.
C’est justement vers 19h00 en sortant du centre de formation que je me suis fait prendre par un garde du corps de l’ambassade afghane.
C’est lui-même qui c’était présenté ainsi.
Cela ne s’invente pas.
J’apprenais que l’ambassadeur afghan avait son château tout près de celui des Rothschild. Le chauffeur avait oublié ses papiers. Il devait donc faire demi-tour. Sur les lieux de son affectation, il y avait trois grands longs bâtiments.
Le garde du corps me laisse dans la voiture.
J’aurais pu aussi bien me faire kidnapper.
Seul j’espérais qu’il revienne avec un morceau de chocolat à fourguer. Mais non. Attendait-il que ce soit moi qui fasse la demande ? Que me voulait ce protecteur de l’ambassadeur afghan ?
J’avais trouvé étrange qu’il se présente ouvertement aussi rapidement. Aussi, il m’aurait proposé d’être passeur de drogue j’aurai ratifié notre accord aveuglement. J’étais dans les bras du loup, comment j’aurai pu refuser une savonnette, deux cents cinquante grammes d’afghan.
L’homme est revenu sans me dire mot.
La résine de cannabis afghan est grasse et très moelleuse et aussi noirâtre que du naphte. Elle est si souple qu’il n’est pas nécessaire de la brûler pour l’émietter. Il suffit de la rouler pour en faire de la ficelle.
Le cannabis afghan est un très bon produit.
En monnayant un gros billet et en m’assurant une protection sans faille de la part de l’ambassade, le risque du trafic valait la chandelle. Mais je n’ai pas la fibre commerciale.
Ne fumant plus depuis deux ans, j’aurai tout de même bien gratté une petite crotte. Cela aurait fait plaisir à Moustapha.
Dans la demeure des Rothschild, j’ai appris à peindre le trompe-l’œil et à imiter plusieurs variétés de marbres.
Le marbre blanc, le noir, le blanc veiné, le vert de mer, le rose, le rose de bourgogne et le lapis-lazuli.
Il y avait aussi les différentes essences de bois comme l’acajou, le cerisier ou le chêne.
Après mon diplôme de peintre en décor en poche, j’aspirais rapidement à passer la trentaine, histoire de passer un cap.
Un an est passé.
J’ai maintenant vingt huit ans.
Mon chemin de croix pesait lourd.
J’avais été le retour du Christ.
Pas facile à porter.
Du Haut-Médoc aux médocs
Chapitre 10
Je vis à présent chez Marie-Antoinette dans un hangar qui lui appartient et dont elle n’a plus l’utilité.
Ma grand-mère avait besoin de secours et j’espère être un bon petit fils. Elle laissait dans l’évier de sa cuisine quinze jours durant sa casserole avec dedans deux ou parfois trois œufs noirs calcinés. Si la casserole restait parfois sous le feu ou si elle oubliait de s’alimenter, Marie-Antoinette n’omettait par contre jamais de poivrer ses œufs.
Ma grand-mère aimait bien les œufs mollets et surtout ceux à la coque.
Un peu de sel, un peu de poivre.
Elle plongeait dans l’œuf ses bâtons de pain au beurre demi-sel.
Marie-Antoinette aime bien le poivre.
Souvent, depuis tout petit, elle me disait :
- Andy, à tire-larigot, j’adore le poivre.
Ma grand-mère laissait dans l’évier sa vaisselle trop répandu en vrac et une odeur nauséabonde s’en dégageait créant une odeur récalcitrante imprégnant l’enveloppe atmosphérique de sa maison.
Ses locataires ne lui payaient plus.
Il fallait mettre de l’ordre en urgence là dedans. Ma grand-mère avait à louer de nombreuses chambres meublées sous les combles mais aussi au rez-de-chaussée.
Marie-Antoinette ne se levait pratiquement plus de son lit. Elle se levait, quand elle le pouvait, juste pour se faire ses œufs à la coque.
Sur le plat parfois.
Elle me disait :
- Andy, à tire-larigot, j’adore le poivre.
Dans la petite cour, derrière la maison de mon aïeule, une annexe servait de chambre meublée. Le locataire de celle-ci avait quatorze chats. Un autre jour, il y en avait dix. Et un autre, il y en avait douze.
Toutes les boîtes de conserves vides ayant contenu la pâtée pour ses chats s’entassaient dans un recoin de la pièce.
Dans la petite cour, un escalier descendait dans une cave. La cave n’était plus accessible tant il y avait de détritus déposés là par ce locataire.
Pour l’hygiène de vie, j’ai dû mettre de l’huile sur mes genoux et sur mes coudes. Dans ce fracas, il y avait des boîtes de chaussures vides de leur contenu. À côté des chaussures. Et puis un parapluie noir. Un autre rouge. Des pull-overs en vrac. Un imperméable. Un pull marin rayé noir et blanc. De nombreuses poubelles pleines. Une poupée avec un bras en moins. Des bottes en cuir. Des chaussures à talons. Et puis des bottes en plastique pour enfants. Et deux bouteilles de gaz au pied de l’escalier.
Et encore des conserves ayant contenu de la pâtée.
Et encore.
Enfant, j’avais déclenché à mon insu un brasier de cette cage d’escalier qui mène au sous-sol.
La cave était accessible à cette époque.
Dans la cave, il y avait une source d’eau et une cuve à pétrole.
Sur la nappe d’eau qui résistait, un fin tapis luisant.
Des planches de bois pourries avec leurs clous rouillés dépassant et quelques vieilles gamelles flottaient aussi sur ce fioul échappé.
Marie-Antoinette avait toujours plusieurs grosses boîtes d’allumettes dans les tiroirs de sa cuisine.
Assis en haut des marches, j’avais jeté sans attention au pied de l’escalier des brins consumés.
Le feu a commencé tard en fin d’après-midi.
La police judiciaire voulait m’entendre m’inculpant pour me faire passer devant un juge pour enfant. Elle imaginait que j’avais déclaré l’incendie pour immoler avec volonté MA Marie-Antoinette.
Immoler ma grand-mère.
Nous étions en 1978 quand l’Amoco Cadiz a échoué à Portsall au large des côtes bretonnes dans le nord du Finistère.
Moi je voulais juste enflammer une de mes petites voitures pour qu’elle ait l’air d’un véhicule accidenté et surtout calciné.
C’était un long break vert pastel.
Pour cela, j’avais imbibé ma Majorette de colle forte que ma grand-mère avait souvent aussi dans ces tiroirs.
Moun est intervenu vivement pour que mon nom ne soit pas cité dans ce dossier.
Dans la cuisine de mon aïeule, il y avait un petit aquarium rond dans lequel se baignait un poisson rouge.
Le bocal était rempli d’eau.
Et le poisson rouge tournait inlassablement.
Je m’occupais donc de Marie-Antoinette en soirée.
En journée, je frappais sur les touches d’un clavier noir pour taper du texte de manière dactylographique.
Assis toute la journée, il n’y avait pas de bambous ni de piano pour jouer debout.
Mes collègues de la formation professionnelle consommaient une résine couleur chocolat. L’esprit tranquille, l’occasion était grande profitant d’une soirée avec mes gars pour tirer une taffe.
Finalement j’aimais fumer pour faire bamboche.
Cependant, je craignais l’émergence de mon lointain démon christique peut-être encore imbriqué dans un coin insoupçonné entre trois neurones de mon complexe labyrinthe cervical. Il n’aurait pas fallu un retour de boomerang car je n’aurais pas supporté de me faire interner par ma propre initiative pour me retrouver seul dans une chambre d’asile cachetonné aux médocs.
Mais la verrue était soignée.
L’abstinence guérie les maux.
Il faut croire.
Mon Jésus de Nazareth n’était plus.
Nous avions trois packs de six bières de Lancelot et un litre de Haut-Médoc. Un Château Sociando-Mallet année 1988. Tous célibataires, nous avons terminé devant le zinc du café du coin.
Dans mon hangar, je n’avais pas d’eau courante. J’allais chercher l’eau avec plusieurs bidons dans le couloir de l’entrée de la maison de Marie-Antoinette.
Le robinet se trouve dans un angle du couloir à côté du water-closet des locataires.
Dans mon hangar, je n’avais pas de cuisine.
Ni de salle de bain.
Mais j’avais mon water-closet privé. Un rudimentaire pot chimique dans une pièce intime de ce loft délabré.
Le chiotte avait sa place.
La pelle et son balai aussi.
Dans la grande salle, j’avais entreposé mes tableaux, de l’arte povera. La lumière manquait pour travailler ma peinture. Mon seul point jaillissant faisait office de porte d’entrée pour ce grand loft.
Une baie vitrée assombrie par un porche mal situé.
Je suis revenu dormir chez maman espérant que Marie-Antoinette me suive. Madame avait son caractère.
- Tu viens avec moi habiter chez Moun ?
- Non.
- Grand-mère...
- Je ne quitterai pas ma maison.
Marie-Antoinette a vendu le hangar au crêpier installé depuis peu dans des locaux juxtaposant la maison de mon aïeule.
Six longs garages.
Depuis la crêperie a été rénovée.
Des crêpes froment ou des crêpes blé noir. Des crêpes froment à la vanille ou des crêpes froment à la cannelle.
Délicieuses.
Dans le Finistère et les Côtes-d’Armor la crêpe blé noir a le nom de galette.
Dans les rayons du commerçant, il n’y a que des crêpes à emporter. Des bouteilles de lait ribot et du lait caillé bien exposés en rangs. Alignés sur étagères réfrigérées, du cidre doux et brut sont à vendre. Des œufs frais aussi pour garnir les crêpes.
Et puis du miel canadien et du miel aux fleurs d’orangers.
Et plein de confitures.
Au citron. À l’orange. À la pomme Granny-smith. Au pain d’épices. Au miel. À la banane. Au chocolat et à l’abricot.
Quand j’étais môme, les six vieux garages servaient d’atelier appartenant à un ébéniste. Le mercredi en milieu d’après-midi, je passais voir souvent Félix travailler à côté de son vieil employé.
Il y avait quelques mots entre moi et Félix.
- Bonjour...
- Tu vas bien ?
- Oui.
Je l’observais debout sagement au prêt de sa hanche. J’adorais l’odeur qui régnait dans son garage. Nous sentions les parfums mélangés des différentes essences de bois.
À l’entrée de son atelier, il y avait la pierre ponce lisse et noire.
Je trouvais amusant que Félix et son employé s’autorisent à cracher sur la pierre plate pour affûter efficacement leurs ciseaux à bois.
Aussi je souriais sournoisement espérant avoir le droit aussi de cracher dessus.
Commentaires
2. xmissbzh le 21-05-2011 à 08:21:23 (site)
hep!! la suite au prochain chapitre...
je vois ke tu ne te lasse pas de mon écriture, de mes souvenirs, et de mon histoire de vie.
c cool. à bientôt. biz
3. sandie le 30-05-2011 à 15:17:55 (site)
un titre comme je les aime...Pas vraiment fait attention au jeu de mots à la première lecture !!
5. justnasty le 28-06-2011 à 14:39:26 (site)
J'vai pas mentir : je haie les blog avec des mots et des mots et des mots et des mots et des mots et des mots et des mots et des mots et des mots et des mots et des mots et des mots .............................................................et aussi des fois ( sa arrive ) DES MOTS . Mais la j'ai fait un effort et j'lai pas r'gretter LOL
6. sandie le 29-06-2011 à 05:38:45 (site)
Bcp aimé l'analyse de mon petit rat....mais c'est pas tout ça, faudrait pas t'endormir sur ton expo (pfff c'est retransmis sur le net pour ceux qui sont loin ?? :(( ) reste 2 chapitres tu vas pas me laissé en plan avec mon whisky breizh quand même !!!
A+ (c'est d'usage)
7. xmissbzh le 09-07-2011 à 13:45:27 (site)
pour sandie, t'inquiète les prochains chapitres arrivent bientôt...
pour ce qui est de l'expo, photographies de mes créations bien sûr dans les jours qui viennent.
Et vidéo de l'ensemble certainement.
j'espèr que ton rye (whisky canadien) ne va pas s'évaporer...
tchao tchao. à+
pour justnasty, merci merci. à+
8. sandie le 13-07-2011 à 15:53:14 (site)
C'est plutôt moi qui risquerait de m'évaporer...j'en suis à la 15ième bouteille lol je repasserai voir tout ça...bises a+
EXPOSITION COLLECTIVE
EXPOSITION COLLECTIVE
en juillet et août 2011 au Barikade à Lorient.
Venez nombreux...
Merci.
vernissage au Barikade
VERNISSAGE de l'exposition collective
au Barikade le vendredi 8 juillet 2011. 19h00.
Merci. à bientôt.
Date de l'exposition :
le jeudi 7 juillet 2011 au vendredi 9 septembre 2011.
fleur de pierre

Commentaires
1. patricesonneck le 31-07-2011 à 01:42:45 (site)
Cette démarche en land-art est passionnante ! Encore... !
5000 passages
mon blog vient de passer la barre
des 5000 passages.
merci à tous. à+
Jérusalem et la vallée de Josaphat
CE CHAPITRE CONTIENT DES PASSAGES POUVANT CHOQUER CERTAINES ÂMES SENSIBLES. POUR AIDER LE LECTEUR À UNE LECTURE SANS HEURT, LES ZONES CRITIQUES ONT ÉTÉ INTENTIONNELLEMENT SURLIGNÉES. AUSSI CES BRIQUES RETIRÉES N’ENLÈVENT EN RIEN À LA CONSTRUCTION DU TEXTE. MERCI POUR VOTRE COMPRÉHENSION.
Chapitre 11
Ainsi je partageais ma suite avec mon frère. Niveau deug en archéologie dans la poche mais pas de talon d’ancêtre ou de vase en cuivre à ausculter. Son plume était occupé par Marie-Antoinette qui finalement m’avait suivi pour lâcher définitivement sa bauge.
Léonardo mordait notre aïeule jusqu'à la moelle et cela m’ébouriffait. Ne pas avoir sa paille le contrariait certainement en plus de ne pas pouvoir vaquer à ses fouilles favorites.
Pour cela, un matin, j’ai fuit la chaumière maternel.
Moun s’était mise en travers de mon capot pour éviter que je m’en aille en pie-grièche.
Mais, mon ticket n’était plus chez ma Moun nourricière.
Il me fallait nicher une piaule. D’urgence.
Février 1998, je m’installais dans mon studio.
Avec tous mes tableaux.
Pots de peinture, brosses et pinceaux.
Le soir de mon aménagement, j’ai pris un verre à la Maison salsa, c’est un bar. Sur le trottoir, je croisais Amélie en place sur sa parcelle. Nous nous étions connus chez un dealer.
Amélie me proposa de la rejoindre chez elle après son boulot.
Je m’assieds dans un luxueux fauteuil style suédois, mélange de genre Louis XV et de Néoclassique. Gustavien. Mon corps prit forme dans ce nouveau réceptacle.
Au loin, j’entends la demoiselle préparer un bon café Grand Mère.
Elle revient.
Elle s’était ajouré le décolleté.
Oubliant le café coulant, elle se pose à mes pieds langoureusement et me lance :
- J’ai envie d’ton corps.
Et se relève chercher le café noir.
La proposition réveilla ma libido. Je l’entends revenir.
Le pas est moins sûr.
A-t-elle peur de renverser le café ?
Elle me sert le café puis le sien.
- Que viens-tu faire ici Andy ?
- C’est toi Amélie qui m’a proposé de venir...
- Ok, mais...
Elle finit la dernière goutte de son café.
- Tu sais, je ne suis pas une fille comme...
J’attendais une réponse à son silence.
Elle reprend :
- Je suis né à moitié comme toi.
- ...
J’ai laissé le joint s’éteindre dans le cendrier. Amélie était nue déjà dans sa chambre sur ses draps avec son supplément entre les cuisses. Elle ne m’avait pas menti. Le dealer non plus.
Je ne pouvais plus reculer ni lui cracher dessus.
Amélie est hermaphrodite. Nom masculin, l’intersexué humain est un être à l’allure féminine mais avec en décor une limace et deux sacs à spermatozoïdes dans l’entrejambe.
L’hermaphrodisme, chez l’espèce humaine, n’a pas la même fonction que dans le règne animal ou végétal qui consiste à pouvoir se reproduire seul. À proprement dit, chez l’homme, l’intersexué n’est pas un escargot ni un lombric. Ce dernier que Monsanto détruit en masse par ailleurs pour le profit de son confort. (Les lombrics aèrent considérablement les sols pourtant avec leurs multitudes galeries.)
Ici, c’est un accident de la nature.
Véritable créature, moitié homme moitié femme.
C’est signé dans leurs chromosomes.
XXY.
Il nait un hermaphrodite humain toutes les mille naissances.
La sirène est leur sobriquet.
Fiction ou réalité ?
Dans quel monde sommes-nous ?
Amélie est brune. De très beaux seins. Sa peau est douce. Amélie a les épaules carrées.
Au petit matin, elle me déclare :
- On ne m’a jamais caressé les seins aussi bien.
Je devais être un bon coup.
La panthère se leva du pieu. Elle disparut nue dans le couloir avec son cul diabolique.
Elle réapparut de nouveau. Son braquemart en surcharge. Le joint au bec que j’avais laissé la veille dans le cendrier du salon. Son paquet de cigarettes dans la poigne gauche solidement fermée.
L’image était moins paradisiaque.
Amélie me passa le joint. La prostituée s’allume une clope et se rencogna sous les draps.
Blottie, elle me proposa de bouger à Jérusalem pour retrouver une de ses cousines en vacances.
Ici, la parousie ne se réaliserait pas.
Mais.
Parmi les autres bancs publics, des doums. Ombre et lumière. Au loin, le Cédron coule à flot. Pas de cumulus mais canicule. Une fille venue de la palmeraie se présente devant nous. La cousine. La jupe en cuir noir juste au dessus des genoux. Tee-shirt à grosses fleurs rouges grenat sur fond dégradé vert émeraude. Très mauvais goût avec ses chaussettes blanches épaisses. Trois colliers sur le cou. Bleus marines. Ballerines noires avec ses petits nœuds sur le nombril.
On devine ses tétons qui se pointent. Pas de soutien-gorge. Petite poitrine.
Après un thé rouge sucré au miel d’orangers dans sa caravane, je me suis retrouvé nu dans un lit. Une chaussette encore au pied. Là, cloisonné tel une tranche de saucisson à l’ail écrasé entre deux belles tartines de miche à l’ancienne. Amélie avait le mamelon de chaque sein qui me caressaient le dos. Solides et durs les deux boutons. Devant moi le visage en fleur de sa cousine. Sarah. Paupières fermées. Sa tête allait de droite à gauche comme ne pouvant pas la caler pour me regarder à travers les yeux.
Les cris bourraient la pièce.
Les murs ont failli pleuvoir.
L’accalmie revenue, Sarah me lécha les pieds et les chevilles avec sa langue presque aussi rugueuse comme un chat persan. Des chevilles jusqu’aux genoux. De l’intérieure des cuisses aux deux couilles.
J’ai pris mon sexe rigide dans la main gauche.
Masturbation.
Amélie me sourie. Un peu pincé. Son sexe et le mien se sont salués. À genoux, elle s’approche jusqu’à ce que sa verge atteigne ma glotte.
J’ai avalé son sperme un peu salé giclé aux portes de mon œsophage. Gorge profonde.
Durant ce temps, Sarah me prenait en levrette à l’aide d’un long godemiché en matière plastique rose sanglé sur ses hanches merveilleusement sculptées.
Je rêve. J’étais comme dans un rêve.
Sarah se retire.
Je suis à quatre pattes.
Le rêve continue.
Amélie me prit encore.
Sarah a pris à pleine dents mon sabre aiguisé. Sur le dos, elle attrape ma nuque avec ses petits mollets bien musclés et bien dessinés m’obligeant à taquiner son petit clitoris. Mes lèvres, petites et charnues, ma langue, musclée et longue, et le coupant de mes dents lui ont titillés et chatouillés ses larges babines spongieuses et marron.
Elle sentait bon, la garce.
Son clitoris avait doublé de volume.
C’est bon signe.
L’hermaphrodite me secoue encore agrippé sur mon corps, ses doigts glissant sur les vallons de mes hanches. La paume solidement accrochée au sommet de l’os.
Un instant, le trio était rentré dans l’empire du vide où le tout devient rien et où le rien prend de l’importance. Aussi, un chant de sirène avait résonné dans l’océan bleu et vert des quatre cloisons de la pièce.
L’atmosphère était mouillée. Les murs ont transpirés.
Le sourire de la Joconde d’un poster était devenu plus évident figé à jamais sur ce bout de papier glacé. Aussi la dame avait changé de regard.
Cette balade avait-il été pour moi un phantasme ?
Amélie aspirait sa glace au citron comme dessert à l’intérieur de ses joues avec insistance. Le matin au réveil. À dix heures dix. Le midi entre la salade de tomates cerise rouges pour l’entrée et le long boudin noir avec sa purée de pommes de terre jaune et ses pommes. Trop cuites. Après le déjeuner fini. Juste avant et suivant le café de seize heures cinq. Le soir avant de salir le trottoir.
Une vraie machine.
J’étais son cobaye.
Le lendemain de la première passe, qui n’avait pas de prix, Amélie me répondu avec une grande assurance qu’elle n’était pas un homme.
- Tu sais, Andy, je suis une femme dans la tête.
Au retour de ce périple vertigineux dans la vallée de Josaphat, là où les morts ressusciteront au Jugement dernier, j’ai construit des muretins en bord de rive, dans le domaine d’un vieux moulin à eau, comme enfant lors de l’assemblage de mes briques de Lego. Jaune. Vert. Noir. Transparent. Blanc. Bleu. Rouge. Gris. Le lieu doit être réincarné en centre culturel. Au cœur du musée, l’Odyssaum, les têtes d’affiche seront les salmonidés anadromes.
Un pampre de savants de l’Institut National de Recherche Agroalimentaire occupait déjà l’endroit pour piéger, mesurer, peser et libérer ces poissons roses. À l’aide d’un artifice ingénieux, ces maestros enregistraient le nombre de chaque truite de mer et de chaque saumon criblés.
Les chiffres s’harmonisaient et s’accommodaient avec brio sur leurs calepins. Du printemps au printemps. Saison de la montaison.
Le frai au fond du lit.
Plusieurs mois passent.
J’ai trente et un an.
J’ai déteint sur une rouquine lesbienne. Sylvie Mors fourbissait à foison son pseudonyme, Elisa, lui façonnant un portrait compliqué.
Son odeur l’était aussi.
Âcre.
Elisa travaille en nocturne dans un bar de nuit.
Danseuse peut-être. Plutôt discrète sur son job, je ne la sondais pas trop non plus.
Sylvie Mors a été, à douze ans, violée par un confrère de son père le jour de son anniversaire.
À vingt deux ans, Sylvie côtoyait beaucoup de magrébins de son âge.
Mais quand ne désirant pas se reconvertir pour se marier avec le dernier de ceux-là, le père de celui-ci a forcée Elisa à travailler sur le trottoir.
Le mec était fils de pute. Son père souteneur.
Sylvie a monté sa fille à peau douce de cinq ans sur ses épaules pour migrer sous les ailes protectrices d’une association soutenant les gazelles froissées et déchirées par cette jungle urbaine. Le Nid.
Le père maquereau aurait pu voler la peau douce pour la négocier vierge à un harem, tannée et chère au sultan de son royaume. C’est ce que le mac lui menaçait si les clients se plaignaient de ses services.
Mauvaises passes.
Bien pire, le père aurait pu se garder la môme pour viol, étranglement et voire découpe en morceau. Rôti ficelé. Un petit sein par ici. Un genou au chat. Une cuisse au boucher pour les kebabs. Un avant-bras, sa main et les reins dans la Mer Rouge. Et puis quoi encore.
Un vent soufflera trois fois.
Elisa a dû changer de quartier pour garder sa liberté et sauver l’avenir de son tendron.
Le Tigre et la Mer Rouge n’auront pas le corps et le sang de sa progéniture. La mère quinquagénaire aura la garde de la jouvencelle. Contrainte pour un temps. La grand-mère a donc tenu au bâton sa petite fille sachant impunément que Sylvie Mors ne s’en sortirait vraisemblablement jamais. C’est ce qu’elle pensait.
C’est vrai qu’Elisa gambadait le pied écorché. Coupé à chaque pas. Mais Sylvie Mors s’en sortirait. Moi, je le savais.
Sylvie Mors, sa fille Charlotte, et moi dînons chez Moun.
Après le repas et après avoir couché sa peau douce à l’étage, Sylvie est allé flagorner la réceptionniste. Espérant bisous et caresses. Mais ma mère, pas gouine pour un sou, n’allait pas non plus avaler la copine de son fils.
Elisa sur le carrelage comme une cavalière sur le cul tombée de sa monture a souri furtivement. Bêtement.
Moun s’est glissé chaudement sous sa couette.
Navrée. Seule.
Elisa me demanda de la prendre. Levrette. Petit derche. Une poire. C’est vrai, ces fesses blanches m’excitaient.
Elle aimait ça.
La garce.
Après avoir éjaculé sobrement au plus profond du couloir de son intestin, mes deux sacs à spermatozoïdes à sec, Sylvie me proposa un trio. Une verge au garde à vous en supplément.
- Une partie à trois ça te branche ?
Un peu réticent mais pas non plus contre :
- ...
Nous nous étions désaltérés à la Maison salsa.
Trois clients.
Un garçon plongé dans l’écriture, Sylvie Mors et moi.
Sylvie :
- Il est beau gosse, non ?
Encore hésitant :
- ...
Sylvie au garçon :
- Thé ou maté ?
Le garçon accepta l’infusion proposée par Sylvie Mors lâchant son crayon à bille sur le vif et ses papiers dispersés sur sa table de bistrot.
Ronde.
Sa cigarette a continué de fondre dans le cendrier.
Pas farouche, Elisa lui proposa de nous suivre. Maintenant. Il ne refusa pas ce con. Il prit ses papiers en vrac, son nouveau portable et son crayon à encre bleue.
Un Bic.
Sa clope s’était éteinte.
Nous avions chacun un rye coca sur la table. Paille rayée blanc et jaune en colimaçon. Plateau de la table basse verre teinté. Note gris bleu. Rectangle et angle droit. Un tapis rouge grenat rehausse le tout.
Large verre à whisky.
Fond épais.
Un glaçon chacun.
Le garçon s’est approché, sa main droite sur le dessus de ma cuisse gauche. Mes pinces sur ses avant bras, j’ai fini par palper ses biceps. Nous nous sommes embrassés. Presqu’un viol.
Sur le canapé-lit, j’ai snifé le trou de son cul. Je crois même l’avoir sucé. Mais.
L’étalon effectuait son service militaire. Garçon de comptoir dans le berceau de la base sous-marine de Keroman à Lorient.
Construite en trois phases successives par les prisonniers de guerre et supervisée par les galons d’Adolf entre 1941 et 1943, la base sous-marine est formée de trois énormes blockhaus.
Le premier bloc est percé de deux larges et profondes alvéoles. Deux autres bâtiments ont été coulés sur la terre des vaches, des champignons et des petites fourmis pour stoker les lourdes torpilles et garer les U-boote hors mouillage. Entretien et réparation. Un quatrième élément juxtaposé au premier bloc forme finalement ce monstre amphibien aux sept alvéoles existants.
Ainsi, le site pouvait héberger une trentaine de sous-marins U-boote. Forteresse marine la plus importante des occupants sur la face Atlantique.
Parmi les U-boote, il y a le type 2, le type 7. Le type 21 est le plus répandu de tous.
Sur le site maintenant, il y a un centre documentaire La Cité de la voile Éric Tabarly et un bar-resto La Base au décor intérieur sobre, raffiné et métallique.
Le lieu dispose d’une micro plage artificielle. Ici, le sable fin semble adoucir la lourdeur des mastodontes mastoc.
Ma belle rouquine sommeillait sur le ventre. Assouvie. Fesses blanches. Ma queue flasque. Veule. Notre garçon n’est plus. L’office des mariniers en avait besoin. Le jour s’était levé. Mais comment avions-nous entremêlé nos corps durant toute la nuit ?
Je n’en savais foutre rien.
Aucun souvenir.
J’ai pris une douche. Froide.
En soirée, le trio s’était à nouveau emmitouflé. Dans les draps. Et Sylvie insistait :
- Andy, sois gentil avec notre invité.
- ...
- Tu as été si doux avec lui hier soir. Souviens-toi !
Le doute s’installait. Le garçon restait silencieux. Était-il complice des faits de la veille dont je n’avais aucune images sinon le souvenir d’avoir voulu effleuré la peau de ce gland devant moi déjà bien rouge et gonflé ?
Lèvre inférieure.
Cinq semaines.
Sylvie Mors m’annonce par téléphone qu’elle est en cloque. Elle désirait mon avis pour garder sa grossesse mais la belle rouquine callipyge dansait sur le tranchant d’une lame et pour éviter la blessure, il lui aurait fallu l’expérience d’un funambule qu’elle n’avait pas. La chute était inévitable.
Au bout du fil, je lui déclarais notre séparation.
Irréversible.
Elisa m’avait drogué lors de la première nuit. Le garçon de comptoir l’avait-il été aussi ?
Des flashes de la soirée me sont apparus que bien plus tard après notre séparation.
Drogué au gammahydroxybutyrate, la drogue du violeur sous les initiales connues du G.H.B.
Ainsi mon ange gardien me rappela que j’avais déjà subi un viol. Bien sûr, je n’avais plus de souvenirs des attouchements provoqués par Julie, la fille de Madame Kerplouz, qui me chatouillait le sexe à travers le tissu de mon short. Et puis quoi d’autre ?
Mon ange gardien :
- Tu as été violé enfant, Andy.
Moi, perplexe et frustré :
- Et par qui j’ai été violé ? Où ?
Mon ange gardien restait silencieux.
Moi, à fleur de peau, insistant :
- Où ?
N’ayant pas plus de réponse, j’avais fini par oublier cette annonce la trouvant déplacée et de mauvais goût.
Ainsi j’avais passé la trentaine et ma joie la plus profonde était de rencontrer enfin ma destinée. Une fille. Une demoiselle. Une femme. Une dame. Une gazelle. Une gonzesse. Une meuf. Une nana. Une épouse. Une compagne. Une greluche. Une nénette.
Un con. Un objet. Un meuble. Un neurone.
Soyons underground
Chapitre 12
Alex est mon nouveau voisin de palier. Alex a des petits yeux noirs et brillants tel une petite fourmi rouge exotique. Alex est petit. Presque fétiche. Cheveux toujours mal coiffés, tout ébouriffé.
La petite fourmi a toujours de lourdes ondes sonores dans son appartement qui font vibrer l’ensemble des quatre murs de la fourmilière.
Le son bourrine.
Techno underground.
Ce n’est pas du David Guetta ni du Carl Cox mixant en discothèque.
Non.
Ces deux ne sont pas mon style.
Affaire de goût.
Que préfère mon aïeule entre le sel et le poivre ?
Un son bien rangé, gens bien sapé.
Moi, j’ai mon blue-jean déchiré pour la saison ensoleillée. Courant d’air sur les poils des cuisses et le caillou des genoux. J’ai mon blue-jean idem pour l’hiver mais ma chair, ma peau et mes poils sont plaqués, serrés sous un stretch sable épais faisant office d’un sous-vêtement supplémentaire comme une pellicule isolante. Les vents hiémaux, frisquets et désagréables ne me vaincront pas.
J’ai la parka kaki connue du raver, matelassée, munie de sa capuche fourrée. Mes oreilles à l’abri des vents glacials.
Ma casquette noire aux deux piercings, un sur le côté, l’autre au milieu de la visière, anneau, est l’accessoire frivole pour le fun mais utile au mieux de son efficacité pour oublier la pluie tombante ou le soleil trop chaud.
Cette musique, son des traveller’s, s’est instaurer radicalement dans mes tripes comme une femelle tombe enceinte par accident.
Première free-party en 1999.
322 personnes entre Carhaix et Quimper.
Les teuffeurs dansaient sous une remise dégagée abandonnée dans le vallon d’un bois.
Un seul Sound-system.
Tous les week-ends, je me rendais dans des rave-party avec la smala de la petite fourmi.
Les dancings sauvages étaient alertés sur l’info-line ou communiqués à l’aide des flyers distribués en teuf. Les flyers étaient rangés parfois dans les gondoles de certains lieux culturels.
Pour s’y rendre, un check-point était fréquent sur le parking d’un supermarché. Tel heure. Un traveller, nomade occidental poseur de son, se pointait alors en bagnole pour chercher toute la coterie venue d’horizons variés.
Il y avait deux coups de klaxon. Un bref, un long, et la ruche se mettait en carrosse. Mais certains rancards fussent bidons. Les petites fourmis rouges exotiques rentraient alors chez elles sans leur remède de cheval tant espéré (L.S.D., cocaïne, ecstasy, cannabis). D’autres préférant l’anesthésiant pour doper les vaches et les chevaux, la kétamine.
Attention. Danger.
Au cœur de la foule, un semblant des soixante-huitards et des « Peace and Love » ressurgit.
Les danseurs noctambules de la tribu se calent tous dans le respect de l’individu.
Dans ce monde, la baston n’existe pas.
Ou si peu.
Ici, quand il y a bousculade autour ou sur la piste de danse herbeuse, terreuse voire boueuse l’individu se retourne instinctivement avec le sourire, la main sur l’épaule pour rassurer. Les valseurs, les promeneurs, les mateurs ou les acheteurs et les dealers accostés ne se livrent pas à de la pugnacité. Nous pénétrons dans la haute sphère spirituelle. Le respect de la personne est à son plein.
Ici, une apparence commune n’existe nulle part ailleurs. Une idée de vraies valeurs de l’humanisme. L’écologie et le « tu ne tueras point ».
Il y a des cons partout.
Dans d’autres festivals ou autres concerts même dit reggae trop de gens se culbutent à tout va sans la moindre demande de pardon. Aucun. C’est vrai, en général, l’individu n’aspire qu’à son intérêt. Une communauté ne lui suffit pas toujours pour s’ouvrir à la compassion. Ces moutons individualistes sont, pour moi, comme ces monnayeurs de fond adorant le matérialisme. Tous dans le même sac.
Adorant l’opulence de la surconsommation, ceux-ci somnolent comme ceux devant ce rectangle lumineux de l’information qui camouflent la vérité de ces quelque grand cent gens décideurs.
Ces derniers ne pourront jamais s’insérer sincèrement au sein de la salsa des teuffeurs.
Il y a l’échange.
Restons dans ce faux vrai besoin de sécurité.
L’intox n’est pas loin.
Les tympans du peuple n’ont pas trouvé l’opium.
Nous avons perdu notre vraie pharmacie.
Le sourire doit rester ce reflexe naturel révélateur.
L’enclume et le marteau de cet atelier aux boucles étranges dont les sonorités que l’on peut assimiler à celles des percussions tribales de l’Afrique noire provoquent des ondes lourdes, ravageuses, envoûtantes et où les rifs répétitives permettent, avec leur mélodie, de décalquer la tête d’un gus et de faire décoller ses pieds du bitume. Un instant. Si.
Il faut danser.
Ici, le son foudroyant balance la tête des gens dans le bon sens.
J’adore.
J’ai dégoté ce carton carré douché à l’acide lysergique diéthylamide. Je n’en avais pas gobé depuis l’année de mon départ en Martinique.
Que du bonheur.
Dix ans aussi que je n’avais pas ingurgité de psilocybes. La veille de mon départ pour les Antilles françaises, je m’étais affalé sur le dos d’un cavalier alcoolique perché sur son tabouret de comptoir. Tombé dans les pommes (celles-ci ne sont pas des Granny-smith).
J’ai reçu la petite fourmi et toute sa smala. Infusion de champignons pour danser en free-party. Tenue de soirée obligée, il pleut, une amie rentre chez elle pour se changer. Espérant l’aborder dans son salon, je me lance mais trempé telle une mouche qui pisse, je suis revenu sur mes pas m’éloignant peu à peu d’elle. À cet instant, un flash, sensation hallucinante, j’ai été un lac. Océan de mon corps. La chair n’était plus. Non. Pas d’ossature non plus.
J’étais sur un seul élément élémentaire à la vie.
Encore que. On ne sait pas tout.
L’eau.
Ce fluide en moi était.
J’étais matière comme l’eau dans sa calebasse.
Ou comme le vin dans son calice.
Les champignons hallucinogènes poussent dans les champs de la vache Bretonne pie noire ou de la Prim’holstein, celle-ci fruit de l’industrie.
Leurs taches singulières et variées sont noires. La robe est blanche.
Ou l’inverse.
Parmi les vaches, nul besoin de s’adresser au dealer. Il n’y en a pas. Il faut baisser son dos pour cueillir le psilocybe, fruit de la Terre interdit par la législation. En Bretagne, la dame Nature est généreuse du mois d’octobre à novembre.
Le téton translucide.
Cueillir le fruit au niveau de la tige en la coupant.
Les vaches ont l’air si paisible.
Madame la noiraude n’est plus de ce monde.
J’ai sniffé de la cocaïne une fois pour danser. Avec elle dans le nez, tu gravites les montagnes de l’Europe, de l’Asie, de l’Afrique ou de l’Amérique. Avec, les chemins sinueux et caillouteux paraissent une route nationale privée, lisse et longiligne. La fierté est à son maximum. Assurance infaillible.
Mais la blanche est coûteuse et perfide. Dangereuse. Avec du flouze en poche lourde, le mental instable et fragile va vite noyer le corps dans l’addiction.
De toutes ces drogues, mon bijou est le psilocybe. Cadeau.
Me piquer une veine pour de l’héroïne. Héroïnomane. Non. Sinon la dose serait volontairement surchargée pour me tirer. Et j’espère ne jamais devoir le faire.
Chacun a le choix pour son retour dans l’inconnu en cas de pessimisme réfléchi. Si pessimisme réfléchi existe.
Mais la drogue ne doit pas être ici pour servir des fins destructrices. Le ballon gagnant est dans le filet de la relaxation, de la thérapie ou de la créativité.
Le panier a une ouverture.
Ici, la sortie est donc possible.
Question de volonté.
Le ballon ne doit pas se dégonfler.
Une substance à ne plus prendre, c’est la plante des régions chaudes et tempérées, originaire de l’Inde, la stramoine.
Plante sauvage surnommée « la plante du diable ».
La stramoine est une espèce toxique du datura.
Sous l’emprise des alcaloïdes de cette pomme épineuse, surnom vu la forme du calice, règne une ambiance cervicale imaginaire dans un monde lugubre. L’activité du corps baisse peu à peu et celui-ci plonge dans un océan angoissant d’hallucination ignorée. Des monstres phantasmatiques sombres apparaissent en silence dans la nuit puis s’évaporent aussi vite tels les éclairs de l’orage qui se succèdent silencieux au loin dans l’horizon.
Conscient d’un état semi-hypnoïde, on ne peut pourtant s’en échapper. Le cauchemar glisse et seule votre volonté de sortir de cet état laxatif vous maintient en vie.
La nuit passe et les démons s’en vont.
expo barikade été 2011

Radiateur baroque
(cadre, bois, métal, verre, peinture dorée).

Les flèches venues de l'enfer (81x62cm).

Abstraction dorée (63x58cm).
Commentaires
1. sandie le 22-08-2011 à 16:06:23 (site)
Nan mais fait trop chaud pour allumer le chauffage aussi joliment baroque soit-il !!!
Quand aux flèches venue de l'enfer j'y vois plutôt un violon dingue cher Maestro
Et avec ça t'aime pas l'bleu je trouve l'association avec l'or très réussi ma préférence va quand même au radiateur ;-)
a+
2. xmissbzh le 22-08-2011 à 20:54:33 (site)
bon pas grave pour les no commentaires sur les chapitres 11 et 12.
ce 11 et ce 12 se suffisent peut-être à eux même.
encore queue...
(sinon toujours 3 chapitres à mettre en ligne)
quand au radiateur baroque, c'est pour prévenir l'hiver rude qui s'approche...
bon et puis com tu insistes, je m'étais pourtant décidé à faire des effort pour m'en défaire, à+
mais c'est plus fort que moi, je veux évoluer alors bye bye
3. sandie le 23-08-2011 à 13:27:28 (site)
Ah bon 3 chapitres ??? j'étais pourtant certaine qu'il y en avait que 12 !!! Bon aller va pour 15 !!
Tschüss !  )
)
4. sandie le 08-09-2011 à 13:21:30 (site)
tout ce monde au bar ikade tu t'es perdu ??? vite vite la suite .....
2001
Chapitre 13
Sur le sol en béton de couleur spécifique en fonction des zones, les légumes tardent. Dans les recoins des machines et sur les tapis bleus roulants aussi. Agent de service en nocturne dans le ventre d’une multinationale en agroalimentaire, je manipule avec force et doigté mon karcher pour enlever les restants.
Haricots verts.
Pommes de terre.
Carottes.
Betteraves.
Couleur nature pour les légumineuses papilionacées.
Du jaune paille pour les tubercules.
De l’orange pour les ombellifères.
Du rouge porphyrique pour les dernières.
Artiste plasticien dans le sang, ce gagne croûte m’offre le pouvoir de jober artistiquement le jour à défaut de pouvoir sauver le monde.
Ce Jésus de Nazareth n’est pas loin derrière.
Mon trublion.
C’est ainsi.
Samedi 20 janvier 2001.
Je déglace mon pare-brise à l’eau chaude. Un litron décoloré dégorgé d’un plastique transparent.
Toujours indomptable au guidon, je vais devoir faire prudence sur la grande route départementale griffant ce beau paysage breton du sud au nord. De Morlaix à Lorient sur la route dite de Roscoff.
Quelle artiste chanteuse, interprète et compositrice est née à Morlaix ?
Brigitte Fontaine.
Devant le carrefour de la départementale, je laisse passer une voiture jaune à point orange allant trop vite. Une coccinelle malade certainement. Jeune pilote néophyte, la première lettre de l’alphabet est posée sur ses miches.
Juché au milieu d’un mamelon, ma Fiat Panda a viré sur le bas côté. Subitement sans me prévenir. J’ai contrebraqué. Je freine. La ferraille ne suit pas mes ordres.
Je pense :
- La coccinelle n’a pas volé dans les décors avec le verglas. C’est donc la timonerie de mon véhicule qui a cédé.
Sur les gravillons du bas côté, mon petit animal noir et blanc reprend adhérence continuant sans vergogne en travers de la chaussée. Au milieu de la route, Marie-Antoinette et mon oncle Tonio sont avec moi, tout deux décédés quelques jours plus tôt. Tout va très vite.
De l’autre côté de la voie, le fossé annonce un talus haut d’un étage avec de meilleures pousses de bambou sucrées et juteuses vraisemblablement.
Plus loin, un autre véhicule devant moi vient dans l’autre sens. Elle est rouge.
La caisse rouge se rapproche.
Je pense encore :
- ... si ma caisse se ploie sur le pied du haut talus, je flanche. Au mieux, je sors paraplégique. Chaise roulante motorisée.
J’essaye donc une nouvelle fois la manœuvre pour m’encastrer dans ce véhicule rouge espérant quelques égratignures. Je tente mon dernier coup de chance.
Il y a eu un choc. Frontal.
Il y a eu un choc. Frontal.
Les deux capots ont plié.
Microscopique petite minute de vide.
Le temps passe.
Trente sept minutes.
Sur mes deux sièges avant, pas confortable, épaule gauche douloureuse, j’étais comme sur la langue d’un dragon pouvant cracher son feu à tout moment. Et je ne voudrais pas brûler vif.
Trop de juifs et d’innocents ont déjà été cuits carbonisés.
Voire jusqu’en cendre.
Les pompiers ont forcé les deux maxillaires de mon animalcule au pied-de-biche.
La dame de l’autre monstre n’a pas un seul ongle froissé.
Moi, je suis transféré sur un brancard dans le bahut au pin-pon écarlate. Luxation du gros orteil du pied droit depuis l’accident. Un gendarme me tend son éthylotest. Je souffle. Alcoolémie négatif.
Destination aux urgences à l’hôpital Bodélio. Lorient.
Radiographie.
Fracture de la clavicule gauche.
Mon aïeule avait eu quatre vingt treize ans.
Belle âge pour s’en aller.
Marie-Antoinette, c’était ma seconde maman. Complicité. En sa présence, mes seuls moments de vraie solitude ont été sur le siège arrière de sa Citroën, une Ami 8 rouge carmin. C’est quand elle venait me chercher chez mes parents à Larmor-Plage pour me garder le mercredi.
Dans son break, je comptais silencieux le nombre de feux colorés différents que nous passions.
Un, deux, trois verts.
Un, deux, trois quatre rouges.
Le compte n’était jamais le même en fonction des semaines. C’est ce qui me stimulait.
Maman et la voisine aiment se retrouver pour refaire le monde autour d’un cubitainer de vin.
Côtes-du-rhône.
Bordeaux.
Merlot.
Sauvignon.
Table en bois achetée chez Darty.
Les deux commères nasillaient aussi de tout et de rien. De bouffes. De fringues. De mecs. De leurs soucis et de leurs boulots. De leurs soucis de boulots.
Après avoir bordé ma grand-mère ce soir là, celle-ci me donna la main. C’est un geste que Marie-Antoinette faisait souvent.
En la caressant, j’ai pensé sereinement :
- Si tu nous quittes cette nuit, sois en paix Marie-Antoinette.
Sa mort précipitée n’était pas un souhait mais cette dernière ne parlait plus ou bien trop peu depuis plusieurs semaines.
- Bonne nuit MA Marie-Antoinette.
- Rentre bien MON petit Andy.
J’ai laissé mon aïeule s’endormir. Ces paupières lourdes éclipsant peu à peu ses deux petits yeux verts. Lumière et quiétude. Maman, elle, continuait à picoler dans un verre à pied de chez la voisine du numéro 13.
Notre ancêtre ayant retrouvé le ciel durant la nuit, Moun n’acceptait le trépas qu’au lendemain matin.
Deuil.
Nous n’avions pas de nouvelle de Tonio, mon oncle, pour le prévenir du décès. Mon oncle passait de belles journées avec les filles à Madagascar. Peut-être avec une seule malgache.
Ce n’est que sur le parvis de l’église juste avant la cérémonie de l’enterrement que maman apprenait le décès de son frère.
Double mort pour la messe.
Avec assurance, j’ai maté le cercueil rentré dans le four. Sanglot.
Il y avait ma cousine.
Mon cousin.
Léonardo.
Ma mère.
Notre ancêtre avait posé la plante de ses pieds et le pied de ses valises sur les quais de New York City en 1925. Jeune femme, Marie-Antoinette n’avait alors que dix huit ans.
Fille au pair dans les quartiers riches de New York City chez les beaux bourgeois, comme elle aimait si bien le dire.
Ménage, cuisine, repassage, baby-sitting.
Elle rencontra son futur mari dans une auberge à Paterson. Bourgade dans le périphérique de New York City. Breton aussi, lui c’est plus tôt qu’il lâcha sa terre natale.
Chose étrange que ce monde est petit. Ces deux là créchaient chez leurs parents respectifs à seulement six kilomètres de distance dans la terra du pays du roi Morvan. C’est en Bretagne.
L’un habitait Le Saint à deux pas de Cavarno. Lieu-dit. Là, mon bisaïeul tenait sa carrière. Excavation de granit. L’autre habitait Le Faouët.
Une fois en Amérique, Zo a produit son pousse-café dans une cave new-yorkaise en distillant des pommes de terre avec son alambic fabriqué sur place.
Je suis fier de mon grand-père. Gaillard et débrouillard.
L’Amérique, c’est l’Amérique.
Zo et Marie-Antoinette se marièrent à Paterson en 1929. Peu après, juste avant l’abrogation de la prohibition de l’alcool, les deux rentrèrent en France.
De retour sur leur terre ancestrale, Zo et Marie-Antoinette construiront leur maison décorée de tuiles orange gardée de près par un hangar au toit en tôles ondulées. Rue Pierre Huet sur la butte du quartier de Keryado à Lorient. Numéro deux.
Zo devient maréchal-ferrant. Mais la guerre venue, mon aïeul ne ramassait plus assez de blé avec ces chevaux à quatre fers coiffés de leur simple crinière blanche, blonde, dorée, noire ou gris bleu. N’oublions pas la queue. Leur museau et les deux oreilles.
Des chevaux armés de quatre roues caoutchoutées sable gagnaient du terrain. Zo dut reconvertir la grande salle en piste de danse.
Il y eut le bal tous les dimanches après-midi dans le hangar réaménagé.
De 14h00 à 19h00.
Marie-Antoinette était mastroquet derrière son zinc du rez-de-chaussée de leur toit couleur navel.
Zo abandonne le dancing en 1955. Chiffonnier et ferrailleur maintenant, il récupère tous ces fripes et ces vieux métaux achetés à des petits trafiquants.
Il y avait du fer, du laiton, du cuivre, du zinc, du bronze en quantité. L’acier, le plomb et l’aluminium étaient plus rares.
Les guenilles, les oripeaux et les tout autres chiffons, il y en avait.
Zo revendait l’unité à un grossiste sur Hennebont quand le hangar, retransformé pour la cause, était bondé à faire lever les tôles.
Hennebont, cité médiévale du treizième siècle est une ville close. Jeanne, veuve de Jean de Montfort, y garda un siège contre Charles de Blois durant la guerre de Succession de Bretagne.
Sauvée par les anglais, la ville fût reprisse par Du Guesclin en 1372.
Avant qu’elle s’en aille, Marie-Antoinette aimait avec fierté me seriner dans le creux de l’oreille ses souvenirs de guerre :
- Quand je tenais mon bistrot et qu’un chleuh me commandait un café, je crachais secrètement au fond de sa tasse avant de faire couler le petit noir. Et si un de ses camarades boches préférait son ballon de rouge, je coupais son vin à moitié d’eau et...
Aussi, elle m’avait conté l’histoire d’un jeune garçon ouvrant précipitamment la porte de son établissement et qui se disait être poursuivi par une meute de boches. Quatre ou cinq soldats.
Sans hésiter, elle cacha l’homme dans la réserve de son troquet. Une annexe dans la courette derrière la maison.
Après la guerre, des bruits flottaient que la gestapo avait toujours son réseau opérationnel. Il valait donc mieux se taire de ses actes glorieux.
Ces petits gestes de mon aïeule dévoilés à voix basse, méritant bien ceux à plus grandes échelles des résistants, n’étaient-ils pas que la partie émergée de l’iceberg ?
Agent de service maintenant dans une petite fabrique de pâtée pour chien et chat, mes yeux ont été plongés mille fois dans une multitude de petits cœurs de poules échappés par mes soins d’un gros monstre gris. Bain de sang.
Aussi, j’ai dû arracher la tête d’un coq pris dans une tige hélicoïde au fond d’une énorme chantepleure industrielle. Il s’en est suivi un mètre soixante trois de boyaux.
Il y a la vue.
Il y a l’odeur.
Trop sensible, j’entendais encore palpiter tous ces petits cœurs. Face aux viscères, j’imaginais toujours la digestion de ces bêtes se faire. Trop de sang sur les murs, moi, je voyais circuler le jus de la vigne dans les veines et les artères. Pour cela, j’ai quitté (peut-être lâchement) mon poste de nettoyeur industriel en plein milieu de labeur sans dire mots. Laissant le rouge dégoulinant sur les carrés de faïence. Le karcher baigné dans le sang.
La couleur du film d’horreur en transparence sur le carrelage.
La vue et l’odeur couleur magenta.
Deux mois passent.
Le poste de radio est allumé chez mon kinésithérapeute.
Ce dernier me dit :
- Vous avez entendu ?
J’étais concentré sur mes exercices pour guérir mes douleurs de genoux.
- De quoi ?
Le kinésithérapeute reprend :
- Un Boeing 747 s’est scratché sur une des tours du World Trade Center.
J’étais concentré sur mes exercices.
Je lui ai répondu, pas convaincu :
- Ah !
Spontanément, j’ai cru à une plaisanterie douteuse et légère trouvant la blague sur l’avion un peu bidon.
J’ai repris avec conviction mes exercices.
En rentrant chez moi, j’ai allumé le poste de télévision machinalement. Il y avait cette image d’une tour en feu. Un avion avait frappé la cime. Impact entre les étages quatre vingt treize et quatre vingt dix neuf. Des êtres vivants sautaient du haut de ce grand totem. J’ai cru trois secondes à une spectaculaire sacrée bande annonce pour un film catastrophe hollywoodien à grand spectacle.
Mais non.
Les commentaires étaient d’actualité.
- Un Boeing a touché la tour nord des Twin Towers ce matin à huit heures moins le quart, heure américaine.
J’ai repensé autrement à la blague de mon kinésithérapeute.
Le deuxième Boeing a percuté la seconde tour en direct.
J’ai pensé :
- Ils sont fous.
Les Twins se sont effondrées.
Le monde allait changer.
Jeudi 27 septembre 2001.
Que pouvions-nous faire pour guérir ce monde ? Moi, je tapais sur mon clavier depuis trois jours avant le double attentat dramatique du 11 septembre pour écrire les premiers mots de cet ouvrage. Essai autobiographique.
Que pouvais-je faire de plus sinon que de continuer à mettre sur l’écran ces quelques mots fragiles ? Au moins s’ils prouveraient l’importance de la vie dans la force et l’espérance d’un seul être, j’aurais gagné mon combat.
Ne trouvant pas la suite ce soir là, je sortis boire un verre. Le lendemain matin, j’étais dans un lit pour la première fois entre deux canons.
Dans la nuit, l’une s’était endormie aussitôt. Quand à l’autre, alors que j’essayais de négocier avec beaux mots et belles caresses pour tirer un coup, la fille me souffla :
- Attention à toi Andy, je suis une fille dangereuse.
Moi, dans mes pensées :
- Eh bien, c’est pas gagné.
Barbara Love, blonde, germaine et soviétique avait l’allure d’une petite sauvage espiègle devant le zinc du Roses Bowl’s bar.
Trente et un ans.
Alice Wolgman, quarante six ans, juive et parisienne, a un fils. Neuf ans. En 1969, Alice a dû suivre ses parents pour vivre en communauté dans un kibboutz en Israël.
C’est une kibboutznik.
Ce voyage, sous le signe de la convalescence, devait guérir Alice d’un traumatisme.
Commentaires
1. sandie le 22-09-2011 à 06:20:38 (site)
han 6h15 j'te vois en page d'accueil... peu pas lire tout ça avant d'allé bosser, va falloir modifier tes horaires de parution ;-)) .....hop j'ingurgite un début de soupe de légumes et j'reviens plus tard...
(commentaire sans aucun interêt je te l'accorde mais c'était juste pour faire coucou )
coucou !!
2. sandie le 22-09-2011 à 13:07:45 (site)
Chapitre 13 est ce un hasard ???
Difficile à lire pour moi, ce chapitre me renvoyant à ma douleur personnelle...
Le départ ( précipité, trop ) de ma Marie Antoinette en juillet dernier et puis ce 11 septembre 2001, c'est évident que chacun se souvient de ce qu'il faisait à ce moment ...Pourtant J'aurais préféré l'oublier...Je n'ai pas vraiment vécu les évennements en live (si on peut dire) je n'ai eu connaissance de cette terrible catastrophe que le 12 septembre au soir.
Pour en revenir à ton récit j'ai beaucoup aimé le passage verglacé de ton animacule et puis l'épisode horrible et pourtant si touchant de ces pauvres poulettes au prise avec un véritable bourreau des coeurs !!
Quand aux deux canons sages situation certainement très agréable ;-)
Ah oui et j'oubliais j'adore Brigitte Fontaine !!!
A+
4. xmissbzh le 22-10-2011 à 15:23:44 (site)
désolé sandy de n'avoir répondu plus tôt, mais boulot boulot et pas facile d'écrire les derniers mots de ce livre.
le choix entre se dévoiler à nu et de tout garder pour soi est difficile.
Aussi l'intérêt est d'accompagner le lecteur jusqu'au bout sans devoir le décevoir.
ainsi, depuis peu, je pense à toi me disant :
- Que va penser sandy sur ces mots?
bye
6. xmissbzh le 23-10-2011 à 15:21:11 (site)
miam, miam.
dit moi sandy, j'espère que ta patience d'ange ne faillira pas en attendant la suite de "la fille de Madame Kerplouz".
sinon j'aime cette idée de prendre en photo les dix objets perso avant que les flammes envolent tout (il me faut prendre le temps d'acheter des piles pour mon appareil photographique numérique).
et je te poste cela.
bye bye
j t'embrass
à+
7. sandie le 24-10-2011 à 06:30:54 (site)
T'inkiet je sais direct par mail quand tu publies...
Bises
Exposition collective janvier 2012
Exposition collective au barikade sur le thème "blanc" proposé par Joke et cathy du collectif d'artistes Art tribu (lien dans la colonne droite).
Titre : Flocons (43x43cm)
Contrepaqué, carton d'emballage, enduit, bouchons plastiques et métalliques, peinture acrylique et alkyde synthétique.
Commentaires
1. sandie le 25-01-2012 à 13:43:17 (site)
Magnifique ce blanc, difficile d'avoir une préférence, je trouve les titres particulièrement bien trouvé et le plat compartimenté assez représentatif de la FIV plus particulièrement de la méthode par ICSI, en tout cas j'aime beaucoup vraiment !
Si tu veux on peut rajouter une vue de ma fenêtre  )
)
a+
2. xmissbzh le 25-01-2012 à 13:58:41 (site)
bonjour sandie.
je ne suis pas spécialiste en la matière (ICSI ?).
Tu m'expliqueras cela plus tard si tu veux en février.
Sinon pourquoi pas faire un rajout de la vue de ta fenêtre... Je serais ravie de voir une partie de ton environnement. bise. à+
3. sandie le 27-01-2012 à 15:05:44 (site)
Pour la vue c'est flocons et barbelés pourquoi pas en photos d'un jour sur mon autre blog ce blanc me donne des idées ...Fevrier avec plaisir...j'attends le signal !
bises
Exposition(S) en février et mars 2012
Lieux et titres des expositions
pour le mois de février et mars 2012 :
"unaffected abstract" au vinocrate (Lorient 56)
Du 1er février au 31 mars
&
"érotisme organisé" au barikade (Lorient 56)
Du 03 février au 05 mars
Vernissage au BARIKADE le vendredi 03 février à 19H00
photographies expo barikade février 2012
Commentaires
1. SANDIE le 20-02-2012 à 19:14:44 (site)
Merci d'en faire profiter ceux qui malheureusement ne peuvent 'y rendre, j'aime beaucoup, bien que j'imaginais les couleurs un peu plus vives, une p'tite préférence pour "lassitude dans un hall de gare" et " la femme crabe" sublime.
bises
2. xmissbzh le 24-02-2012 à 16:08:25 (site)
merci mademoiselle sandie.
c vrai, les deux que tu préfères sont pas mal du tout et tu n'es pas la seul à les apprécier.
pour info, les couleurs sont un poil plus vives en réalité (à voir sur place...).
je viens de mettre en ligne les photographies de l'exposition du vinocrate.
à+
3. sandie le 24-02-2012 à 16:15:38 (site)
Parait qu'on emploi plus le mademoiselle...pffff j'aime bien moi lol Voir sur place, voir sur place oui oui surement ;-))
photo de l'exposition au vinocrate février et mars 2012

à droite, "abstraction dorée". à gauche, "mythologie aztèque sanglante"


"le chat et la souris"

"les flèches venues de l'enfer"

à gauche, "mysticisme", à droite, "porte blindée" (anciennement "radiateur baroque")

"invitation, invitation"
Commentaires
1. sandie le 24-02-2012 à 16:19:09 (site)
Tu sais ce qui m'nrv ne pas être sur place et surtout là maintenant de ne pas pouvoir zoomer et voir en grand les détails grrrrr...Je les trouve parfaitement intègré dans l'environnement et l'éclairage très chouette !!
merci pour la visite
2. xmissbzh le 08-03-2012 à 17:30:19 (site)
c vrai sandie,
mais le lieu y fait beaucoup. sinon désolé pour cet aperçu un peu juste.
dommage je t'inviterai bien à venir.
biz





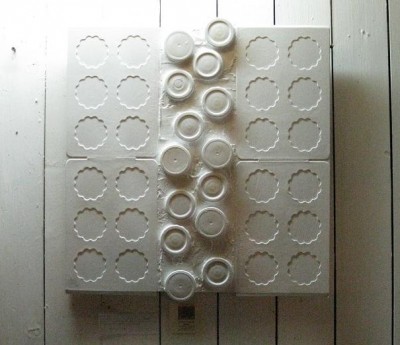








Commentaires